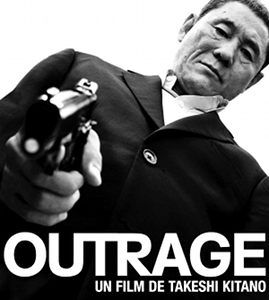de Clint Eastwood.
 Sur le papier, le sujet n’est pas très alléchant. Eastwood vieillissant qui s’attaque à la mort, ou plutôt à ce qu’on peut s’attendre à trouver après la mort, voilà qui peut laisser perplexe. Au travers de trois personnages confrontés plus ou moins directement à la grande faucheuse et dont les itinéraires se croiseront à la toute fin, la maître Eastwood compose une partition, qui, sans révolutionner le monde du cinéma, a franchement de la gueule.
Sur le papier, le sujet n’est pas très alléchant. Eastwood vieillissant qui s’attaque à la mort, ou plutôt à ce qu’on peut s’attendre à trouver après la mort, voilà qui peut laisser perplexe. Au travers de trois personnages confrontés plus ou moins directement à la grande faucheuse et dont les itinéraires se croiseront à la toute fin, la maître Eastwood compose une partition, qui, sans révolutionner le monde du cinéma, a franchement de la gueule.
La caméra du réalisateur a rarement était aussi fluide, d’une classe et d’une discrétion absolue, presque toujours en mouvement. Que ce soit dans les scènes “chocs” (le tsunami, l’accident de voiture), ou dans les scènes plus intimes, la caméra d’Eastwood réussit à trouver une distance absolument parfaite avec ses personnages, proche de leurs corps, de leurs émotions. On pense à Ang Lee dans cette façon de trouver une distance parfaite entre l’oeil et le personnage, jamais voyeur, mais sans éloignement non plus. Cette grande simplicité apporte une lumière extraordinaire au film, et c’est cette sensation de lumière qui prédomine quand la séance s’achève. Au-delà, malgré son sujet a priori sombre, est d’une extraordinaire luminosité, et on ressort de là heureux et ému, presque rassuré.
Mais ce qui séduit surtout, c’est que le film est émaillé de quelques séquences absolument irrésistibles, taquines et d’une grande beauté. Lors d’un cours de cuisine, Matt Damon fait déguster, à l’aveugle, quelques produits italiens à une Bryce Dallas Howard charmante comme tout. Cette petite scène, ultra-sensible, sensuelle, sorte de petit jeu du chat et de la souris est complètement adorable et craquante. Une autre scène fantastique, lorsque le petit Marcus perd la casquette de son frère jumeau récemment décédé dans le métro londonien. Il court au ras du sol, entre les pieds des usagers, dans cette forêt dense pour récupérer le souvenir de son frère. Ou encore Matt Damon, s’endormant grâce à des enregistrements des livres de Dickens. Ces scènes magnifiques font oublier les points faibles du film, notamment toute la partie “française”, avec une Cécile de France et un Thierry Neuvic, qui ont vraiment du mal à tenir la route face à un Matt Damon, juste parfait. On oublie aussi l’esthétique assez décévante par rapport à ses dernières réalisations (malgré quelques contre-jours à tomber dont Eastwood seul à le secret), le scénario, pas vraiment convaincant (honnêtement, on ne sait finalement pas vraiment ce qu’il a envie de nous raconter).
Mais comme je l’ai dit, quelques scènes mignonnes comme tout raflent la mise, et finissent par remporter l’adhésion. Le film est résolument tourné vers le vie et les plaisirs sensoriels (le goût via la cuisine, l’ouïe via les cassettes qu’écoute Damon pour s’endormir, le toucher bien entendu …). Pas un grand Clint, c’est sûr, mais un Clint qui a du coeur et du sentiment. J’aime. Beaucoup.