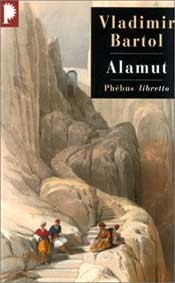Voyage aux pays du coton
Petit précis de mondialisation
d’Erik Orsenna
de l’Académie française (rien que ça)
Fayard
Voila un moment que Voyage aux pays du coton me nargue dans cette vitrine. Illustré du bel idéogramme signifiant « coton » (association des trois idéogrammes : arbre, soleil/blanc et tissu), j’ai longtemps résisté à cause du sous-titre, craignant un ouvrage rébarbatif, bien-pensant et didactique. J’avais tort. Erik Orsenna s’est pris de passion pour l’histoire du coton, cette plante aux fruits pelucheux à laquelle nous sommes tous redevables, et il est parti sur ses traces du Mali à la France, en passant par le Brésil, les Etats-Unis, la Chine, l’Egypte, et l’Ouzbékistan.
Ce livre est donc le récit d’un voyage thématique, avec ses découvertes, anecdotes, rencontres. De ses rencontres avec des petits paysans maliens, brésiliens, ouzbeks, rencontres avec des ouvriers chinois, on ressort l’œil un peu humide : des millions, des milliards de vie, dépendantes d’une matière première sur laquelle ils n’ont finalement aucun contrôle, dans notre société de « trop », c’est la demande qui décide, et non pas l’offre. De l’autre côté, de son œil pourtant fort averti, il raconte de façon faussement naïve ses entrevues avec les puissants de ce monde (en gros les négociants et politiques américains, passages d’autant plus effrayants que racontés de manière assez brute, je le soupçonne de ne même pas en rajouter).
Ton enlevé, écriture délicieuse et poétique, le livre s’avale comme une confiserie, sans écœurement aucun. C’est aigre-doux, entre espoir et désespoir. J’ai lu quelques critiques plutôt déçues par ce livre « sans fond », une « succession d’anecdotes »… alors oui certes, Voyages aux pays du coton n’est pas un livre qui apporte sur un plateau une pensée prédigérée, c’est un livre en creux, qui donne à penser, un miroir partial et partiel de l’économie mondiale dans toute sa diversité et sa cruauté, qui distille sous un récit de voyage faussement bon enfant une peinture grinçante et complexe de notre société.
Le seul reproche que je peux lui faire, en bonne écologiste de métier c’est de ne pas insister suffisamment sur les désastreuses conséquences de la monoculture du coton. Il le fait, bien entendu (il lui était impossible de passer à côté de l’assèchement de la mer d’Aral, coincée entre Kazakhstan et Ouzbékistan, dû à l’irrigation des champs de coton, ainsi que la disparition rapide de la forêt amazonienne au Brésil pour laisser la place aux immenses cultures de coton notamment), mais de manière ponctuelle. Enfin, je mégote, l’ouvrage est court, impossible de développer tous les thèmes abordés.
Pour finir quelques morceaux choisis :
Au Brésil, Orsenna s’étonne de l’effectif (incroyablement faible) d’ouvriers dans les filatures, le patron rétorque :
« –Je sais, c’est encore un peu trop pour résister aux chinois. Quel est donc le secret de ces chinois, l’arme qui les rend si forts ?
Depuis longtemps j’ai réfléchi à cette question. Je vous livre ma réponse : les Chinois ont inventé l’ouvrier idéal. C’est-à-dire l’ouvrier qui coûte encore moins cher que l’absence d’ouvrier« .
Orsenna rencontre un manitou américain de la recherche génétique :
« –Je sais que vos lobbies antigénétiques sont parvenus à faire interdire la recherche. Interdire la recherche ! Comment acceptez-vous cet obscurantisme ? De plus en plus, (…), nous avons l’impression que l’Europe refuse son époque. Et se suicide. L’Europe, berceau de la science moderne !
Ce n’est pas le genre de propos qu’il est agréable d’emporter avec soi. Je ne recommande à personne une soirée dans un motel de Knoxville (Tennessee) en la seule compagnie d’une telle vérité. »
Dans les immenses plaines américaines :
« Qu’est-ce qu’un plat pays ? La sagesse locale donne la meilleure des réponses : ne t’inquiètes pas pour ton chien. Aucune chance de le perdre. Il peut s’enfuir où il veut, courir trois jours et trois nuits, jamais tu ne le perdras de vue. »
A Datang (Chine), capitale mondiale de la chaussette :
« Quatre hectares et neuf milliards de chaussettes (…). Des chaussettes jusqu’au vertige. Jusqu’à douter que l’humanité ait assez de pieds pour enfiler autant de chaussettes. »