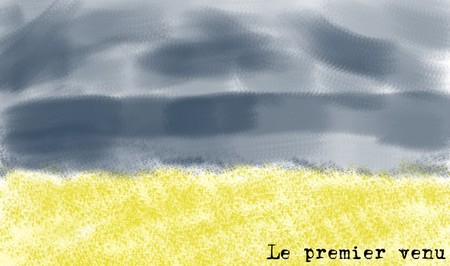de Paco Plaza et Jaume Balaguero.
Bon ça m’apprendra à émettre des réserves sur le dernier Doillon ou à pousser des coups de gueule (justifiés) sur les relents réacs de certaines productions américaines de l’année 2008 (je cite pas lesquelles, je vais encore me faire esquinter). Chers lecteurs, sachez qu’avec [Rec], j’ai expié mes fautes passées et futures pour au moins 77 générations. J’ai voulu me vider la tête à peu de frais (8 euros quand même), dans un multiplex popcornéen. J’en suis juste sortie avec une énorme envie de gerber une certaine sensibilité de l’estomac, et un atterrement sans fond.
La moindre des choses qu’on demande à un film d’horreur, c’est de foutre un peu les chocottes, ou à défaut de bien se marrer. [Rec] échoue absolument partout. Remplissant consciencieusement son cahier des charges de film « caméra subjective » (c’est clair, tout y est, rien ne manque), il est complètement irregardable et inécoutable. Trop de mouvements de caméra dans tous les sens (même Trier oserait pas en faire autant), trop de bruits (dont la VF pitoyable, ça aide pas) ne donnent qu’une envie : que le cameraman et sa putain de journaliste se fassent dévorer au plus vite, ce qui malheureusement n’arrive que tout à la fin (normal me direz-vous, sinon pas de film). Je ne parle pas du scénario archi-rebattu (un lieu clos, des zombies qui bouffent tout le monde, un soupçon de « et-si-c-étaient-les-étrangers-qui-avaient-amené-le-Mal », une pointe de « et-c-est-bien-le-cas »…), des acteurs navrants (la VF ne fait que les enfoncer encore plus), ça risquerait d’en rajouter une couche.
[Rec] est un gros churros bien gras, cuit dans une huile infâme. Je vais rester sur l’assez réussi Fragile du même Jaume Balaguero, sans prétention et nettement plus flippant. Ah et puis ce soir, je regarde Jean-Philippe sur TF1, après, c’est certain, je serai lavée de tous mes pêchés.