de Charles Robinson.
Un corps raconte toujours une manière de faire la guerre.
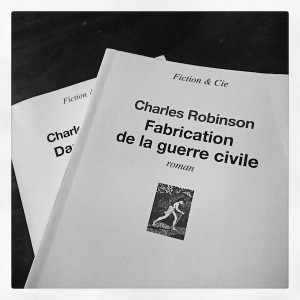 De temps en temps dans ta vie, tu rencontres quelqu’un dont le cerveau ne tourne visiblement pas à la même vitesse que le tien, dont les capacités d’analyse, de détection de la faille sont sidérantes de rapidité. Charles Robinson fait visiblement partie de ces gens-là. Dans les cités me faisait découvrir un écrivain déroutant et passionnant, Fabrication de la guerre civile m’a donné envie de ululer en courant nue sous la pluie. Non mais sans blague, quelle claque, oh lecteur.
De temps en temps dans ta vie, tu rencontres quelqu’un dont le cerveau ne tourne visiblement pas à la même vitesse que le tien, dont les capacités d’analyse, de détection de la faille sont sidérantes de rapidité. Charles Robinson fait visiblement partie de ces gens-là. Dans les cités me faisait découvrir un écrivain déroutant et passionnant, Fabrication de la guerre civile m’a donné envie de ululer en courant nue sous la pluie. Non mais sans blague, quelle claque, oh lecteur.
C’est à dire qu’on ne sait pas vraiment pas où commencer avec cette merveille. Suite de Dans les cités ? Roman choral ? Affreux bordel ? Mine de trouvailles ? Explosion poétique ? C’est tout ça à la fois, mais finalement tout ce qu’on pourra en dire sera vraiment trop peu.
Avant le béton et les politiques de la ville, les Cités sont formées comme pour n’importe quel autre point du monde, de familles, d’amitiés et d’amours, incubateurs puissants des malheurs intérieurs.
La capacité de Charles Robinson à manier des dizaines de personnages, de lieux, de registres de langue est à elle seule une raison suffisante pour acheter et lire ce livre. C’est virtuose, aucun doute là-dessus, et complètement bluffant. Un peu comme quand on en arrive à la dernière saison de sa série américaine préférée, que le scénario est parti dans tous les sens et que l’équipe d’auteurs arrive à trouver le truc qui relie le tout, qui met de la cohérence, de la lumière, de l’ordre dans le joyeux bordel, bref à insuffler de la vie. Fabrication de la guerre civile, c’est un peu ça, un concentré de vies, des lignes qui se croisent, une géographie de l’humain, un drame shakespearien labellisé 9-3.
C’était ça aussi, Paris : l’extérieur est joli, mais quand tu pousses une porte c’est le sous-développement locatif. En plus, Paris, c’est un peu loin de tout.
Et revenons un instant sur la capacité d’analyse et de détection des failles (auto-citation), non mais parce que le gars réussit en une phrase à te démonter toute la sociologie d’une génération ou à relever le signifiant dans le moindre bout de tee-shirt. Oui, je sais, je m’explique mal –> vous n’avez qu’à aller l’acheter (astuce !). Pour être plus sérieuse, Charles Robinson a une faculté bluffante à s’accaparer les langages, les symboles (banlieues, institutionnels, politiques…) et à malaxer tout ça pour créer, ou plutôt recréer, réinventer, révéler les codes, les langues, les cadres… tout en les faisant exploser. Il y a beaucoup de pages, et pourtant pas une devant laquelle on ne s’exclame « oh là ! ici ! la belle bleue ! la belle rouge ! ouiiiii ! ». Non mais les « smileys Robinson » quand même, sans rire, génial non ?
Viols, traîtrises, vengeances. A deux millénaires près, nous serions tous dans la Bible.
Vous nous adoreriez.
La virtuosité t’ennuie me diras-tu ? Ce qu’il te faut, ce sont des histoires, des vraies, avec des sentiments, un développement, du drame, un épilogue ? Les romans de petits malins, très peu pour toi ? Mon pauvre ami, il y a tout ça également dans cette merveille. Des amours contrariées sous fond de guerre civile (–>Autant en emporte le vent), des amours fantômes (–>Vers l’autre rive), des amours déçues (–> Nous ne vieillirons pas ensemble).
Il y a tout est plus encore dans Fabrication de la guerre civile, politique, sociologie, drame. C’est passionnant et je ne sais plus quoi faire pour que tu cours chez ton libraire, oh lecteur. Fais-moi plaisir, fais-toi du bien, lis cette merveille.
Ed. Seuil
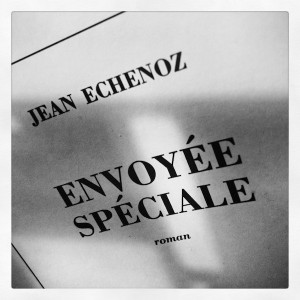 Non mais que ça fait du bien parfois qu’on vous raconte une histoire et comme il le fait bien Jean Echenoz. Parce qu’avouons, Envoyée spéciale n’a probablement guère d’autre ambition que de nous faire prendre du plaisir, et ça fonctionne remarquablement bien.
Non mais que ça fait du bien parfois qu’on vous raconte une histoire et comme il le fait bien Jean Echenoz. Parce qu’avouons, Envoyée spéciale n’a probablement guère d’autre ambition que de nous faire prendre du plaisir, et ça fonctionne remarquablement bien. Difficile pour le lecteur, ou plutôt la lectrice que je suis, de parler de ce livre qui oscille sans cesse et jusqu’à la fin entre grand cri d’amour et déballage impudique. Difficile parce que Marie Simon y aborde des thèmes qui me touchent assez personnellement, comme beaucoup d’autres, sans aucun doute et qu’elle le fait sans filtre, sans circonvolution, en s’entaillant le ventre de bas en haut et en se sortant les tripes.
Difficile pour le lecteur, ou plutôt la lectrice que je suis, de parler de ce livre qui oscille sans cesse et jusqu’à la fin entre grand cri d’amour et déballage impudique. Difficile parce que Marie Simon y aborde des thèmes qui me touchent assez personnellement, comme beaucoup d’autres, sans aucun doute et qu’elle le fait sans filtre, sans circonvolution, en s’entaillant le ventre de bas en haut et en se sortant les tripes. Parfois, on est sentimental. On se rappelle de grands souvenirs de cinéma, déjà anciens et on a envie de retrouver une sensation, un frisson, une stimulation. Alors on fait les fous, on achète un livre, écrit par un ex demi-dieu du cinéma et. Rien. Ou presque. Ou un mélange étrange de perplexité, de consternation. D’hilarité même.
Parfois, on est sentimental. On se rappelle de grands souvenirs de cinéma, déjà anciens et on a envie de retrouver une sensation, un frisson, une stimulation. Alors on fait les fous, on achète un livre, écrit par un ex demi-dieu du cinéma et. Rien. Ou presque. Ou un mélange étrange de perplexité, de consternation. D’hilarité même.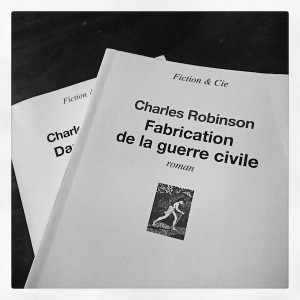 De temps en temps dans ta vie, tu rencontres quelqu’un dont le cerveau ne tourne visiblement pas à la même vitesse que le tien, dont les capacités d’analyse, de détection de la faille sont sidérantes de rapidité. Charles Robinson fait visiblement partie de ces gens-là.
De temps en temps dans ta vie, tu rencontres quelqu’un dont le cerveau ne tourne visiblement pas à la même vitesse que le tien, dont les capacités d’analyse, de détection de la faille sont sidérantes de rapidité. Charles Robinson fait visiblement partie de ces gens-là. 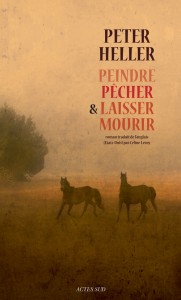 Non mais comment ils sont forts ces ricains quand ils s’y mettent. Dans son deuxième roman, le très prometteur Peter Heller, découvert en France grâce à la magnifique
Non mais comment ils sont forts ces ricains quand ils s’y mettent. Dans son deuxième roman, le très prometteur Peter Heller, découvert en France grâce à la magnifique  d’acceptation de soi et de sa douleur par le sauvetage d’un être plus faible et fragile. C’est sans compter sur le tempérament légèrement sanguin de notre héros et l’immense talent de Peter Heller qui nous entraîne dans une course-poursuite échevelée et déchirante, ponctuée par des pauses « pêche, peinture et flash-back » sidérantes d’audace et de beauté. Oui, il y a de l’audace à « casser » sa ligne narrative de cette manière-là, quand le mec à envie de pêcher, il largue tout pour pêcher, quand Peter Heller a envie de raconter le frétillement de la truite et le comportement de la mouche, il largue tout pour raconter le frétillement de la truite et le comportement de la mouche. L’auteur réussit à faire coïncider la forme de son roman avec la complexité de son personnage, sans chercher le confort pour le lecteur et les chemins balisés.
d’acceptation de soi et de sa douleur par le sauvetage d’un être plus faible et fragile. C’est sans compter sur le tempérament légèrement sanguin de notre héros et l’immense talent de Peter Heller qui nous entraîne dans une course-poursuite échevelée et déchirante, ponctuée par des pauses « pêche, peinture et flash-back » sidérantes d’audace et de beauté. Oui, il y a de l’audace à « casser » sa ligne narrative de cette manière-là, quand le mec à envie de pêcher, il largue tout pour pêcher, quand Peter Heller a envie de raconter le frétillement de la truite et le comportement de la mouche, il largue tout pour raconter le frétillement de la truite et le comportement de la mouche. L’auteur réussit à faire coïncider la forme de son roman avec la complexité de son personnage, sans chercher le confort pour le lecteur et les chemins balisés.