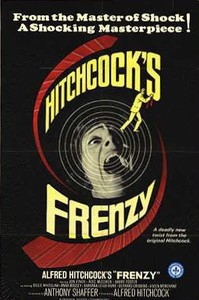(2007) de Danielle Arbid
Cette fois ci le pifomètre a plutôt pas mal marché. Voilà un film qui doit être projeté dans 5 salles, qui fera sans doute mois de mille entrées. Dommage. Le titre est mensonger. Des hommes perdus, il y en a deux dans ce film. Thomas, un « photographe » français qui a largué femme et enfant, pour des errances photographico-sexuelles au Moyen-Orient (on ne peut pas dire qu’il ait choisi la facilité, tout de même), et Fouad, son compagnon de hasard. Taciturne, mystérieux, ou vraiment amnésique, Fouad fuit. Quoi, on ne sait pas. D’abord obsédé par ses ébats, l’attitude indéchiffrable de Fouad, amène Thomas à vouloir percer ses secrets.
Un homme perdu est un film opaque qui ne dévoile pas ses cartes de suite. Ce n’est pas un film confortable, dans lequel on nous amène tout sur un plateau. On ne comprend pas grand chose à ces pays traversés, on suit l’itinéraire de ces hommes, en spectateur voyeur, comme Thomas et son appareil photo indiscret et impudique. Thomas, c’est un peu l’occident, qui se croit tout permis, et prend ce qui l’intéresse, sans vraiment se rendre compte de ce qu’il fait. Il est incapable de regarder les choses en face, comme il est incapable de regarder les femmes de face quand il leur fait l’amour. Fouad, le Moyen-Orient, est incapable de guérir ses blessures, et fuit indéfiniment son passé. Le raccourci est facile, mais le film ne l’est pas.
Les scènes de sexe sont assez belles, violentes en même temps que tendres, et dérangeantes avec cette présence constante de l’appareil photo. Mon coeur de midinette a été renversé par les acteurs, Melvil Poupaud, qui sans bouclette est infiniment plus sexy, et Alexander Siddig, impénétrable. La musique à 2 balles est à oublier vite fait. Pas le chef d’oeuvre du siècle, mais un film suffisamment intéressant pour qu’on lui consacre 1h32. Et très bonne surprise, dans un second rôle, la sublime actrice Darina Al Joundi qui m’avait bouleversé dans sa pièce « Le jour où Nina Simone a cessé de chanter ».