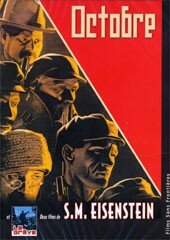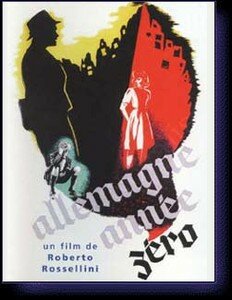(2007) de David Oelhoffen
Quelle catastrophique rentrée cinéma que la mienne, après Boarding Gate, Les Amours d’Astrée et de Céladon, voici Nos Retrouvailles, film platounet et désincarné sur les retrouvailles entre un père lâche et louche et son fiston, sérieux et blanc-blanc comme du bon pain.
Ce n’est pas tant l’histoire qui fait bailler d’ennui, mais bien la manière de la filmer, toujours en gros plans très serrés, comme pour attraper une émotion désespérément absente. Le réalisateur confond proximité et plans rapprochés, et en oubliant le corps de ses acteurs il dissémine toute la substance de son film. Il y avait pourtant, potentiellement, un beau coup à jouer, sur l’ambiguïté de ce père, manipulateur ou faible, sur ce gamin avide de ce père absent, mais qui saura s’en détacher au bon moment.
Gamblin est complètement à l’ouest, pas ou mal dirigé. Nicolas Giraud, bien meilleur, tour à tour innocent et rebelle, réussit cependant difficilement à se faire une place au soleil. La scène du braquage, utilisant plus ample dans les cadrages, plus dynamique arrive trop tard pour sauver le film. Alors, à la vision de tous ces hommes sans corps, on songe à une magnifique phrase de Gols, écrite récemment : « Le cinéma ne devrait être que ça : l’enregistrement de corps en mouvement. » David Oelhoffen devrait peut-être l’écrire 100 fois sur un cahier d’écolier.