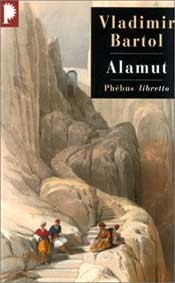de Richard Price (Freedomland)
Editions 10/18
Pour tout vous dire, traînant une flemme de tous les diables quand j’ai fini ce bouquin, je ne pensais pas le chroniquer ici. Et puis… et puis… Voila quatre jours que j’en suis venue à bout et il me hante toujours. Ville noire Ville blanche est un grand livre et il mérite sa modeste place ici. Il s’agit d’un roman noir, social, lucide, violent, profondément humain et plein de tendresse.
Richard Price est né en 1950 dans le Bronx. Scénariste oscarisé pour La couleur de l’argent (Martin Scorsese, 1988), il est également l’auteur des scénarios de New York Stories (du même), et de Clockers (Spike Lee), entre autres. Ses romans en font un phénomène littéraire aux Etats-Unis, salué par rien moins que Hubert Selby et William Burroughs. Voila, pour les présentations, ça c’est fait.
Freedomland commence comme un polar relativement classique, avec un contexte social omniprésent : deux banlieues mitoyennes new-yorkaises, séparées par un petit parc, Armstrong, banlieue ghettoisée habitée par une majorité noire et Gannon, banlieue de classes moyennes, à dominante blanche. Brenda, une jeune femme (blanche) de Gannon blessée arrive aux urgences, en état de choc. Elle dit qu’elle a été agressée (par un homme noir), qu’on lui a volé sa voiture. Problème, son fils de quatre ans était à l’arrière de la voiture. Comme elle est blanche, comme elle a décrit un agresseur black, comme son frère est flic, comme l’agression a eu lieu dans le parc séparant les deux banlieues, toutes les forces de police d’Armstrong et Gannon sont mobilisées pour retrouver l’enfant.
Vous l’aurez compris, l’intrigue n’est qu’un prétexte. D’ailleurs, on a le fin mot de l’histoire bien avant la fin. Ce qui intéresse Price, c’est avant tout la description d’une réalité sociale, des clivages, des tensions. Le fait divers personnel, fait basculer le mince équilibre existant entre les deux mondes. Il analyse avec précision mais sans jugement, ni esbroufe, ni didactisme pédant les conséquences d’un acte ponctuel et ses répercussions, ramifications sur les esprits, les masses.
Il y a des scènes exceptionnelles dans Ville noire Ville blanche, comme cette manifestation des habitants d’Armstrong, protestant pour leurs droits au milieu de la foule de Gannon, confortablement installée sur des transats, comme au spectacle. Ou encore ces pleureuses fanatiques sur la scène d’une exhumation dans un parc d’attraction en ruine (le Freedomland du titre), une battue dans un ancien hôpital psychiatrique en ruine, menée par une association de folles furieuses… Lors de ces passages, on rêve d’une adaptation cinématographique.
Autre grande réussite : les personnages sont vivants. Oui oui, vivants j’vous dis. Je suis persuadée que si je les croisais dans la rue, je les reconnaîtrais. On suit l’itinéraire de deux personnages : Lorenzo, inspecteur d’Armstrong, tiraillé entre son devoir de policier (servir et protéger), et son statut d’habitant noir d’Armstrong, ex-camé, dont un fils est en taule, et qui en a un peu ras-le-bol des injustices en tout genre. Mais Lorenzo n’est pas un super héros, et il faut bien avouer que parfois, il est un peu mou du genou. Autre point de vue sur l’histoire, celui d’une journaliste aux dents longues, Jesse, qui a une telle vie de merde, qu’elle en finit par devenir sympathique. Un comble pour une journaliste. Enfin, évidemment, Brenda, héroïne malgré elle de cette histoire est une boule de souffrance, qui s’enferme dans la musique soul pour ne pas sombrer. C’est un personnage trouble, opaque, profondément humain qui m’a bouleversée, par ses difficultés à vivre, sa mélancolie, son désespoir. On ne peut s’empêcher de l’aimer, même si…
Vu comme ça, vous allez me dire, que quand même c’est très, trop sombre. Certes, c’est toujours pas la fête à la saucisse. Mais l’amour de Price pour ses personnages, pour ces banlieues et les gens qui y vivent, est tel que finalement, ça allume une pitite lumière au fond de la nuit.