de Vassili Golovanov.
“Puis un beau jour, lui – l’esclave de son travail – achève son livre.
C’est le moment le plus effrayant : en un éclair il comprend qu’il est mort. Il avait un livre : c’était une aventure, un jeu, une création, une souffrance, un exil, et soudain, il n’a plus rien.”
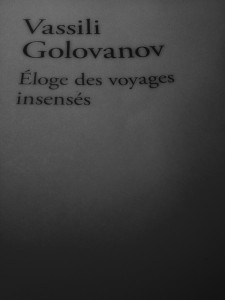 Je ne remercierai jamais assez le quidam m’ayant soufflé le titre de ce livre absolument magnifique de Vassili Golovanov. Eloge des voyages insensés fait partie des livres qui peuvent changer une vie, si, je vous assure, de ces livres qui font bouger des trucs à l’intérieur, des bases, fondements ou certitudes, qu’on croyait pourtant bien accrochés.
Je ne remercierai jamais assez le quidam m’ayant soufflé le titre de ce livre absolument magnifique de Vassili Golovanov. Eloge des voyages insensés fait partie des livres qui peuvent changer une vie, si, je vous assure, de ces livres qui font bouger des trucs à l’intérieur, des bases, fondements ou certitudes, qu’on croyait pourtant bien accrochés.
Vassili Golovanov est russe, journaliste. Il est marié, il a un enfant et un rêve, un rêve de Grand Nord, un rêve d’île. Cette île, ce sera Kolgouev, bout de toundra circulaire, misérable, dans la mer de Barents. Il y retournera trois fois. Eloge des voyages insensés raconte essentiellement son deuxième voyage dans l’île. Mais ce fil conducteur n’est qu’un prétexte. Vassili Golovanov ne s’interdit rien dans sa narration. Son esprit et son écriture vagabondent, explorent, les lieux et les êtres. Il entremêle ainsi les voyages, ceux dans l’île, bien sûr, mais également les autres. Voyages géographiques ou voyages intérieurs, le récit bifurque ainsi en permanence, prenant l’aspect d’une longue errance, qui peu à peu prend forme, se dessine, et finit par trouve son cap, sa cohérence, dans la multiplicité même des pistes suivies.
Eloge des voyages insensés est un livre qui se lit avec lenteur, une lenteur qu’il faut accepter, qui fait partie du processus. Cet éloge invite à la méditation. L’esprit du lecteur est happé par le discours, mais le pouvoir d’évocation de ces pages entraîne plus loin, et les pensées s’échappent, s’émancipent, commencent à créer leur propre histoire, portées par l’écriture de Vassili Golovanov, mais s’en éloignant sans cesse avant d’y revenir toujours. Les strates du récit se mêlent aux strates de la méditation du lecteur, et c’est très beau, cet effet psychique qu’est capable de créer l’écriture, et qui en fait, ou devrait être, le fondement de toute écriture. Loin d’être achèvement, l’écriture se fait alors support, déclencheur, invitation. Le livre et son achèvement deviennent alors la première pierre d’une nouvelle vie, pour son auteur, mais aussi pour le lecteur.
Je ne m’étends pas, mais le livre brasse sans esbroufe mais avec une grande profondeur, une multitude de questions existentielles sur la quête de soi, de l’accomplissement, de l’amour. Vassili Golovanov sait, après quelques pages errantes, ramener le lecteur à l’essentiel par le miracle d’une phrase définitive qui vous cloue au mur. Le fin accélère le mouvement, elle est ravageusement russe, pleine de passions, de contrariétés mortelles, et de joies absolues. Ce livre est un miracle, un peu sauvage, un peu brut, une exploration de tous les espaces possibles, à lire, relire.
Ed. Verdier Collection Slovo
Trad. Hélène Châtelain


