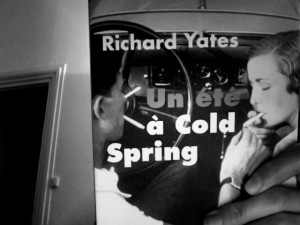de Richard Yates.
Les fidèles de Racines savent déjà à quel point j’aime Richard Yates, et ce n’est certainement pas Un été à Cold Spring qui me fera réviser mon jugement. Richard Yates est un très grand écrivain, qui derrière un classicisme de façade dissimule une des plumes les plus chirurgicales et bouleversantes que je connaisse.
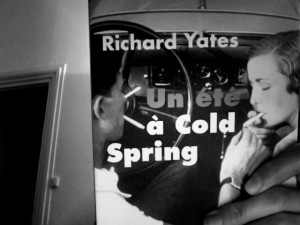
En quelques pages l’auteur dresse le portrait d’une famille américaine somme toute très moyenne. Charles Shepard est un militaire pas franchement brillant, obligé de démissionner à cause de sa vue basse, sa femme une dépressive chronique adepte de la bouteille. Ils ont un fils, Evan, pas vraiment brillant non plus, mais un beau gars, fou de mécanique et de filles. Evan se marie trop tôt, avec une fille trop jeune qu’il a engrossé, se trouve un boulot d’ouvrier dans une usine. Le mariage périclite très vite, et Evan retourne vivre chez papa-maman. Quelques années plus tard, sur le point de reprendre ses études il rencontre Rachel, jolie et docile, mais bien décidée à lui mettre le grappin dessus.
Rien de spectaculaire dans les histoires de Richard Yates. Il nous raconte la vie des petites gens dans les banlieues new-yorkaises. Ce n’est pas la misère, mais pas l’opulence non plus. Cette neutralité permet à l’auteur de déployer un regard d’une lucidité glaçante sur ses personnages. Sa manière de disséquer ses personnages, avec une efficacité de l’écriture, une économie de mots m’impressionne toujours. Richard Yates est à la fois sans complaisance pour ses personnages, il n’essaie pas de leur trouver d’excuse, de les rendre plus beaux ou plus admirables qu’ils ne sont. D’ailleurs, il ne le sont pas, ils sont tous plus ou moins ratés, cassés, brisés. Mais pourtant il n’y a rien de condescendant dans cette écriture, pas de jugement. Cet équilibre délicat entre clairvoyance crue du regard et humanisme est tout à fait miraculeux, et bouleversant.
“En réalité, il n’y a jamais rien de risible chez une femme assoiffée d’amour.”
dit Charles Shepard à son fils après leur rencontre avec l’hystérique et grotesque Gloria qui deviendra la belle-mère d’Evan.
Contrairement à Easter Parade, Un été à Cold Spring ne débute pas sous le signe de la fatalité, bien au contraire. Dans Easter Parade on apprenait dès la première phrase la fin tragique du roman :
“Aucune des deux sœurs Grimes ne serait heureuse dans la vie,(…).”
Un été à Cold Spring débute sous de meilleurs auspices :
“Toutes les peines de la triste adolescence d’Evan Shepard furent oubliées lorsque, à dix-sept ans, en 1935, il tomba fou amoureux des automobiles.”
Évidemment, cet optimisme sera de courte durée, et le destin d’Evan Shepard suivra la même courbe que celui des sœurs Grimes. La vie des personnages de Richard Yates ressemble à un entonnoir, plein d’espace et de possibilités au départ, puis ces possibilités se réduisent jusqu’à ne plus pouvoir suivre qu’un seul et fatal chemin. La dernière phrase du roman nous assène un coup fatal quand, après avoir pour la première fois était battue par son mari, la douce Rachel se console en cajolant son bébé, et lui dit :
”Oh ma petite merveille, (…). Un jour… un jour tu seras un homme.”
Pan dans les tripes.
Pour finir j’ajouterai qu’on en apprend plus sur l’humanité, l’Amérique, les américains et la littérature en 200 petites pages de Yates qu’en plus de 700 pages de Franzen. Mais après, c’est à vous de voir.
 Vous connaissez tous mon admiration absolue pour Richard Yates, dont chaque livre m’a absolument bouleversée, retournée comme une crèpe.
Vous connaissez tous mon admiration absolue pour Richard Yates, dont chaque livre m’a absolument bouleversée, retournée comme une crèpe.