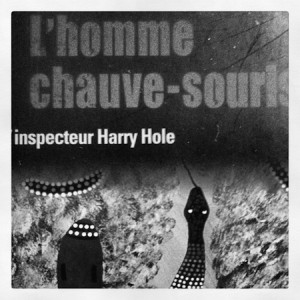d’Emmanuel Carrère.
J’ai reçu en héritage l’horreur, la folie et l’interdiction de les dire. Mais je les ai dites. C’est une victoire.
 Je sors à la fois blessée et enthousiasmée par Un roman russe. Encore dans le souvenir de Limonov, je ne m’attendais pas à ce déballage de vie privée de la part de l’auteur. Déballage qui m’a rendu mal à l’aise au point de devoir arrêter, par moments, la lecture du livre.
Je sors à la fois blessée et enthousiasmée par Un roman russe. Encore dans le souvenir de Limonov, je ne m’attendais pas à ce déballage de vie privée de la part de l’auteur. Déballage qui m’a rendu mal à l’aise au point de devoir arrêter, par moments, la lecture du livre.
Emmanuel Carrère nous raconte en effet l’apogée et la dégradation du couple qu’il formait avec une jeune femme nommée Sophie. Impudique, cette partie de l’histoire l’est à plus d’un titre, non pas dans son volet érotique (ou pseudo-érotique, car jamais tentative de littérature émoustillante ne m’a laissé aussi glacée), mais surtout dans la manière dont Emmanuel Carrère se décrit : comme un sale type dirigiste. Si un millième de ce qu’il raconte est vrai, on peut dire que oui, Carrère est réellement un sale type, et surtout qu’il adore se complaire et se vautrer dans cette description de lui-même. C’est brillant, je ne dis pas, mais je ne comprends pas ce que tout ça apporte au livre, du moins ce que le fait de développer cette histoire sur plus de la moitié du roman apporte au livre. C’est exactement pour ça que je n’ai aucune envie de lire du Angot : j’aime le recours à l’autofiction dès qu’il s’agit de l’intime, on y touche au plus vrai, au plus juste, au plus universel. Dans tous leurs détails factuels, l’intime d’Emmanuel Carrère et sa rupture amoureuse, unique sur la forme, banale sur le fond, resteront à jamais l’intime et la rupture amoureuse d’Emmanuel Carrère. Le lecteur, s’il n’est pas voyeur, n’a qu’à aller se rhabiller, il n’est pas le bienvenu dans cette partie du roman.
Beaucoup plus intéressante par contre l’histoire d’Emmanuel et de la Russie. Plusieurs tiroirs dans ce récit, les rapports d’Emmanuel Carrère avec la langue russe, l’histoire familiale maternelle, boîte de Pandore enfin ouverte, et les voyages de l’auteur dans un bled paumé de la Russie, Kotelnicht, durant lesquels lui et une équipe tournent un documentaire. Là, on retrouve l’écriture de Carrère qu’on a aimé dans Limonov, cette manière de raconter son histoire en créant des liens entre tout et rien, de transformer un voyage sordide, un bled sordide, en un lieu qui catalyse les tensions, les siennes, celles de sa famille et de la Russie. On y croise des personnages qui sous la plume de Carrère deviennent de vrais personnages de romans sans perdre de leur humanité. Il réussit à créer un mystère, une tension, qui se termine dans un bain de sang à la hache, et permet de faire la connaissance d’un vieille femme imbibée tout droit sortie de chez Dostoïevski. Là, c’est vraiment brillant, dans l’écriture, les noeuds qu’il entend défaire.
C’est d’ailleurs une étrange coïncidence que d’avoir choisi Un roman russe après avoir lu L’effrayable, dont les thématiques sont approchantes : nous sommes les héritiers d’une histoire familiale, qui, si elle n’est pas dite peut tout détruire. Tout ça est fait avec beaucoup plus de subtilité chez Carrère que chez Becker, dans des approches formelles complètement opposées. Une deuxième incursion dans l’univers de Carrère en demi-teinte par rapport à l’éblouissement Limonov, avec tout de même l’envie de continuer à découvrir cet auteur. Enfin ses textes. Seulement ses textes.
Ed. Folio
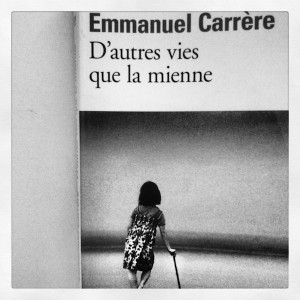 On ne peut pas dire grand chose de nouveau sur ce roman magnifique d’Emmanuel Carrère. Commencé puis abandonné par son auteur au profit de l’écriture d’Un roman russe, le livre a manifestement beaucoup profité de cette phase de maturation et de la stabilisation de la vie de son auteur.
On ne peut pas dire grand chose de nouveau sur ce roman magnifique d’Emmanuel Carrère. Commencé puis abandonné par son auteur au profit de l’écriture d’Un roman russe, le livre a manifestement beaucoup profité de cette phase de maturation et de la stabilisation de la vie de son auteur.