de Mariette Navarro
« Il y a les vivants occupés à construire et les morts calmes au creux des tombes.
Et il y a les marins. »
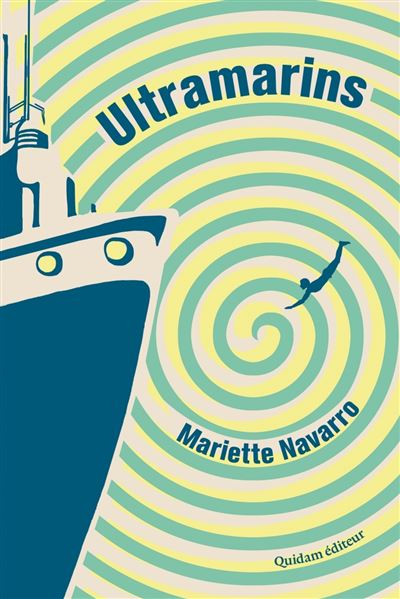
Un cargo au milieu de l’océan transporte ses grosses boîtes ultra-mondialisées sur la trajectoire la plus parfaite, la plus courte, la plus balisée, la plus efficace, la plus sûre. Et puis s’arrête. Au milieu de cet océan, dans une zone d’huile et sous un ciel sans nuage, les marins en descendent pour prendre un bain de mer au-dessus des abysses. Cette brèche dans le cadre, dans la route, dans l’organisation du temps a été accordée par la commandante à la faveur d’un petit relâchement. Et sera le point de basculement de la trajectoire, la flexion du chemin.
« Depuis cette heure, constat est fait d’une autonomisation totale du navire, refusant malgré diverses sommations de respecter les indications de vitesse données par le personnel navigant. »

Ultramarins est le premier roman de Mariette Navarro. Premier roman certes mais sur un chemin en littérature déjà riche de merveilles. On retrouve dans Ultramarins la sublime écriture poétique et les thèmes chers à l’autrice : ces trajectoires empêchées ou ralenties, ces basculements et points d’inflexions qui permettent le passage, le changement d’état, les forces de frottement. L’océan est un parfait décor, sa surface, interface entre le liquide et le gazeux, espace tampon, zone de transition, limbes ou Styx, sans frontière ni limite pour guider les âmes perdues, et le cargo, énorme masse à l’inertie colossale qu’on contraint à s’arrêter quitte à brouiller le cours du temps.
« Comment on en sort ? »
s’interroge les marins. Et Mariette Navarro de répondre :
« En ralentissant la cadence. En ne rendant compte de rien. En ne remplissant pas les objectifs. »
La méthode semble efficace. Roman atmosphérique, qui flirte avec le fantastique – on pense parfois aux fantômes de Kiyoshi Kurosama et aux brouillards de Carpenter – Ultramarins est une superbe réussite et devrait permettre de faire connaître et découvrir l’écriture et les textes intimes et bouleversants de Mariette Navarro.
Ed. Quidam éditeur

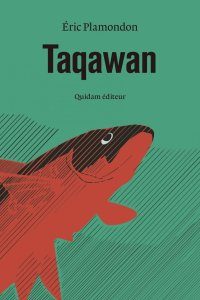 Le saumon, Taqawan, fut roi, il est aujourd’hui proie et l’étendue de son territoire, de la rivière à la mer puis à nouveau à la rivière, ne le sauve pas. Moyen de subsistance, objet de convoitise, le vénérable ancêtre sert ici de fil conducteur à une puissante évocation du Québec. Dans un ballet virtuose, les récits se mêlent, pastilles historiques, recette de cuisine ou conte cruel, et se déposent en strates. Le livre brasse large : points de vue historique, écologique, juridique même. Mais jamais cette érudition ne pèse. Les idées s’entrechoquent, des passerelles se créent, entre les âges, les récits, dans une absolue économie de moyens. L’apparente aridité stylistique laisse au lecteur la place nécessaire pour qu’il puisse construire sa propre histoire, sans rien imposer.
Le saumon, Taqawan, fut roi, il est aujourd’hui proie et l’étendue de son territoire, de la rivière à la mer puis à nouveau à la rivière, ne le sauve pas. Moyen de subsistance, objet de convoitise, le vénérable ancêtre sert ici de fil conducteur à une puissante évocation du Québec. Dans un ballet virtuose, les récits se mêlent, pastilles historiques, recette de cuisine ou conte cruel, et se déposent en strates. Le livre brasse large : points de vue historique, écologique, juridique même. Mais jamais cette érudition ne pèse. Les idées s’entrechoquent, des passerelles se créent, entre les âges, les récits, dans une absolue économie de moyens. L’apparente aridité stylistique laisse au lecteur la place nécessaire pour qu’il puisse construire sa propre histoire, sans rien imposer. Deux couples amis, un enfant curieux, un chien qui sourit, des promenades, une gentille routine. Puis, il y a des vacances à la montagne pour l’un des deux couples. La rencontre avec une femme, une marche dans la montagne et le récit de son histoire, ou plutôt le récit d’une histoire qui n’en est pas vraiment une et de l’Histoire qui, elle, a vraiment eu lieu.
Deux couples amis, un enfant curieux, un chien qui sourit, des promenades, une gentille routine. Puis, il y a des vacances à la montagne pour l’un des deux couples. La rencontre avec une femme, une marche dans la montagne et le récit de son histoire, ou plutôt le récit d’une histoire qui n’en est pas vraiment une et de l’Histoire qui, elle, a vraiment eu lieu.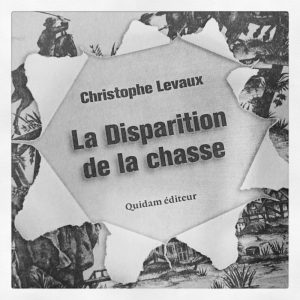 Une ville moribonde, une gare morte avant d’avoir vécue, une entreprise, un séminaire des cadres, un hôtel, quelques personnages gelés dans leur quotidien, leurs regrets et leur incapacité à avancer.
Une ville moribonde, une gare morte avant d’avoir vécue, une entreprise, un séminaire des cadres, un hôtel, quelques personnages gelés dans leur quotidien, leurs regrets et leur incapacité à avancer.