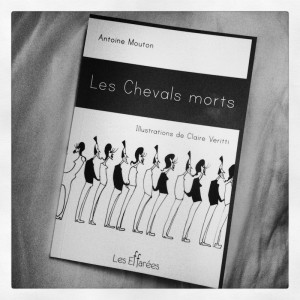d’Antoine Mouton.
(…) car s’il y avait un destin, les choses, les êtres et les événements de ce monde étaient liés entre eux, (…) seule une phrase longue et complexe pouvait donner l’idée des connexions que le destin leur imposait d’établir (…)
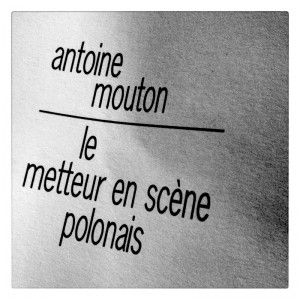 On avait quitté Antoine Mouton en poète au romantisme fou et échevelé dans Les Chevals morts, on le retrouve ici en marathonien de la phrase, en horloger de la syntaxe, en maestro de la construction grammaticale.
On avait quitté Antoine Mouton en poète au romantisme fou et échevelé dans Les Chevals morts, on le retrouve ici en marathonien de la phrase, en horloger de la syntaxe, en maestro de la construction grammaticale.
Pourtant, dès le départ, une sensation de déjà-lu s’accroche méchamment aux synapses. Ces phrases longues, à tiroirs multiples et poupées russes, cet humour, on est dans Bernhard et Chevillard à la fois, mâtiné d’un peu de Beckett et d’une pointe de Karinthy. Que du beau monde me direz-vous. Certes. Et c’est tout à fait plaisant, voire réconfortant, de voir un jeune auteur atteindre ce niveau de maîtrise de la langue et la liberté avec laquelle il la manie derrière cette forme contraignante.
Mais où est passé le romantisme échevelé se demande-t-on ? La passion, la folie ? Progressivement, cette histoire gentiment loufoque d’un metteur en scène polonais légèrement dépassé par la polymorphie de sa création commence pourtant à faire sens et matière. Le foisonnement de pensées, imbriquées, ressassées, et exposé dans ces phrases immenses et bourgeonnantes, se resserre autour d’un point minuscule, un court espace de temps dans la vie du metteur en scène polonais, et de sa femme, qui d’ailleurs à l’époque ne l’était pas encore, et aboutit à l’inéluctable, que pourtant personne ne semble avoir vu venir.
Antoine Mouton réussit, grâce à cette catalyse, à éviter l’exercice de style intégral, absolument parfait mais un peu vide. En déployant un système à la Nolan (Inception, Inerstellar), un foisonnement causé par, quoi d’autre que l’amour fou, Antoine Mouton pose par la même occasion une pierre dans le paysage littéraire français. De la ruse et du cœur.
Ed. Christian Bourgois.