d’Emmanuelle Bayamack-Tam.
Mon père m’a tuée, mais c’est ce que font tous les pères. Mon père m’a tuée, mais ma mère avait commencé avant, et comme je ne suis pas morte, on a bien le crime parfait (…).
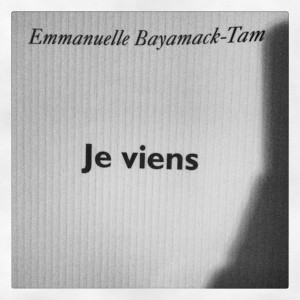 Il fallait bien ça, l’énergie irrésistible de l’écriture d’Emmanuelle Bayamack-Tam, pour me redonner le goût d’écrire. Je viens ne constitue certes pas le choc monumental qu’avait été Si tout n’a pas péri avec mon innocence, la découverte de ce bouillonnement littéraire, ce jaillissement de vie mal-poli et irrésistible. Mais tout de même.
Il fallait bien ça, l’énergie irrésistible de l’écriture d’Emmanuelle Bayamack-Tam, pour me redonner le goût d’écrire. Je viens ne constitue certes pas le choc monumental qu’avait été Si tout n’a pas péri avec mon innocence, la découverte de ce bouillonnement littéraire, ce jaillissement de vie mal-poli et irrésistible. Mais tout de même.
En introduisant la dépareillée Charonne au sein d’une famille de la grande bourgeoisie marseillaise, l’auteur introduit la différence qui fait peur, l’outrage de la couleur et des kilos, l’éléphante dans une maison de porcelaine. Adoptée à cinq ans par des parents stériles et quasiment incestueux Charonne doit user de toute son énergie vitale, son humour et son intelligence pour se construire une vie. Trop noire et trop grosse pour être aimée par son grand-père, trop vivante pour être aimée par sa mère, trop détestée par sa mère pour être aimée par son père, Charonne ne trouve un minimum d’affection qu’auprès de sa frêle et blonde grand-mère d’adoption, Nelly. Nelly qui fût une star, deux fois épouse mais à peine une mère, Nelly qui a décidé de ne garder de ses années passées que les couleurs claires, mais qui peine à continuer à vivre entre son mari gaga et Gladys, sa fille haineuse.
Le livre est composé de trois parties, trois récits de la part de ces trois générations de femmes : Charonne d’abord, Nelly puis enfin Gladys. Dans ces trois parties passé et présent se mêlent, mais l’histoire progresse cependant de récit en récit, jusqu’à ce final suspendu entre la vie et la mort, entre la haine et l’amour.
Ce qui est unique dans l’écriture d’Emmanuelle Bayamack-Tam c’est vraiment cette énergie décoiffante, d’un humour terrible et sans concession. Elle se permet tout, et tout passe. Tout passe parce qu’il n’y a pas là-dedans, ou plutôt il n’y a pas dans l’écriture, une once d’aigreur et de haine. Les personnages peuvent l’être, à l’image de la morne Gladys à la rancœur qui frise l’auto-combustion, à l’image de cette galerie de connards racistes, plus abrutis les uns que les autres. Le livre montre ainsi une panoplie quasiment infinie des bassesses humaines, mais par un tour de passe-passe quasiment miraculeux, l’écriture désamorce par sa force vitale tous les traquenards et les petitesses de l’existence, de ces existences ridicules et flamboyantes.
Je viens (quel beau titre, tout en mouvement et multiples sens !) se place ainsi dans le sillon de la jeunesse et de l’innocence. Pas l’innocence subie, mais de l’innocence voulue, qui a vécu, mais qui choisit de résister. Charonne en est un symbole des plus éclatants.
J’attrape leurs mains respectives, celle de Gladys cramponnée au bord de la table et celle de Régis mollement posée dans son giron, puis sous l’œil expert en amour filial de Mme la directrice, je les porte à mes joues rebondies.
Ed. P.O.L
Une réflexion sur « Chronique livre : Je viens »