de Jean Echenoz.
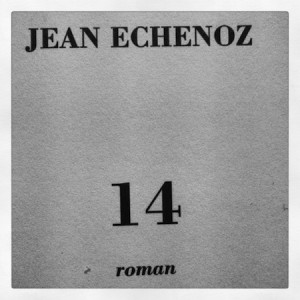 Ce 14, c’est quand même un drôle de truc. On passe son temps à se demander où il veut en venir, Jean Echenoz, et puis le livre se termine par une espèce d’élan vital assez miraculeux. Alors tout se met en place, et on ferme le livre en se disant qu’il y a tout de même un sacré écrivain, là, derrière, pour pondre ce petit bidule qui n’a l’air de rien, et qu’on referme pourtant l’oeil humide, le poil dressé, et le sourire aux lèvres.
Ce 14, c’est quand même un drôle de truc. On passe son temps à se demander où il veut en venir, Jean Echenoz, et puis le livre se termine par une espèce d’élan vital assez miraculeux. Alors tout se met en place, et on ferme le livre en se disant qu’il y a tout de même un sacré écrivain, là, derrière, pour pondre ce petit bidule qui n’a l’air de rien, et qu’on referme pourtant l’oeil humide, le poil dressé, et le sourire aux lèvres.
On est en 1914 donc, c’est la mobilisation. Parmi les mobilisés, Anthime et Charles. Les rapports entre ces deux là ne sont pas clairs, mais ce qu’on sait, pas contre, c’est qu’ils aiment tous les deux la jeune Blanche. Et puis c’est la guerre, et la mort, et la vie. L’entreprise peut sembler modeste, par son sujet, raconter l’itinéraire de trois personnages durant la guerre, et par sa taille, très réduite. Mais Jean Echenoz réussit un livre ample, ambitieux, d’une liberté totale.
Tout cela ayant été décrit mille fois, peut-être n’est-il pas la peine de s’attarder encore sur cet opéra sordide et puant.
Comment parler de la guerre, sans en parler vraiment ? Les tranchées n’intéressent pas plus que ça l’écrivain : déjà racontées mille fois, les scènes de bataille. Echenoz intervient lui-même dans son récit pour faire ce constat. Quoi alors ? Qu’est-ce qui importe si ce ne sont les combats ? Et bien tout le reste, les à-côtés invisibles. Autant ce qui se passe à l’arrière, dans ces villes fantômes, désertées de leurs mâles, dans les usines approvisionnant le front, que dans les airs, colonisés pour la première fois par la guerre. Et puis, bien sûr, et c’est là ce qui rend le livre magnifique, c’est que Jean Echenoz place toujours son récit à hauteur d’homme, sans aucune psychologie superflue, mais avec une attention frémissante pour le détail révélateur, le regard, la parole anodine.
La langue, très composée, compacte, ne perd pourtant jamais de sa poésie et de sa puissance visuelle. Comment en dire le plus possible, avec une économie de mots, par le pouvoir de l’évocation et les révélations du trivial. Et de la langue naît la magie de certains chapitres, de la vie animalière en temps de guerre, à cette promenade dans une ville évidée, en passant par une désertion involontaire et surréaliste, provoquée par une grande solitude et l’attrait de la nature qui s’éveille au printemps.
14 apparaît alors comme traversé par une énergie, un rythme, un souffle de vie. Ça grouille, malgré tout, malgré l’horreur de la guerre, cet opéra sordide et puant, ça grouille, ça picote et ça veut vivre, sans raison, comme la sève pulse dès les premiers jours du printemps. Brillant.
Ed. Les Editions de Minuit
2 réflexions au sujet de « Chronique livre : 14 »