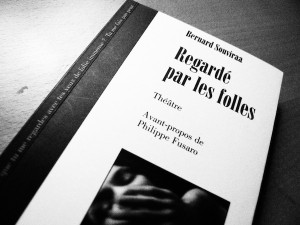de Mariette Navarro
 A peine remise de la découverte d’Alors Carcasse, premier texte publié de Mariette Navarro, que déferle Nous les vagues, texte prophétique, à la fois puissant et intime, dont le flux et le reflux continuent à hanter la pensée bien après la lecture.
A peine remise de la découverte d’Alors Carcasse, premier texte publié de Mariette Navarro, que déferle Nous les vagues, texte prophétique, à la fois puissant et intime, dont le flux et le reflux continuent à hanter la pensée bien après la lecture.
Nous les vagues, c’est d’abord un soulèvement populaire qui envahit une ville endormie. L’ensemble de ces corps ne semblent en faire qu’un, portés qu’ils sont par la même détermination, la même volonté de changer les choses, de remettre en cause l’ordre établi. Mais de ces corps naît peu à peu la voix du doute et de la peur, et le soulèvement se retire pour sans doute revenir mieux. Naissent alors les interrogations personnelles, la confrontation du quotidien, le test de la conviction. La vague peut alors renaître, différente, nourrie de l’intime, de la beauté de l’amour et de la blessure de la perte.
Prophétique, le texte l’est sans aucun doute. Ecrit entre 2009 et 2010, naît lors d’une résidence en Algérie et achevé avant que ne se soulèvent de nombreux pays du monde arabe, Nous les vagues a su saisir ce qui n’était encore que le germe de la révolte, qu’un bruissement de fond, qu’une poussée pourtant silencieuse. Cette capacité à saisir l’air du temps révèle une grande sensibilité au réel de la part de l’auteur, une ouverture d’esprit et d’écoute des mouvements encore cachés du monde.
Et puis il y a surtout dans Nous les vagues, cette alchimie entre l’intime et le collectif, entre les petites histoires et la grande Histoire. L’une se nourrit de l’autre, la pensée politique et collective comme moteur de l’action personnelle et la vie intime comme moteur de l’action politique. Tout comme dans le grand Septembres de Philippe Malone (qui signe ici un bel Avant-Propos), l’auteur choisit de faire varier la focale et la profondeur de champ de son écriture, pour mieux capter les interactions entre l’homme et l’Histoire.
Dans les passages plus intimes, on retrouve ce qui nous avait touché dans Alors Carcasse. Mariette Navarro a une manière très profonde de parler de ce qu’on cache aux regards, de ce qui est à l’intérieur, et qu’on ne peut pas révéler, de la violence de la pensée que l’on tait aux autres. “Nous avons, très souvent, de ces envies de délivrance. Des éclats de violence bien plantés dans la gorge. Mais en ce jour de vague à l’âme, rien ne se montre des plaies à vif. Nous consolidons les prisons pour éviter qu’on nous découvre, nous vérrouillons la chair et l’émotion.” Ce sont sans doute les passages qui me bouleversent le plus, car faisant forcément écho à l’intérieur.
Et puis, tout comme dans Alors Carcasse, on admire cette recherche formelle, jamais vaine, toujours justifiée, qui par ses répétitions, ses martèlements, ses retraits, nous plonge avec une telle (apparente) facilité dans le flux et reflux de ces vagues humaines. L’auteur nous entraîne avec elle, sans jamais rien lâcher, nous baladant d’avant en arrière, mais toujours avançant dans les flots de son histoire. Et cette histoire littéraire que commence à bâtir Mariette Navarro, on a envie de la suivre encore, et on attend avec envie ses prochaines publications dont on ne sait où elles vont nous conduire, mais qu’on devine d’ores et déjà intéressantes.
Pour boucler la publication, un autre texte, Les célébrations, prend la suite de Nous les vagues. Loin de constituer un bouche-trou ces célébrations sont fort intéressantes. Elles raconte une rencontre d’anciens élèves. Pour ce faire, Mariette Navarro choisit une vision surplombante, une vue du ciel, qui lui permet de décortiquer comme une éthologue les comportements de chacun. Elle utilise pour nommer ses protagonistes des termes comme “l’autre”, “l’une”, “le troisième” etc… Ces noms font apparaître les individus comme ils sont, des stéréotypes sociaux, des marionnettes aux comportements prévisibles et caricaturaux. C’est noir, drôle aussi, mais d’un humour caustique et grinçant qui fait froid dans le dos. Avec Les célébrations, Mariette Navarro nous fait découvrir une autre facette d’un talent qui ne cesse de surprendre.
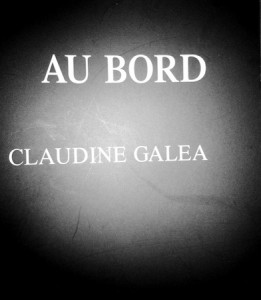 Parfois, il suffit de seize pages pour vous mettre KO, et vous laisser pantelant sur le bord du chemin. Au bord est un texte étrange, difficile à qualifier, à classifier.
Parfois, il suffit de seize pages pour vous mettre KO, et vous laisser pantelant sur le bord du chemin. Au bord est un texte étrange, difficile à qualifier, à classifier.