de Marie Ndiaye.
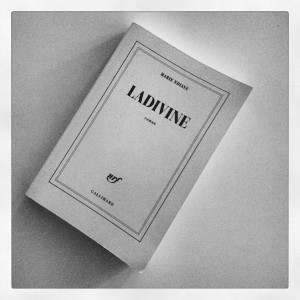 Mettant de côté mon mauvais trip initial en compagnie de Marie NDiaye, ne suivant que mon courage et une presse à genoux, je me suis lancée dans la lecture de Ladivine, nouveau roman de l’auteur de Rosie Carpe.
Mettant de côté mon mauvais trip initial en compagnie de Marie NDiaye, ne suivant que mon courage et une presse à genoux, je me suis lancée dans la lecture de Ladivine, nouveau roman de l’auteur de Rosie Carpe.
Ladivine, c’est l’histoire de trois, presque quatre générations de femmes. D’un faux pas initial naît une espèce de malédiction familiale, une incapacité à être de la part des femmes de cette lignée, alimentée par ce secret initial, véhicule d’une chape de culpabilité qui rend toute évasion et incarnation impossible.
Là encore, je suis complètement admirative de la rigueur, la subtilité, la tenue de l’écriture de Marie NDiaye : pas un poil ne s’échappe de ses phrases, c’est hallucinant de maîtrise. Il y a une sorte de martèlement, d’obsession qui m’a parfois fait mystérieusement penser à Thomas Bernhard. Ces femmes sont enfermées dans leur tête et dans leur vie et leur étouffement transpire de cette écriture, serrée, rigoureuse, presque suffocante. Sublime également la construction du récit et cette irruption progressive du merveilleux, avec l’apparition de ces chiens qui semblent transporter avec eux l’âme de ces femmes. J’ai beaucoup pensé à Laura Kasischke, notamment son Oiseau blanc dans le blizzard, pour ce mystère qui imbibe tout mais ne se dévoile pas, et ce final qui clôt l’histoire tout en l’ouvrant vers l’extérieur, vers la vie enfin retrouvée.
Les réserves que j’ai émis sur Rosie Carpe ne sont malgré tout pas entièrement levées. Permettez-moi une digression. Il y a plusieurs façons pour les romanciers de traiter leur personnages, on trouve : les psychologisants, les comportementalistes et les romanciers de l’état. Je m’explique. Dans la catégorie des comportementalistes on peut citer le grand Richard Yates. Une phrase tirée au hasard de sa nouvelle Une fille unique en son genre “…Susan Andrews annonça à son père d’une voix très calme qu’elle ne l’aimait plus.” La narration est réduite à son plus simple appareil, rien n’est explicité de la mécanique intellectuelle et émotive des personnages, on ne donne au lecteur que le strict minimum, les faits, dans un souci permanent d’économie des mots. Pour ne rien vous cacher, j’adore absolument ça. Pour exprimer la même chose, le romancier psychologisant invoquerait les souvenirs d’enfance de Susan Andrews, la façon dont elle s’est construite en réaction à son père, et les raisons pour lesquelles elle annonce à son père son désamour. Les romanciers de l’état se concentrent au contraire sur les sentiments et sensation du personnage à l’instant où il parle. La phrase de Richard Yates pourrait devenir alors “… Susan Andrews regardait son père, mais ses yeux ne voyait rien que l’indifférence qu’il lui inspirait. Son cœur se mit à tambouriner dans sa poitrine. Elle devait pourtant lui dire ce pour quoi elle l’avait fait venir mais les mots restaient bloqués dans sa gorge. Reprenant son souffle, elle réussit à maîtriser son émotion et parvint à lui annoncer, dans un calme qui n’était qu’apparent, qu’elle ne l’aimait plus.” Le romancier de l’état ausculte les émotions, les sensations de ses personnages, sans essayer d’expliquer leurs actes, mais en se concentrant sur leurs frémissements.
Marie NDiaye est une pure romancière de l’état. Pas de psychologie, mais une obsession fondamentale pour le ressenti de ses personnages. Elle déploie en permanence les trésors de son écriture pour coller au plus de leurs interrogations, de leurs sensations mais surtout des tourments de leur âme. Cette notion d’âme justement prend de plus en plus de place au fur et à mesure de la lecture, et fait tendre le roman vers une quête spirituelle, quasiment mystique, basée sur la découverte du secret initial, comme un péché originel. C’est brillant.
Malheureusement, je n’arrive pas du tout à adhérer à cette sorte de mysticisme un peu glacé. Ça m’ennuie même infiniment. Les personnages ne sont que des âmes errantes, déconnectés complètement de leur réalité physique, de leur corporalité. Ça manque quand même clairement d’un peu de chair, de tripes, d’un petit quelque chose de déviant, perverti, je ne sais pas moi, ça manque de punk. On a bien envie de laisser ces personnages à leur triste sort tellement ils sont mortellement barbants. Laura Kasischke, autre très grande romancière de l’état, réussit, elle à instiller de la vie, du souffle, un peu de crasse même à ses personnages les plus enfermés dans leur vie. Marie NDiaye ne parvient pas à m’intéresser à ses personnages. Et ça me désole d’autant plus qu’elle est véritablement une grande romancière.
Ambivalence des sentiments entre admiration totale et ennui profond.
Ed. Gallimard
Bien que je ne sois pas quelqu’un qui considère l’œuvre au regard des prix précédemment récoltés par son auteur, il faut bien s’avouer qu’il n’y pas de hasard dans la vie d’un écrivain: le Goncourt dans l’actif signifie toujours quelque chose. Bon, je ne vais pas y aller par 36 chemins, cette histoire de femmes traversée par des forces opposées telles que l’amour et la malédiction, est magnifiquement écrite. Ceci est dit concernant la romancière.
Anne, ton manque d’adhérence à cette forme de mysticisme m’étonne un peu; pourtant, je pense assez bien connaitre la lectrice. Bref, ta façon d’écrire, de traduire, est unique. Il s’agit-là d’une belle empreinte de toi.
Heureusement, tu ne sais pas tout de moi. Je suis fort peu spirituelle comme fille !
Comment l’as-tu deviné? Non, je ne connais pas tout de toi (un bel euphémisme!) Notre passion commune ne suffirait-elle pas à nourrir une belle appréciation mutuelle? Un enrichissement en pleine gestation? Notre lien incarnerait-il la précieuse amitié littéraire que j’attendais?
Tes lectures, ton art et tes écrits sont bien différents des miens, il n’empêche que j’admire ce que tu fais.
Merci Michel !