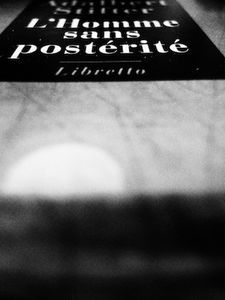de Victor Hugo
 Enorme, énorme, énorme, c’est le mot qui vient à l’esprit lors de la lecture des Travailleurs de la mer. C’est qu’il n’y va pas avec le dos de la chaloupe Maître Hugo, son roman déborde de tout, de génie, d’audace, de culture, parfois même jusqu’à l’overdose. Il faut dire qu’une histoire qui remplirait difficilement sa centaine de pages sous la plume d’à peu près n’importe quel écrivain, en prend environ six cents sous la plume d’Hugo. Il faut donc les remplir ces pages, et Victor Hugo n’a jamais été avare en remplissage culturel. Il s’en donne d’ailleurs à cœur joie, pour qui est amateur, on saura donc tout (si on ne saute pas quelques centaines de pages) sur les bateaux, l’histoire de Guernesey, les propos des gens du cru, les récifs …
Enorme, énorme, énorme, c’est le mot qui vient à l’esprit lors de la lecture des Travailleurs de la mer. C’est qu’il n’y va pas avec le dos de la chaloupe Maître Hugo, son roman déborde de tout, de génie, d’audace, de culture, parfois même jusqu’à l’overdose. Il faut dire qu’une histoire qui remplirait difficilement sa centaine de pages sous la plume d’à peu près n’importe quel écrivain, en prend environ six cents sous la plume d’Hugo. Il faut donc les remplir ces pages, et Victor Hugo n’a jamais été avare en remplissage culturel. Il s’en donne d’ailleurs à cœur joie, pour qui est amateur, on saura donc tout (si on ne saute pas quelques centaines de pages) sur les bateaux, l’histoire de Guernesey, les propos des gens du cru, les récifs …
Mais à côté de ça (il faut tout de même une certaine dose de patience), Les travailleurs de la mer est une histoire romanesque assez extraordinaire, et complètement déchirante. Gilliat, l’homme-ours tombe amoureux de la jolie Déruchette, qui, un jour de neige, sans doute pour s’amuser, a tracé dans la neige avec son doigt, le nom de Gilliat. L’homme y voit sans doute un signe, un appel, et de ce moment, tombe éperdument amoureux de la petite coquette. Il ne connaît rien aux femmes, n’ose pas l’aborder, joue du biniou sous ses fenêtres. Et quand le bateau à vapeur du tuteur de Déruchette s’encastre dans des rochers inaccessibles, Gilliat n’hésite pas, il part seul, équipé de peu, pour sauver la machine. L’enjeu de cette tentative de sauvetage désespéré, la main de Déruchette.
Commence alors une espèce de Kho-Lanta hugolien, un Robinson Crusoé version dure, et c’est magnifique. D’accord, rien ne nous sera épargné des détails du sauvetage, mais l’énergie mobilisée par Gilliat, et surtout le rythme imposé par Hugo sont colossaux. On est happé par les moindres faits et gestes de cet homme, fou d’amour, et c’est grandiose. Je ne vous raconte pas la fin, j’ai chialé pendant trois jours.
Le roman vaut bien sûr également par ses nombreuses allusions politiques, la précision de ses détails historiques. Mais laissez-moi être une vraie midinette, et ne retenir de cette histoire qu’un amour fou, malheureux, et beau comme la nuit.
 Pôpôpôpôpô, énorme souvenir d’adolescente, Les Hauts de Hurlevent méritaient bien une relecture. Et bon, force est de constater que ça envoie du bois bien comme il faut cette histoire d’amour absolue au milieu des bruyères (heath ou heather en VO) battues par les vents.
Pôpôpôpôpô, énorme souvenir d’adolescente, Les Hauts de Hurlevent méritaient bien une relecture. Et bon, force est de constater que ça envoie du bois bien comme il faut cette histoire d’amour absolue au milieu des bruyères (heath ou heather en VO) battues par les vents.