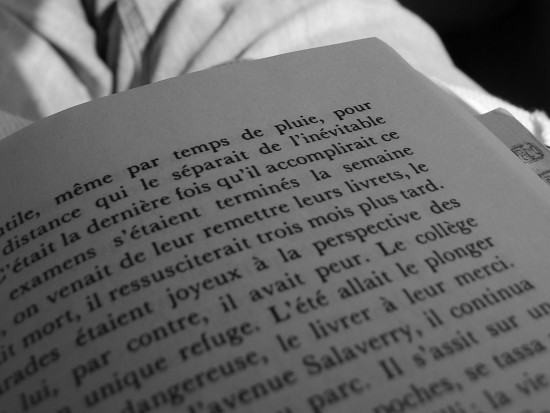de Jean Giono.
Après Un roi sans divertissement, j’ai été moins convaincue par Les âmes fortes, pourtant considéré par beaucoup comme un des meilleurs livres de sieur Giono. Il commence de manière plutôt intéressante. Des vieilles villageoises palabrent lors d’une veillée funèbre. On ne sait pas qui est qui, ça fuse dans tous les sens, de maximes campagnardes en évidences par si évidentes, de ragots de village, de pluie et de beau temps.
Peu à peu deux personnages se détachent, Thérèse, une ancêtre de bientôt 90 ans, et une femme, dont on ne sait pas le nom, plus jeune de 20 ans. Ces deux voix content l’histoire de la susdite Thérèse. Après quelques tentatives divergentes et emberlificotées, c’est la vieille anonyme qui prend le pas, et de manière linéaire narre l’histoire de la naïve Thérèse, asservie par son mari, le vilain Firmin, qui l’oblige à piller les patrons qu’elle vénère. L’histoire est belle, gentiment ambiguë (l’amour filial et un peu plus entre une servante et sa maîtresse), et couvre une bonne partie du volume. Elle n’est cependant pas la plus intéressante.
C’est la voix de Thérèse, une fois ce récit achevé qui s’élève, et vient saper la belle histoire de l’oie blanche. Thérèse, consciente de ses charmes et de son air innocent, aurait passé sa vie à manipuler les autres, y compris son mari et sa patronne, pour le seul plaisir de la manipulation. Le rythme est alors tendu, dans un flot de paroles heurtées, de phrases courtes. Ça part un peu dans tous les sens, comme la mémoire, les souvenirs, et ce jaillissement d’une vie passée dans l’ombre de la manipulation perpétuelle, fait l’effet d’un ballon, trop longtemps gonflé qui finit par exploser. Comme si à 90 ans, il y avait prescription des saloperies commises toute une vie durant.
Le travail sur la notion de mémoire, la subjectivité des souvenirs est intéressant. On ne saura pas au final qu’elle est vraiment l’histoire de Thérèse, manipulatrice ou fabulatrice, ne réinvente-t’elle pas sa vie à l’aurore de sa mort ? Le roman, tout entier consacré à l’humain perd de ce fait une des singularités de Giono, cette façon si extraordinaire de considérer l’Homme comme un simple élément dans le grand décor d’une nature vivante et toute puissante, et non comme une entité occupant le centre. Mis à part quelques belles métaphores « nature », ce sont les méandres de la bassesse humaine qui focalisent la plume de Giono. C’est beau, mais un peu désincarné. Un petit manque de chair.