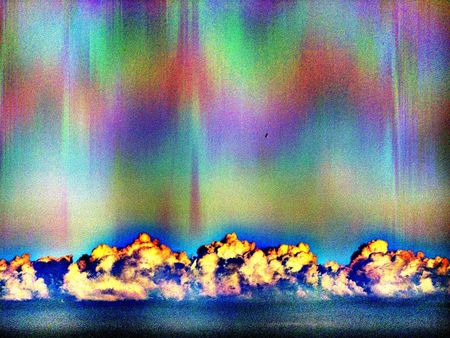Cannes est terminé, et seulement trois films de la compétition officielle sont sortis (si je ne m’abuse) : Volver (Pedro Almodovar), Marie-Antoinette (Sofia Coppola) et le Caïman (Nanni Moretti).
 Très attendus tous les trois, peut-être les plus attendus de la compétition officielle, seul Volver est reparti récompensé, pour l’ensemble de ses actrices (amplement mérité), et pour son scénario (là je reste perplexe – Prix de consolation ?). J’ai beaucoup aimé Volver, Almodovar vieillit, épure sa mise en scène, tout en restant foisonnant. C’est un beau film, émouvant, bien fait. Pas grand chose à dire, c’est de la belle ouvrage. J’ai été surprise par le prix du scenario, peut-être le seul point un peu faiblichon du film. Surtout quand on le compare à la magnifique intelligence du scénario du Caïman.
Très attendus tous les trois, peut-être les plus attendus de la compétition officielle, seul Volver est reparti récompensé, pour l’ensemble de ses actrices (amplement mérité), et pour son scénario (là je reste perplexe – Prix de consolation ?). J’ai beaucoup aimé Volver, Almodovar vieillit, épure sa mise en scène, tout en restant foisonnant. C’est un beau film, émouvant, bien fait. Pas grand chose à dire, c’est de la belle ouvrage. J’ai été surprise par le prix du scenario, peut-être le seul point un peu faiblichon du film. Surtout quand on le compare à la magnifique intelligence du scénario du Caïman.
 Marie-Antoinette est sortie bredouille du festival, et c’est normal. C’est un grand film raté. Il y a des scènes magnifiques dans ce film. Quand Sofia Coppola filme au plus près Kirsten Dunst (vraiment bien), l’émotion naît brutalement, c’est d’une beauté à couper le souffle. Par contre, dès qu’elle s’éloigne de son actrice, la réalisatrice semble perdue, images illisibles, cadrages approximatifs, éclairages laids… Le mélange de rock/baroque ne m’a pas dérangé, mais cette absence totale de sens de l’image en cinemascope, oui. Au final, on pleure un peu, on est émerveillé de temps en temps, mais on s’ennuie beaucoup. Je suis sortie de la salle assez en colère, ça aurait pu être un grand film…
Marie-Antoinette est sortie bredouille du festival, et c’est normal. C’est un grand film raté. Il y a des scènes magnifiques dans ce film. Quand Sofia Coppola filme au plus près Kirsten Dunst (vraiment bien), l’émotion naît brutalement, c’est d’une beauté à couper le souffle. Par contre, dès qu’elle s’éloigne de son actrice, la réalisatrice semble perdue, images illisibles, cadrages approximatifs, éclairages laids… Le mélange de rock/baroque ne m’a pas dérangé, mais cette absence totale de sens de l’image en cinemascope, oui. Au final, on pleure un peu, on est émerveillé de temps en temps, mais on s’ennuie beaucoup. Je suis sortie de la salle assez en colère, ça aurait pu être un grand film…
Au moment où je vous parle, je sors juste du visionnage du Caïman, et je suis encore toute retournée. Je ne connais pas très bien Moretti, je connaissais juste « Journal Intime », que j’avais beaucoup aimé. Mais un film politique, bof, ça m’enthousiasmait moyennement.  Mais le Caïman n’est pas un film politique, ou pas seulement. Le côté politique, Nanni Moretti l’expédie assez vite : toute l’Europe se moque de ces italiens qui ont laissé l’impensable arrivé au pouvoir, tout le monde connaît les malversations de Berlusconi, alors on en parle, pour ne pas oublier, on visionne quelques images d’archives (incroyables) pour se mettre dans l’ambiance. Le Caïman parle avant tout d’un moment charnière, professionnellement et humainement, dans la vie d’un homme, un producteur sur le retour, ayant voté Berlusconi, qui pour sauver ses finances (ou se sauver lui-même), décide de produire (sur une mauvaise lecture de scenario), le projet d’une jeune réalisatrice de gauche. Le Caïman parle également de création, de la difficulté de monter un projet, surtout aussi sensible. Le scenario de ce film est grandiose, brillamment intelligent. La mise en scène est également extraordinaire. Pied de nez et mise en abyme magnifique de Moretti, après le désistement de l’acteur principal, devant jouer Berlusconi, c’est lui-même qui reprend le rôle du Caïman… Les dernières scènes du film ne sont plus celles de Moretti, mais celles du film dans le film, les scènes du film de Teresa, et on voit le Caïman, en voiture, s’éloigner du tribunal en flamme, dans lequel il vient de se faire condamner. Et vous savez quoi? Ca faisait longtemps que je n’avais pas autant ri, ni autant pleuré pendant un film… Si ça n’est pas le meilleur des arguments ça !
Mais le Caïman n’est pas un film politique, ou pas seulement. Le côté politique, Nanni Moretti l’expédie assez vite : toute l’Europe se moque de ces italiens qui ont laissé l’impensable arrivé au pouvoir, tout le monde connaît les malversations de Berlusconi, alors on en parle, pour ne pas oublier, on visionne quelques images d’archives (incroyables) pour se mettre dans l’ambiance. Le Caïman parle avant tout d’un moment charnière, professionnellement et humainement, dans la vie d’un homme, un producteur sur le retour, ayant voté Berlusconi, qui pour sauver ses finances (ou se sauver lui-même), décide de produire (sur une mauvaise lecture de scenario), le projet d’une jeune réalisatrice de gauche. Le Caïman parle également de création, de la difficulté de monter un projet, surtout aussi sensible. Le scenario de ce film est grandiose, brillamment intelligent. La mise en scène est également extraordinaire. Pied de nez et mise en abyme magnifique de Moretti, après le désistement de l’acteur principal, devant jouer Berlusconi, c’est lui-même qui reprend le rôle du Caïman… Les dernières scènes du film ne sont plus celles de Moretti, mais celles du film dans le film, les scènes du film de Teresa, et on voit le Caïman, en voiture, s’éloigner du tribunal en flamme, dans lequel il vient de se faire condamner. Et vous savez quoi? Ca faisait longtemps que je n’avais pas autant ri, ni autant pleuré pendant un film… Si ça n’est pas le meilleur des arguments ça !
Un regret donc, dans ce palmarés cannois. Volver deux prix, le Caïman aucun… Une récompense pour le scénario n’aurait pas forcément été une mauvaise idée !
Petits rajouts, suite à gros oublis concernant le Caïman :
– l’itinéraire du héros, est bien évidemment très symbolique de l’état actuel de l’Italie, qui se trouve à un moment charnière de son histoire ;
– finalement le Caïman ne serait-il pas un grand film autobiographique déguisé?
– Moretti a choisi des musiques excellentes, en complète adéquation avec l’histoire. Encore une grande intelligence dans ce choix.
– Je vous l’ai déjà dit, le Caïman est un film intelligent, mais autant sur le fond que sur la forme. Il possède surtout une immense qualité, il est intelligent du point de vue émotionnel, ce qui est encore plus rare.
Je me répète? Peut-être, tant pis, allez le voir !
 A cause d’une avarie matérielle, un avion à destination de Mexico tourne en rond dans le ciel espagnol. Pour éviter tout mouvement de panique, les hôtesses ont drogué les passagers de deuxième classe, les quelques passagers VIP étant chouchoutés par trois stewards adeptes respectivement de l’alcool, la prière et la dope, et conjointement de comédies musicales. Dans le petit monde fermé de la classe VIP, il va s’en passer des choses. La peur du crash aidant, les coeurs et les braguettes s’ouvrent. Continuer la lecture de Chronique film : Les amants passagers
A cause d’une avarie matérielle, un avion à destination de Mexico tourne en rond dans le ciel espagnol. Pour éviter tout mouvement de panique, les hôtesses ont drogué les passagers de deuxième classe, les quelques passagers VIP étant chouchoutés par trois stewards adeptes respectivement de l’alcool, la prière et la dope, et conjointement de comédies musicales. Dans le petit monde fermé de la classe VIP, il va s’en passer des choses. La peur du crash aidant, les coeurs et les braguettes s’ouvrent. Continuer la lecture de Chronique film : Les amants passagers