d’Emma-Jane Kirby.
L’opticien plante ses ongles dans la peau noire et visqueuse pour hisser le garçon à bord. De sa vie, il n’a jamais serré aussi fort la main de quelqu’un.
 Impeccable, irréprochable, c’est ce qu’on se dit en posant avec émotion ce livre. C’est une histoire vraie, des paroles collectées par Emma-Jane Kirby, journaliste à la BBC. Mais ce témoignage, elle en a fait un livre, un roman. Le procédé pourrait être discutable, le résultat ne l’est pas. L’opticien de Lampedusa frappe juste.
Impeccable, irréprochable, c’est ce qu’on se dit en posant avec émotion ce livre. C’est une histoire vraie, des paroles collectées par Emma-Jane Kirby, journaliste à la BBC. Mais ce témoignage, elle en a fait un livre, un roman. Le procédé pourrait être discutable, le résultat ne l’est pas. L’opticien de Lampedusa frappe juste.
Cet opticien donc, petit commerçant de son état, en fin de carrière, qui aime l’ordre et la précision, se trouve, avec sa femme et des amis, au coeur d’un drame absolu, le naufrage d’un bateau de migrants essayant de rejoindre les côtes de Lampedusa. Ils sont en mer, au petit matin, entendent des cris, imaginent des mouettes, découvrent des centaines d’hommes et de femmes, surtout des hommes, luttant contre la noyade. Ils en sauvent quarante-sept, sont contraints de s’arrêter là.
Ce qui intéresse Emma-Jane Kirby, au-delà du drame en lui-même évidemment, c’est la gestion intime de ces faits par ceux qui les ont vécus, les chambardements intérieurs qu’ils ont provoqués sur l’opticien et ses proches. Parce qu’il aura fallu à l’opticien d’être sur ce bateau pour comprendre et pour voir. Voir les migrants au-delà de silhouettes au bord de la route, au-delà de la baisse du tourisme qu’ils engendrent, voir et comprendre leur détresse, leur courage.
Il n’y a pas grande analyse politique apparente dans ce texte, au style sobre et lumineux, mais une volonté humaniste de donner à ressentir et à voir. Sans débordement, sans leçon, de manière factuelle et épidermique, l’auteur choisit la voie du vécu et du sensible, en évitant tout mélodrame. L’équilibre n’était pas évident à trouver et c’est par son écriture précise qu’Emma-Jane Kirby réussit à l’atteindre. L’opticien de Lampedusa constitue une véritable oeuvre littéraire, juste et touchante qui nous dit, avec subtilité, ouvrons les yeux.
Ed. Équateurs
Trad. Mathias Mézard
 C’est la France des sous-préfectures, des départementales, des périphéries et des zones commerciales, la France des mobylettes et des garagistes, celle où lorsque tu es ado, le BTS tourisme ou comptabilité constitue l’horizon de la réussite suprême, où tu traînes tes guêtres dans le bar pourri en face du lycée, où ta plus grande ambition est de rouler ta première pelle. Ce sont les habitants de cette France dont on ne parle pas en littérature que Julien d’Abrigeon choisit de nous raconter au travers de dix textes rythmiques et percutants, organisés comme des chansons sur les deux faces d’un vinyle.
C’est la France des sous-préfectures, des départementales, des périphéries et des zones commerciales, la France des mobylettes et des garagistes, celle où lorsque tu es ado, le BTS tourisme ou comptabilité constitue l’horizon de la réussite suprême, où tu traînes tes guêtres dans le bar pourri en face du lycée, où ta plus grande ambition est de rouler ta première pelle. Ce sont les habitants de cette France dont on ne parle pas en littérature que Julien d’Abrigeon choisit de nous raconter au travers de dix textes rythmiques et percutants, organisés comme des chansons sur les deux faces d’un vinyle.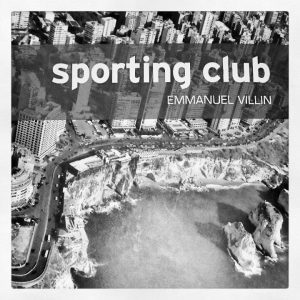 Dans une ville en perpétuel chambardement, au bord de la Méditerranée, probablement Beyrouth, notre narrateur essaie vainement de croiser la route de Camille pour l’interviewer et écrire un livre sur la vie de ce mystérieux et charismatique personnage. Mais Camille se refuse, laisse traîner. Il ne reste plus à notre héros qu’à trainer ses guêtres dans la ville, lézarder sur un transatlantique d’un autre temps dans un club sportif d’un autre temps au milieu d’une ville qui accumule le béton à un rythme frénétique.
Dans une ville en perpétuel chambardement, au bord de la Méditerranée, probablement Beyrouth, notre narrateur essaie vainement de croiser la route de Camille pour l’interviewer et écrire un livre sur la vie de ce mystérieux et charismatique personnage. Mais Camille se refuse, laisse traîner. Il ne reste plus à notre héros qu’à trainer ses guêtres dans la ville, lézarder sur un transatlantique d’un autre temps dans un club sportif d’un autre temps au milieu d’une ville qui accumule le béton à un rythme frénétique.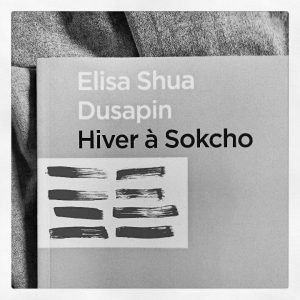 Voilà déjà quelques mois que je n’avais plus ululé de bonheur, sauté partout en criant « oui, oui, oui, encore », pleuré à chaque page en disant « mais que c’est beau » et tout ça, à la découverte d’une écriture nouvelle, d’un univers, d’une histoire. Et pourtant, Hiver à Sokcho est bien peu spectaculaire, du moins en apparence. C’est que cette jeune auteur réussit quelque chose de tout à fait magnifique, travailler sur la simplicité, le non-dit, le mystère. Ça pourrait être ennuyeux et glacé, c’est puissant et évocateur, traversé par des courants de vie, des lignes de force, le feu sous le givre.
Voilà déjà quelques mois que je n’avais plus ululé de bonheur, sauté partout en criant « oui, oui, oui, encore », pleuré à chaque page en disant « mais que c’est beau » et tout ça, à la découverte d’une écriture nouvelle, d’un univers, d’une histoire. Et pourtant, Hiver à Sokcho est bien peu spectaculaire, du moins en apparence. C’est que cette jeune auteur réussit quelque chose de tout à fait magnifique, travailler sur la simplicité, le non-dit, le mystère. Ça pourrait être ennuyeux et glacé, c’est puissant et évocateur, traversé par des courants de vie, des lignes de force, le feu sous le givre. Lorsque les temps sont durs, la fantaisie est un refuge. Le lecteur a pu profiter ces dernières années d’univers farfelus, poétiques, gentiment barrés, le plus souvent placés sous les figures tutélaires de
Lorsque les temps sont durs, la fantaisie est un refuge. Le lecteur a pu profiter ces dernières années d’univers farfelus, poétiques, gentiment barrés, le plus souvent placés sous les figures tutélaires de