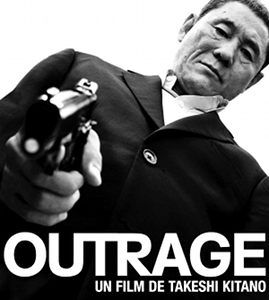de David Yates.
 Bon alors, quelles nouvelles du front Potterien ? Il faut avouer que pas grand chose en fait. Dumbledore est mort, Harry and Cie doivent retrouver des objets possédant chacun un bout de l’âme maléfique de Voldemort. S’ensuivent interrogations, états d’âme, bastons à gogo.
Bon alors, quelles nouvelles du front Potterien ? Il faut avouer que pas grand chose en fait. Dumbledore est mort, Harry and Cie doivent retrouver des objets possédant chacun un bout de l’âme maléfique de Voldemort. S’ensuivent interrogations, états d’âme, bastons à gogo.
C’est toujours David Yates qui est aux commandes, on reste donc bien dans la continuité des deux épisodes précédents. Malheureusement, l’histoire nous tient ici éloigné de Poudlard. Dans le livre, ça ne posait aucun problème, J. K. Rowling a suffisamment de talent pour tenir son intrigue à bout de bras, quelque soit le décor. Yates a un peu plus de mal, le film accumule les décors (tous extraordinaires, il faut le reconnaître et visuellement magnifiques), et peine à trouver une cohérence. C’est ballot d’autant plus que, scindé en deux films, Yates pouvait consolider son scénario, et lui donner le temps de se mettre en place.
Mais curieusement il préfère (outre les inévitables scènes d’actions, vraiment bonnes dans l’ensemble) réaliser un film contemplatif, qui interroge plutôt les sentiments de ces adolescents bien montés en graine (jolie scène sous la tente entre Hermione et Harry), que leur quête des reliques maléfiques. Pari risqué, et partiellement réussi.
Ce qui est assez culotté dans le cinéma de Yates, c’est d’oser un film réellement sombre, crépusculaire, qui n’a vraiment rien à voir avec les tout premiers épisodes. Le monde de la magie devient un monde totalitaire, dominé par des forces obscures et on n’échappe pas aux scènes de torture, d’épuration ethniques. On commençait à entrevoir cette situation (mais uniquement au sein de Poudlard) dans L’Ordre du Phénix, l’échelle change ici, et ce sont toutes les strates de la magie qui sont touchées.
Dans le rang des points positifs, on peut citer un flash-back en forme de scène d’animation absolument sublime dans le film, des ombres chinoises vraiment belles. Autant vous le dire, on reste quand même sur sa faim, mais il aurait sans doute été décevant de ne pas l’être, la deuxième partie devant sortir dans quelques temps. Un épisode mi-figue mi-raisin donc, mais qui devrait trouver sa cohérence avec sa suite et fin.