de Juli Zeh.
 Blablablablabla. Ouf, voilà ma pavasse des vacances achevée, et j’en suis assez contente. Pas du livre, mais d’avoir pu le terminer rapidement grâce à quelques heures de liberté. En 2007 paraissait donc La fille sans qualités, épais roman contemporain écrit par une jeune avocate allemande et bourlingueuse, Juli Zeh. Je me souviens vaguement d’avoir entendu parler du bouquin à l’époque, il me semble qu’il avait fait sensation. Mouais.
Blablablablabla. Ouf, voilà ma pavasse des vacances achevée, et j’en suis assez contente. Pas du livre, mais d’avoir pu le terminer rapidement grâce à quelques heures de liberté. En 2007 paraissait donc La fille sans qualités, épais roman contemporain écrit par une jeune avocate allemande et bourlingueuse, Juli Zeh. Je me souviens vaguement d’avoir entendu parler du bouquin à l’époque, il me semble qu’il avait fait sensation. Mouais.
Le projet de Juli Zeh ne manque pas d’ambition. Au moyen de personnages en apparence anodins (des lycéens et des profs), mais en réalité “bigger than life”, l’auteur s’est lancée dans l’entreprise couillue de décrire une génération, la génération post-11 septembre, post-guerre en Irak. La voilà donc qui met en scène ses protagonistes dans un jeu machiavélique. Ada et Alev, deux lycéens, manipulent avec dextérité un professeur de sport gentil comme tout. Ça finit mal nous dit le quatrième de couverture pour nous allécher (un “bain de sang”), en fait tout ça finit plutôt très bien si on considère la perversité des personnages. Du coup, mon esprit malsain a poussé un petit soupir du genre “tout ça pour ça” après avoir refermé le livre.
Ada, c’est la fille sans qualités du titre. Sans qualités à prendre plutôt dans le sens de in-qualifiable, c’est à dire impossible à qualifier. Grosso modo, Ada se définit comme un produit du nihilisme et de l’Histoire, une nouvelle étape de l’évolution de l’espèce humaine (rien que ça) qui ne croit en rien, à qui tout est égal, ou plutôt à qui tout est équivalent. Dans ce désert de désirs, la seule alternative possible pour secréter de l’adrénaline est le jeu, un jeu dangereux dont les règles sont inventées au fur et à mesure par l’impuissant (au sens physique du terme) Alev. Dans ce qu’Ada et Alev considèrent comme un désert intellectuel, peuplé de “princesses”-cruches ou de rockers-déjàdépassés, leur brillante intelligence laisse tout le monde KO, et ils en jouent comme de petits démons.
L’ambition de Juli Zeh est donc immense de vouloir décrire une nouvelle génération d’adolescents, revenus de tout, déjà vieux avant d’être
jeunes, enfants de familles malmenées, qui ont dépassé le stade de la carapace de protection contre l’extérieur pour une absence totale de désirs, de croyances ou de sentiments. L’idée n’était pas mauvaise, malheureusement, la réalisation l’est beaucoup plus. J’avoue déjà avoir du mal à trouver de l’intérêt dans ces personnages “bigger than life”, à l’intelligence ultra-développée qui ne parlent que par sous-entendus qu’eux seuls et l’auteur peuvent comprendre, contrairement à la pauvre cervelle du lecteur moyen. Juli Zeh est probablement brillante, mais pas suffisamment pour qu’on y croit vraiment. Les dialogues sont faussement profonds, laborieux et au final assez mauvais. Par ailleurs, Zeh est affligée d’une tare que je croyais franco-française : le recours à la référence culturelle à outrance. C’est plombant de se voir imposer une culture qui n’est pas la nôtre (pas la mienne en tous cas) à longueur de pages. Ça rebuterait presque de se plonger dedans. Mais surtout, le principal défaut de La fille sans qualités, c’est sa totale absence de style. Quelle lourdeur, quel verbiage, que de blabla pour rien. Le même livre réduit au tiers aurait été nettement plus intéressant, mais Zeh dans sa folle ambition d’écrire un grand roman contemporain se plaît à en rajouter des tonnes, et ce, dans un néant stylistique abyssal.
On lit le livre en serrant les dents, à la recherche d’une seule phrase un peu bien écrite qui montrerait qu’il y a une écrivain sous cet épais manteau de mots. Mais non. Et c’est dommage. Il y a dans ce livre des idées, de la culture, de l’ambition, mais pas encore d’écriture. A voir ce que son nouveau roman va nous raconter sur l’évolution littéraire de la demoiselle.
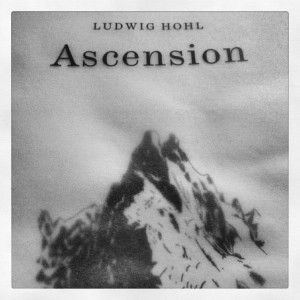 Bel objet que ce livre publié par les Editions Attila. Ascension relate la joyeuse randonnée en montagne de deux alpinistes, un chevronné, l’autre moins. Dans des conditions météorologiques déplorables, ils tentent d’atteindre un sommet inaccessible. Les deux hommes ont des caractères et des motivations différentes. Leurs antagonismes se matérialisent dans des conditions d’ascension impossibles.
Bel objet que ce livre publié par les Editions Attila. Ascension relate la joyeuse randonnée en montagne de deux alpinistes, un chevronné, l’autre moins. Dans des conditions météorologiques déplorables, ils tentent d’atteindre un sommet inaccessible. Les deux hommes ont des caractères et des motivations différentes. Leurs antagonismes se matérialisent dans des conditions d’ascension impossibles.


