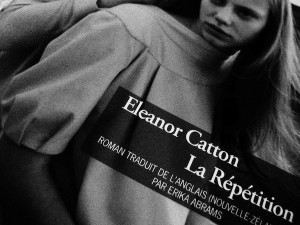de Tuomas Kyrö.
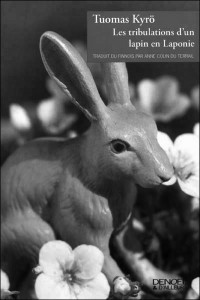 Curieux livre que ces tribulations qui valent mieux que leur titre français. Hommage au Lièvre de Vatanen d’Arto Pasilina (que je n’ai pas lu), le roman de Tuomas Kyrö, sans être un grand livre, n’en est pas moins intéressant. Notre héros, Vatanescu, est un roumain fauché, un peu candide, qui veut offrir des chaussures à crampons à son fils. Mais en Roumanie il n’en est pas vraiment question. Vatanescu choisit alors de se mettre sous la coupe de Iégor Kugar et de faire le mendiant pour lui et son réseau de trafiquants d’êtres humains dans les rues d’Helsinki. Mais la situation ne lui convient pas, et suite à un coup d’éclat (qui plongera d’ailleurs Iégor Kugar dans un insondable trou noir personnel et professionnel), Vatanescu s’enfuit, et vogue de rencontres en péripéties toutes plus incongrues les unes que les autres. En parallèle, et sans qu’il s’en rende compte le moins du monde sa côte de popularité, boostée par le net, grimpe en flèche et il devient une véritable star finlandaise.
Curieux livre que ces tribulations qui valent mieux que leur titre français. Hommage au Lièvre de Vatanen d’Arto Pasilina (que je n’ai pas lu), le roman de Tuomas Kyrö, sans être un grand livre, n’en est pas moins intéressant. Notre héros, Vatanescu, est un roumain fauché, un peu candide, qui veut offrir des chaussures à crampons à son fils. Mais en Roumanie il n’en est pas vraiment question. Vatanescu choisit alors de se mettre sous la coupe de Iégor Kugar et de faire le mendiant pour lui et son réseau de trafiquants d’êtres humains dans les rues d’Helsinki. Mais la situation ne lui convient pas, et suite à un coup d’éclat (qui plongera d’ailleurs Iégor Kugar dans un insondable trou noir personnel et professionnel), Vatanescu s’enfuit, et vogue de rencontres en péripéties toutes plus incongrues les unes que les autres. En parallèle, et sans qu’il s’en rende compte le moins du monde sa côte de popularité, boostée par le net, grimpe en flèche et il devient une véritable star finlandaise.
Le roman est tout d’abord assez rigolo. Notre héros, gentiment naïf, survit à toutes les situations grâce à son idée fixe, acheter des chaussures de foot à son fils. Ce leitmotiv lui sert à toujours avancer dans son aventure rocambolesque. Choisir un roumain comme héros est pour le moins sympathique et d’actualité de la part de l’auteur. C’est même assez culotté. Le renversement de situation final (que je ne vous raconte pas), mais en évidence toute la subjectivité du regard : celui qu’on ne considérait que comme un mendiant tout en bas de l’échelle sociale, voire qu’on ne considérait pas du tout, devient en symbole de réussite sociale et humaine.
L’auteur porte par ailleurs un regard tout à fait aiguisé sur la société moderne, et sur les personnes qui la compose. Kyrö, avec un rythme tout à fait soutenu, décrit un monde et des gens uniquement par le biais de leur réussite sociale et professionnelle, ou des biens matériels qu’ils possèdent. Cette société apparaît finalement vide de sens, et même notre gentil Vatanescu n’a qu’une envie, c’est de rentrer dans le système. Et même la scène finale, pourtant mignonne et tendre comme tout, se révèle assez triste, puisque même si elle traite de sentiments et d’amour, il y est encore question de possession et de l’équation bonheur=avoir.
Un roman donc plus profond qu’il n’y paraît sous ses aspects loufoques et son titre pas très engageant.
Ed. Denoël et d’ailleurs
Traduit du finnois (je souligne parce que ce n’est quand même pas courant courant) par Anne Colin du Terrail