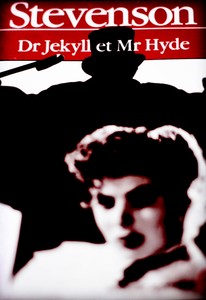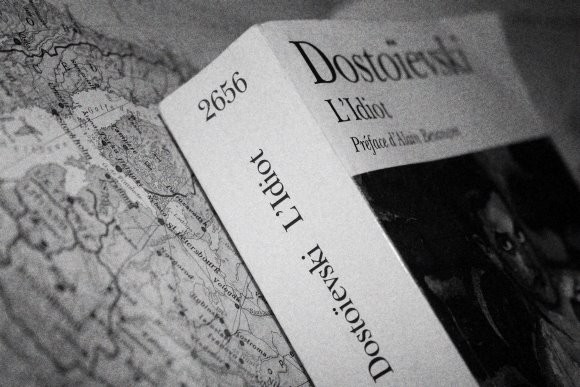de Victor Hugo.
Il n’est jamais trop tard pour combler ses lacunes culturelles. Notre-Dame de Paris fait partie des romans qu’on croit connaître par coeur alors même qu’on n’en a jamais effleuré la couverture. Monument donc, à peu près aussi écrasant que la belle dame qui lui donne son titre.
Autant dire que les débuts de la lecture sont laborieux. La père Hugo n’y va pas avec le dos de la bêche et veut faire de son roman un essai sur le massacre de l’architecture parisienne depuis la fin du XVème. C’est incroyablement érudit, majestueux et surtout très long. Pas facile de ne pas soupirer à la description de chaque tuile de chaque toit de chaque immeuble de chaque rue de chaque quartier de Paris, ainsi que le devenir au XIXème de chaque tuile de chaque toit de chaque immeuble de chaque rue de chaque quartier de Paris. On tique un peu aux petits piques misogynes du sieur (Prenez patience mesdames, je sais bien que l’architecture vous dépasse, et que vous soupirez après la romance…), mais on serre les dents : on voulait du classique, on en lira jusqu’à la dernière ligne.
Cependant, après quelques centaines de pages un peu difficiles, Hugo laisse tomber son pamphlet pour dérouler son intrigue au petit poil. Il s’auto-laisse prendre à sa trame délirante, et oublie bien vite ses rancoeurs architecturales. Et vas-y que ça court dans tous les sens, que ça crie, que ça s’aime, que ça se tue. C’est un festival. Plus belle la vie, à côté, c’est du Moravia. C’est peu dire qu’Hugo à le génie de l’intrigue. Et d’ailleurs je vais essayer de vous raconter ça en quelques lignes, mais en mettant ça dans l’ordre chronologique, du coup, ça va vous casser un peu le suspense.
Chantefleurie est prostituée à Reims . Elle donne naissance à une magnifique gamine qu’elle adore, mais qui lui est dérobée par des gitans, et remplacée par un petit gamin hideux. Folle de douleur, elle bazarde le môme borgne, bossu et boîteux, et part se faire recluse à Paris, sous le nom de Gudule. Quinze ans plus tard, la gamine volée est une magnifique danseuse des rues à Paris et se fait appeler Esmeralda, elle est gentille mais très quiche. Le monstrueux gamin a été recueilli par Frollo, l’archidiacre de Notre-Dame, et sonne les cloches de la cathédrale jusqu’à s’en faire littéralement péter les tympans. Il se nomme Quasimodo, et comme Garou a interprété ce personnage, on n’a déjà pas un a priori positif (on espère pour lui d’ailleurs qu’il avait également quelques problèmes d’audition). Évidemment comme la Esmeralda elle est très belle, tout le monde est amoureux d’elle, surtout l’archidiacre, qui en sa chasteté souffre les mille morts, et le sonneur, qui est quand même un chouia maladroit avec les filles. Malheureusement la gitane aime un chevalier, Phoebus, beau et con à la fois, qui ne lui rend pas forcément très bien. Frollo désespéré essaie de tuer l’apollon, mais c’est Esmeralda qu’on accuse et qu’on jette dans un cul de basse fosse. L’archidiacre tente de la faire évader, elle refuse, et c’est Quasimodo qui raflera la mise, en l’enlevant et en faisant de Notre-Dame sa terre d’asile. Hélas, le refuge ne pouvait durer, la belle est enlevée par l’archidiacre, mais se refuse toujours à lui. Dépité, il la confie à la bonne garde de Gudule, qui déteste les gitans depuis qu’ils lui ont volé sa fille. Mais l’amour succède à la haine chez Gudule, qui reconnaît en Esmeralda la fille qu’on lui avait arraché quinze en plus tôt. Elle cache son enfant des yeux des soldats. Hélas, Esméralda entend la voix de son Phoebus et se jette hors de sa cachette (je vous avez dit qu’elle était quiche). Elle est prise et pendu. Frollo est soulagé, Quasimodo désespéré, Gudule écrabouillée, et Phoebus se marie.
Alors ça louche ça ? Et encore, je vous ai gravement résumé, il y a près de 700 pages, et quelques autres personnages clés, dont une petite chèvre toute mignonne, un poète maudit, et une fiancée jalouse. Bref, Hugo a beau vaguement méprisé le genre romanesque par rapport à la réflexion pure, Notre-Dame de Paris convainc beaucoup plus par son intrigue et son style échevelés et ses rebondissements énormes, que par son prétexte historique. Un bien beau moment, qui à quelques longues longueurs près, se dévore d’un traite en s’arrachant les cheveux, et en les broyant entre ses dents. Encore, encore !