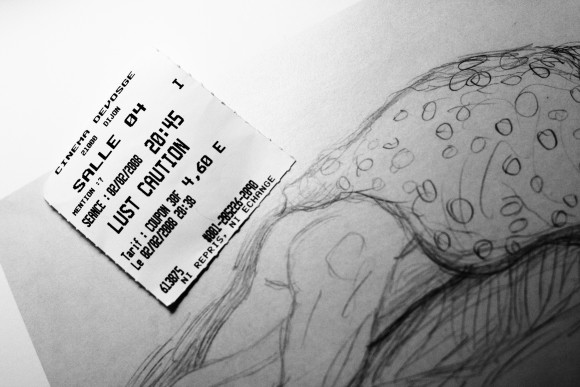de Sean Penn.
Quand les films que l’on voulait voir disparaissent de l’affiche en moins d’une semaine, il reste les films qu’on avait pas très envie de voir, c’est le cas de celui-ci. Fort heureusement le film vaut bien mieux que sa consternante bande-annonce. On est loin du film d’aventures qui va à cent à l’heure. Bien au contraire, Penn ne fait aucune concession en ce qui concerne le temps, le film s’étale largement dans ses plus de 2h30 de pellicule. L’odyssée du gars (véridique) a duré deux ans, et ses ramifications plongent profondément dans le passé, le film prend donc ses aises pour laisser s’installer les sensations et les émotions. Cette large plage temporelle donne lieu à un montage intéressant, mêlant habilement les différentes époques, révélant le passé au compte-gouttes (les flash-back sont vraiment intéressants), pour mieux éclairer le présent.
Chris, un jeune bourgeois américain, lâche famille, carrière et amis pour partir, le nez au vent en quête de l’Alaska. Si au premier abord, la démarche initiale de Chris semble relever d’un idéalisme romantique et littéraire, son rejet total de la société, son anti-matérialisme primaire sont finalement des actes éminemment politiques, surtout dans un pays comme les Etats-Unis. Plus le film passe, plus la fuite de Chris se révèle profonde, son refus de la société cache en fait un rejet de ses parents, dont les mensonges et les disputes ont progressivement fait voler en éclat l’identité initiale du jeune homme. Le personnage prend alors un peu plus d’épaisseur, il ne s’agit plus seulement d’une fuite romantique d’un jeune bourgeois en quête d’aventures, mais une reconstruction de soi, un apprentissage par la solitude choisie. Il est dommage que l’acteur principal soit si lisse, et propret, il manque singulièrement de profondeur.
Malgré quelques « trucs et astuces » assez agaçants, Penn réussit quelque chose de vraiment beau, notamment grâce à une photographie superbe, refusant systématiquement tout réalisme (sauf dans les scènes finales, mais chuuut) et magnifiant les paysages croisés. Chris est dans son « trip », la nature est sa force, c’est sa beauté qu’il voit et nous transmet. On peut également saluer les quelques seconds rôles certes un peu archétypaux, mais singulièrement bien interprétés (un petit coup de coeur pour Catherine Keener et Hal Holbrook). Ces personnages très secondaires permettent de ne pas faire sombrer Chris dans un héroïsme sans tâche. C’est leur présence qui révèle l’égoïsme assez écrasant du gars. Son rejet du monde, c’est aussi un rejet des gens qui l’aiment et qui souffrent de sa disparition.
Bon on va pas se mentir non plus, Into the wild reste un film hollywoodien, mais il faut avouer que c’est assez joli et que je ne me suis pas ennuyée, c’est déjà pas mal.