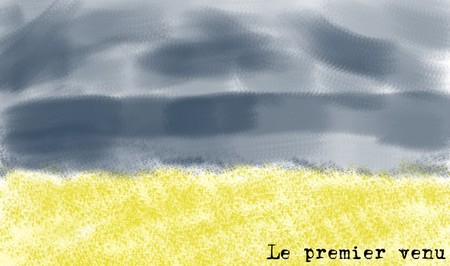de Liu Bingjian.
Voilà un bidule assez curieux et tranchant nettement avec ce que j’ai pu voir plus ou moins récemment dans le cinéma asiatique. Ici, pas de photo clipesque, de musique douce, de décors millimétrés, mais une façon plus frontale et assez crue d’aborder son sujet. Derrière le titre un peu mélo, se cache un film à la fois drôle, dynamique et poignant, et pour tout dire vraiment moderne.
Mme Wang, ex-chanteuse d’opéra d’une petite ville de province, jolie mais pour tout dire un peu pouf, vend des CD et des DVD pornos à la sauvette dans un Pékin franchement pas glamour. Pendant ce temps, son mari joue, perd et crève l’oeil d’un de ses camarades de jeu. C’est ballot, le voilà en prison, et Madame est contrainte de retourner dans sa ville natale. Elle y retrouve son ex-futur amant, qui lui trouve un bon job : elle sera pleureuse professionnelle dans les enterrements colorés et traditionnels de la ville.
Plutôt que de faire un film frontalement social, Bingjian se concentre sur un très beau portrait de femme et révèle en passant de grosses fractures dans la société chinoise, schizophrène entre tradition et fuite en avant capitaliste. Elle est surprenante son héroïne, poupée trop maquillée, et mal fagotée de couleurs flashys, vulgaire, qui alpague le chaland pour vendre ses pornos. La découverte en creux de son passé et ses actes révèlent une femme aux espoirs brisés, faite pour briller dans les opéras ou sur les DVD qu’elle vend à la sauvette. Mais elle est là, elle avance, se sert du système traditionnel pour réussir dans le monde moderne et gagner de l’argent. Elle se sacrifie (physiquement et professionnellement) pour son mari, et sa dureté masque quelqu’un, qui, finalement, n’aurait jamais fait que suivre ses sentiments amoureux.
Ce qui force le respect, c’est la concision du propos de Bingjian, aucune digression, la caméra se concentre sur l’essentiel, sans aucun pathos, sans explication, sans jugement. Le début est d’ailleurs quasi-documentaire, assez âpre, et progressivement, la caméra se pose, s’éloigne, sait trouver des cadres très beaux et très intelligents. Réalisé en 2002, et sans autorisation, le film a une liberté de ton vraiment étonnante. Un bon moment.