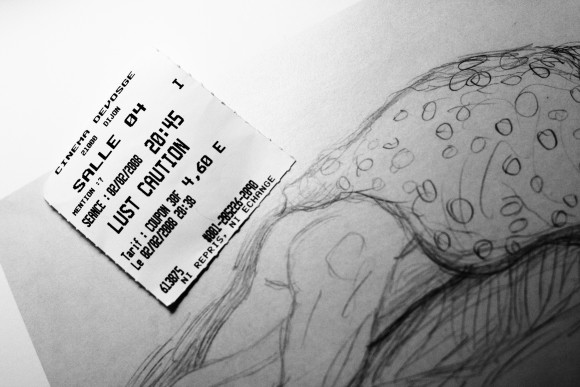d’Ang Lee.
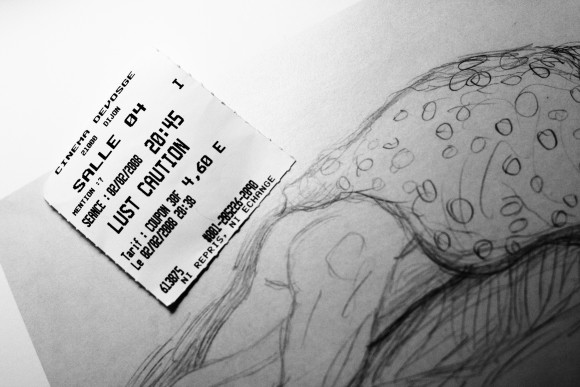
(dessin de Klimt, « Papiers érotiques », publié aux éditions Gallimard, j’vous conseille)
Encore toute à mon souvenir lacrymal de Brokeback Mountain, je suis allée voir Lust, Caution, sans en savoir grand chose, et avec une bonne dose de méfiance, les critiques étant pour le moins mitigées. Mes doutes ont été levés très vite, tant la douceur, la fluidité, la justesse de la caméra d’Ang Lee font absolument merveille. Comme dans Brokeback mountain, on a l’impression que cette caméra réussit à toujours être exactement à la bonne place, sans voyeurisme, sans distance excessive. Juste là où elle doit être. C’est virtuose sans crânerie, humble et très cinématographique.
Shanghaï pendant l’occupation japonaise. Mme Mak joue au Mah Jong chez Mme Yee. Sourires de société, les femmes parlent, trompent leur ennui en perdant de l’argent. M. Yee fait un passage éclair. Soudain, Mme Mak se rappelle un rendez-vous et s’éclipse. Dès ce moment là, le spectateur est électrisé. Quelque chose s’est passé. En un regard. Puis débute un grand flash-back, on pourrait même dire que c’est la séquence d’introduction qui constitue le flash-forward. Petite introduction pour appâter le spectateur sur l’origine et le dénouement de cette histoire. Quatre ans plus tôt, Mme Mak, n’est pas Mme Mak, mais Wang, une jeune étudiante à Hong-Kong. Pour l’effort de guerre, elle rentre dans une troupe de théâtre engagée dans la propagande nationaliste (belle réflexion sur l’art comme outil au service de la lutte, comme catalyseur des volontés) . Son talent d’actrice vite prouvé, la troupe s’engage dans une action clandestine, tuer M. Yee, chef de la milice ou un truc comme ça, mais surtout sympathisant avec les nippons. M. Yee est incroyablement prudent, et l’approcher est difficile. Wang est toute désignée pour faire amie-amie avec Mme Yee, afin d’approcher M.Yee. Après quelques bouleversements historiques et un retour à Shanghaï, Wang devient la maîtresse infiltrée de Yee, leurs rapports sont troubles, violents, SM, mais en même temps absoluments passionnés, amoureux et même romantique. Yee confie une mission secrète à Wang, branle-bas de combat dans les rangs de la résistance. La mission est en fait le choix d’un diamant chez un bijoutier…
Le film est émaillé de scènes sublimes, parfois fugaces (Wang sort la tête de la fenêtre d’un bus pour attraper une goutte de pluie avec la langue), parfois plus longues. Dans un restaurant japonais, Wang chante une chanson d’amour chinoise à Yee. Acte de résistance, acte d’amour. D’abord éloignée de lui, comme sur scène, elle s’approche doucement. Le sourire, amusé, ironique, condescendant de Yee devant sa « geisha », change au fur à mesure de l’approche de Wang, pour finir dans la douceur et les larmes. Un magnifique moment de cinéma. Lust, caution, est un film tout en réflexions, réflexions des miroirs, des vitres, de verres de vin, ou du diamant final. Les gens ne sont pas ce qu’ils semblent être, juste des reflets d’eux-mêmes, des pantins, des comédiens, qui ne vivent pas leur vraie vie, mais la vie que l’Histoire leur impose. Dans la scène du restaurant japonais, il n’y a pas de miroir, pas de vitre, pas de verre, mais des murs de papier et des bols. Yee est maintenant seul face à sa maîtresse, seul face à lui-même, à ses sentiments réels. Pas de double en réflexion, juste la nudité de l’être.
Outre une magnifique histoire de passion amoureuse trouble, sado-masochiste (Wang, d’abrd dominée, réussie à prendre le dessus, en plongeant dans le noir son partenaire, terrorisé par l’obscurité), Lust, Caution, raconte la façon dont l’intime peut bouleverser l’Histoire, et comment l’Histoire peut bouleverser l’intime. Il est ridicule de réduire ce film à ses quelques scènes de cul, comme il était ridicule de réduire Brokeback… à la scène se déroulant sous la tente. Ces scènes, certes capitales (le corps de Wang, d’abord envahi par l’ennemi, puis, de plus en plus maîtresse, dominante), instructives (je ne suis même pas sûre que certaines positions soient dans le Kâma Sûtra), ne sont que la matérialisation corporelle d’un conflit intime et historique beaucoup plus ample. Et finalement c’est souvent le thème des films de Lee, la difficulté d’exister tel qu’on est vraiment. Respect.