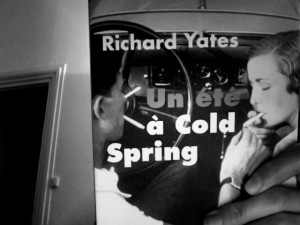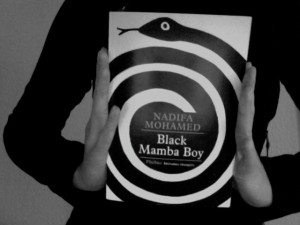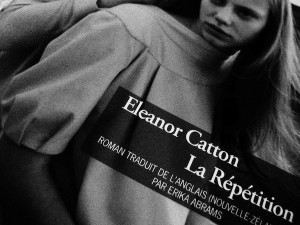de Laura Kasischke.
 Enorme coup de coeur pour ce roman huilé d’une précision sidérante et baladant le lecteur d’une certitude à son exact opposé en seulement quelques paragraphes.
Enorme coup de coeur pour ce roman huilé d’une précision sidérante et baladant le lecteur d’une certitude à son exact opposé en seulement quelques paragraphes.
Un étudiant du genre gentiment fumiste, Craig, intègre grâce à un passe-droit une université prestigieuse. Il a pour colocataire le provincial et coincé Perry, engoncé dans ses chemises amidonnées. Entre les deux, au départ, ça n’est pas tout à fait ça. Mais quand Craig tombe amoureux de la belle et virginale Nicole, originaire du même bled que Perry, les rapports entre les garçons se compliquent encore, et oscillent entre haine et amitié. La deuxième année d’université, les cartes sont rebattues : Nicole est morte dans un accident de voiture provoqué par Craig, Shelly, seul témoin de l’accident, ne trouve personne pour écouter sa version des faits, et Perry semble plonger dans des préoccupations morbides en suivant les cours en thanatologie de l’anthropologue Mira (alter ego pas franchement masqué de Laura Kasischke elle-même).
Si le roman commence chez Lynch, puis se poursuit comme un teen-novel particulièrement affûté, il dérive progressivement et s’amuse à naviguer entre fantastique, épouvante et thriller. Le merveilleux, lumineux et poudreux du début, s’obscurcit rapidement. Grâce à sa construction éclatée entre les histoires des quatre personnages principaux (Craig, Perry, Shelly et Mira) et éclatée temporellement, le lecteur reconstitue le puzzle progressivement. Mais dès qu’une pièce du puzzle se met en place, Laura Kasischke prend un malin plaisir à couper l’herbe sous nos pieds, et à faire basculer son récit. C’est absolument passionnant et magistral. Chaque pièce, parfois volontairement répétitive, semble s’imbriquer dans la précédente, mais déstructure finalement complètement l’ensemble.
L’auteur utilise comme cadre idéal de sa construction une antique université américaine. Dans ce lieu de culture et d’apprentissage, son scénario use des clichés, les met à mal ou au contraire les amplifie. La faculté est ainsi peuplée d’étudiants tous “interchangeables” au-delà de leurs différences : jolies filles aux cheveux lisses, garçons étonnamment absents hors les deux héros. Dans cette masse de clones post-adolescents, on a l’impression d’être dans le village des damnés dix ans après. De quoi sont capables ces filles magnifiques, derrière leurs sourires virginaux ? Surtout quand elles appartiennent à une de ces sororités ultra-secrètes qui cultivent le goût du mystère ? On finit par se demander si ces revenants vers lesquels nous amène le titre du livre, ne sont pas en fin de compte ces monstrueux clones estudiantins, plutôt que de classiques fantômes.
Dans le monde de Kasischke, on ne peut pas faire confiance à grand monde, et surtout pas à l’auteur. Les situations de grande joie (un amour inconditionnel, une incroyable partie de baise, un mystère à éclaircir) se retournent systématiquement en horreur totale pour les personnages (tromperie, mort, licenciement, trahison), entraînés dans une spirale tragique de laquelle il n’est possible de réchapper que par la fuite. De là à voir dans Les revenants et le microcosme universitaire un miroir de la société américaine dans laquelle les réseaux annihilent toute tentative d’émancipation et de différenciation, il n’y a à mon avis qu’un pas.
Machiavélique machination, certitudes mises à mal, construction brillante, prose ciselée, le dernier roman de Laura Kasischke, usant de la symbolique et de la métaphore avec une cruelle intelligence, est un pur joyau littéraire de cette année 2011.
Ed. Christian Bourgois