de Sylvain Tesson
Nous cherchions les chemins noirs.
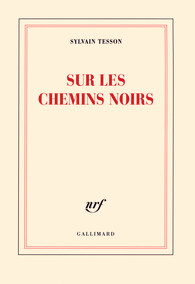 Conseillé avec ardeur, titillant mon amour éternel pour les cartes et les errances, ce livre avait tout pour me plaire. Sylvain Tesson a le corps en miettes après une chute. Il décide de traverser la France, telle que nommée par l’INRA “hyper-rurale”, par ses chemins oubliés, les “chemins noirs” des cartes IGN au 1/25000ème, chers aux randonneurs. Il part du Mercantour pour rejoindre le Cotentin, de temps en temps accompagné par des amis ou de la famille de passage ou croisant quelques locaux qui sentent bon le terroir avec leurs petits fromages et leur c’était mieux avant.
Conseillé avec ardeur, titillant mon amour éternel pour les cartes et les errances, ce livre avait tout pour me plaire. Sylvain Tesson a le corps en miettes après une chute. Il décide de traverser la France, telle que nommée par l’INRA “hyper-rurale”, par ses chemins oubliés, les “chemins noirs” des cartes IGN au 1/25000ème, chers aux randonneurs. Il part du Mercantour pour rejoindre le Cotentin, de temps en temps accompagné par des amis ou de la famille de passage ou croisant quelques locaux qui sentent bon le terroir avec leurs petits fromages et leur c’était mieux avant.
(…) c’était grande excitation de sillonner l’agencement délicat des terroirs français pour lui qui avait l’habitude des paysages où l’immensité écrasait tout espoir de variation.
L’idée est incroyablement sympathique, on aime d’emblée quelqu’un qui porte cette attention aux détails oubliés, aux failles isolées, aux détours dictés par le vide. Et par conséquent on aimerait aimer autant son livre. Malheureusement, ça ne fonctionne pas toujours. Il faut le dire, Sur les chemins noirs est bâclé. Comment raconter des mois de marche, de nuits à la belle étoile en seulement 140 pages ? La moitié du roman se passe en Provence, le reste de la France n’aura que quelques miettes. Quelques descriptions légères, l’évocation d’un énième viandox dans un énième café sur une place de village sous un énième tilleul, d’une énième conversation, tout semble survolé, parcellaire, lacunaire et finalement immatériel. L’impression est renforcée par cet omniprésent passé simple. Il engloutit tout sous un vernis usé et ampoulé. On renifle même quelques utilisations abusives et bancales. Le texte ressemble à un patchwork d’écrits de voyage, assemblés au moyen du passé simple comme colle de luxe de ces fragments épars.
C’est l’avantage des petits pays aménagés comme des jardins japonais.
Et puis, aucun doute, Tesson est un écrivain français. La moindre de ses pensées est ultra-référencée. Il y a un auteur sous chaque caillou. Chaque terroir a ses héros. On reconnaît même dans ses descriptions naturalistes quelques vidéos qui ont fait le buzz sur internet. Tesson, l’explorateur des forêts de Sibérie ne peut donc renier ses origines. Comme le jardin japonais dont toutes les formes sont maîtrisées, Tesson cherche dans les replis les plus obscures du petit pays aménagé qu’est la France, la familiarité et le réconfort dans l’invocation de ses maîtres. Je ne suis pas très sensible à ce type de dispositif.
Bien trop bancal, Sur les chemins noirs a bien du mal à maintenir son potentiel de sympathie intact jusqu’au bout. On est passé à côté du grand livre. D’assez loin.
Ed. Gallimard
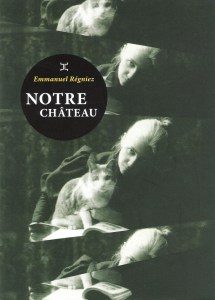 Octave et sa sœur, Véra, vivent reclus entourés de livres dans une vaste et belle demeure, héritage familial providentiel pour ces deux solitaires. Leur vie dans la maison est une succession de rituels : tous les jeudis il part acheter des livres à la librairie, le matin il prépare le petit-déjeuner, le soir il fait la lecture et parfois il couche avec sa sœur. Ils se sont créé un monde à eux, bâti sur les souvenirs de leurs parents disparus et sur les montagnes d’histoires dont ils se sont imprégnés, il est le prince, elle est la princesse, ils vivent dans un château.
Octave et sa sœur, Véra, vivent reclus entourés de livres dans une vaste et belle demeure, héritage familial providentiel pour ces deux solitaires. Leur vie dans la maison est une succession de rituels : tous les jeudis il part acheter des livres à la librairie, le matin il prépare le petit-déjeuner, le soir il fait la lecture et parfois il couche avec sa sœur. Ils se sont créé un monde à eux, bâti sur les souvenirs de leurs parents disparus et sur les montagnes d’histoires dont ils se sont imprégnés, il est le prince, elle est la princesse, ils vivent dans un château.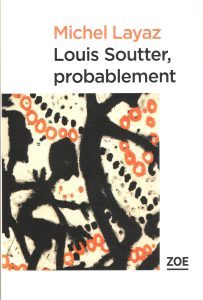 Il promène sa drôle de silhouette le long de ces pages, Louis Soutter, violoniste de formation, issu d’une famille aisée, un jour marié et installé, le lendemain (encore dans la force de l’âge) envoyé pour toujours à l’asile par sa famille. Là, Louis est malheureux, il s’enfuit, il revient, mais surtout il dessine et ses dessins l’ont fait entrer dans la postérité. Que s’est-il passé ?
Il promène sa drôle de silhouette le long de ces pages, Louis Soutter, violoniste de formation, issu d’une famille aisée, un jour marié et installé, le lendemain (encore dans la force de l’âge) envoyé pour toujours à l’asile par sa famille. Là, Louis est malheureux, il s’enfuit, il revient, mais surtout il dessine et ses dessins l’ont fait entrer dans la postérité. Que s’est-il passé ?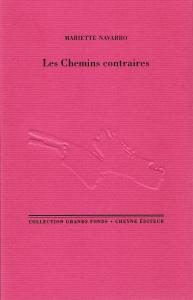 C’est une trajectoire qui sans faire de bruit s’enfonce dans la glace et, dans la chaleur du soleil, reprend son envol. C’est un mystère textuel, un miroir aux multiples facettes, un insaisissable poème en prose composé de deux parties radicalement opposées et pourtant intimement liées. La première entremêle deux voix. Celle d’un « Ils » d’abord. Ils, qui perdent leur chemin, se perdent eux-même, se font grignoter impuissants par le quotidien, et dont les liens aux autres se brisent insidieusement.
C’est une trajectoire qui sans faire de bruit s’enfonce dans la glace et, dans la chaleur du soleil, reprend son envol. C’est un mystère textuel, un miroir aux multiples facettes, un insaisissable poème en prose composé de deux parties radicalement opposées et pourtant intimement liées. La première entremêle deux voix. Celle d’un « Ils » d’abord. Ils, qui perdent leur chemin, se perdent eux-même, se font grignoter impuissants par le quotidien, et dont les liens aux autres se brisent insidieusement.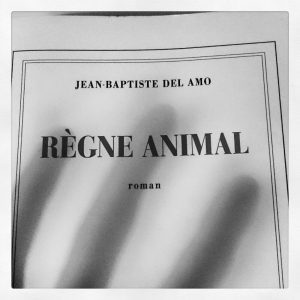 En pleine saison de l’Amour est dans le pré, après avoir vu Petit paysan au cinéma et avoir parlé en ces pages de
En pleine saison de l’Amour est dans le pré, après avoir vu Petit paysan au cinéma et avoir parlé en ces pages de