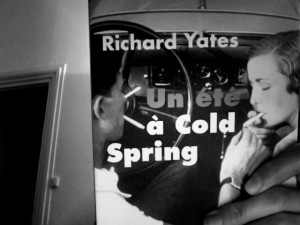de Michael Connelly.
 Quand on a la cervelle vidée, épuisée, éreintée, rien de mieux qu’un petit Michael Connelly pour se mettre sur off sans abandonner la lecture.
Quand on a la cervelle vidée, épuisée, éreintée, rien de mieux qu’un petit Michael Connelly pour se mettre sur off sans abandonner la lecture.
Michael Haller, avocat de la défense particulièrement roublard, se voit proposer le poste de procureur intérimaire dans une affaire vieille de vingt-quatre ans. Jason Jessup avait alors été condamné pour l’enlèvement et le meurtre d’une fillette. Des analyses ADN réalisées en 2010 jettent le doute sur la culpabilité de Jessup. Haller, aidé de son demi-frère Harry Bosch à l’enquête, est engagé pour conduire le nouveau procés visant à faire retourner Jessup en prison.
Petite déception pour The Reversal, après deux romans nettement plus intéressants sur le fond, L’épouvantail et Les neuf dragons. Dans The Reversal, Connelly cesse de s’interroger sur la notion de héros, de manipulation, pour revenir à un mélange plus classique entre roman procedural et policier.
Outre cette pointe de déception, force est de constater que Michael Connelly n’a rien perdu de son art de l’intrigue. Le roman est composé de courts chapitres alternant les points de vue de Haller et Bosch. Ca va vite, les rebondissements sont nombreux, et il est très difficile de fermer le livre. Le dénouement est à la fois attendu et satisfaisant (le méchant est vraiment méchant et il sera puni), mais curieusement amer. L’abri isolé que Jessup avait construit n’était ainsi pas destiné à séquestrer une nouvelle victime comme Bosch l’imaginait, mais bien à lui servir de refuge, de cocon, comme l’était sa cellule en prison. A la fois bourreau et victime, Jason Jessup, réussit également à s’immiscer dans la plus grande faille de la carapace de Bosch, son amour pour sa fille.
De l’art connellien pur jus et testostérone, avec la pointe d’humanité qu’il faut pour nous accrocher.
Ed. Orion