d’Eric Chauvier.
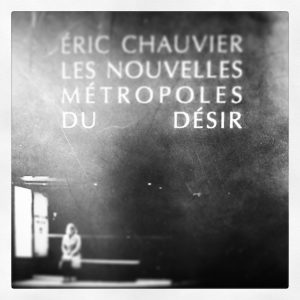 Vous qui entrez dans ce livre, laissez toute espérance ! Grande amatrice des errances psycho-socio-géographico-lexicalo-péri-urbaines d’Eric Chauvier, me voilà toute bousculée par ce texte sans pour autant pouvoir mettre immédiatement le doigt sur ce qui m’effraie à ce point là-dedans. Oui, ce qui m’effraie et d’ailleurs, il est beaucoup question de peur dans Les nouvelles métropoles du désir. Où plutôt de terreur. Une terreur à la spatialisation calculée, mais ça, on ne le comprendra qu’à la fin, n’allons pas trop vite.
Vous qui entrez dans ce livre, laissez toute espérance ! Grande amatrice des errances psycho-socio-géographico-lexicalo-péri-urbaines d’Eric Chauvier, me voilà toute bousculée par ce texte sans pour autant pouvoir mettre immédiatement le doigt sur ce qui m’effraie à ce point là-dedans. Oui, ce qui m’effraie et d’ailleurs, il est beaucoup question de peur dans Les nouvelles métropoles du désir. Où plutôt de terreur. Une terreur à la spatialisation calculée, mais ça, on ne le comprendra qu’à la fin, n’allons pas trop vite.
Voilà que je me perds une fois encore dans la contemplation de leur beauté – sublimation de la vérité urbaine.
Comme d’habitude chez Eric Chauvier, au commencement il y a le fait vécu, l’expérience. Ici, en centre-ville, un hipster se fait tabasser sans raison apparente par trois banlieusardes en furie. Eric Chauvier le suit dans un bar auquel j’aurais bien du mal à donner un qualificatif (on y passe des films sans le son, du tennis sans les bruits de balle, de la musique remixée plein pot et on y croise des gens super-lookés, ça vous dit quelque chose ? moi non, mais je suis un peu plouc et je n’aime pas la musique à fond). Dans ce bar, notre contemplatif contemple et dissèque, ou tente de disséquer, les comportements opaques d’ilôts d’humains branchouilles, tout en essayant vainement de commander une bière (ça c’est la running joke du livre). Viennent se greffer à sa contemplation pour le moins morne, des bribes de souvenirs, un apéro chez un ami d’enfance raciste, des ados qui manipulent des armes dans le bois d’un lotissement et bien sûr les trois furies.
Partout, domine l’impression que cette zone existe par défaut, telle l’antichambre d’une vie sociale qui serait ailleurs.
Parce que c’est ça en fait qui intéresse Eric Chauvier, essayer de comprendre ce qui a poussé ces trois filles à tabasser le gars qui ne faisait que passer. Il entame alors une réflexion « à la Chauvier », brouillant les frontières de l’histoire, de la géographie, de la sociologie et de la psychologie. Banlieue et péri-urbain (les abords, les périphéries) vs les centre-villes dans lesquels tout est calculé (y compris le look et les comportements de ses habitants) pour en faire ces « nouvelles métropoles du désir » dans lesquelles même les périphériques doivent ressentir une illusion d’appartenance construite et finalement factice. Bon, alors ici, on n’est clairement pas dans une grande révolution de la pensée, riches vs pauvres, la lutte des classes, le désir de posséder ce que la classe sociale « supérieure » possède, tout ça tout ça, on a déjà lu ça à toutes les échelles possibles, du local au mondial, de l’ancien à l’actuel. C’est bien fait, mais pas très nouveau.
C’est tout le problème : tout comme mon ami d’enfance, les trois furies détestent de façon viscérale ce qu’elles désirent. Seul le passage à l’acte les distingue.
Ce qui est bien plus intéressant par contre, c’est la façon dont Eric Chauvier met en lumière un processus de renversement de la terreur. Au passage à l’acte des trois furies (on peut y voir métaphoriquement tant de choses dans ce passage à l’acte terrorisant), il oppose la violence engendrée par la sophistication des hyper centres urbains et de leur faune (occidentale?). Par cette sophistication pleine, matérielle (les commerces, les marques, le look) ou immatérielle (la beauté), consciente ou inconsciente, la ville (contenant et contenu), qui accueille physiquement et s’abreuve de tout le sang qu’on lui injecte, renvoie à leur vide les « occupants des limbes », provoque le désir, suscite la détestation. Les plus chafouins me rétorqueront que tout ça n’est pas très nouveau non plus, pas très abouti et qu’il serait temps d’aller plus loin. Oui, certes, mais c’est quand même plutôt bien fichu.
Par leur comportement blasé, (les résidents épanouis des métropoles) appliquent les préceptes contenus dans l’étymologie du mot « territoire » : « droit de terrifier ». Les êtres sexy qu’ils pensent être ici deviennent parfois monstrueux là-bas, dans l’outre-ville d’où émanent d’indistinctes menaces.
En fait, je pense que ce qui me bouscule là-dedans, c’est que ce qu’Eric Chauvier raconte m’est viscéralement étranger. Je vois ce qu’il veut dire, je fais les mêmes constats, je pense qu’il a probablement raison sur beaucoup de choses. Mais moi je ne fonctionne pas comme ça et je me sens démunie face à la vision du monde (des mondes) qu’il décrit, je ne les appréhende pas, je les vois, mais je ne les vis pas. Tout ça manque cruellement d’amour et de lumière. Les nouvelles métropoles du désir est glaçant, un cercle vicieux, car que reste-t’il à sauver ? Où est passée l’humanité ? N’y a t’il pas le moindre espoir d’esquisser une solution ? A quoi sert un livre s’il ne sert pas à fracturer nos propres impasses ? Si la réflexion qu’il engendre nous fait nous cogner aux parois du bocal ? Comment survivre à cet étouffement ? Là tout de suite, je ne vois pas. Sans doute une petite chanson douce ?
Ed. Allia
PS : je parcours après avoir écrit ce texte quelques critiques sur ce livre parues dans des revues des vraies, surgit alors le mot « Réjouissant ». De l’hétérogénéité des perceptions.
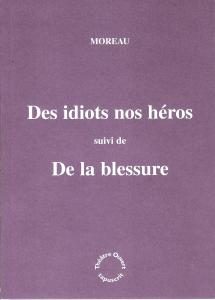 Une famille : deux frères, la mère et le père. De ces quatre-là, Moreau nous fait entendre la voix de trois. Un des garçons d’abord, « L’UN », qui parle à son frère, « l’autre », la mère ensuite et enfin le père.
Une famille : deux frères, la mère et le père. De ces quatre-là, Moreau nous fait entendre la voix de trois. Un des garçons d’abord, « L’UN », qui parle à son frère, « l’autre », la mère ensuite et enfin le père.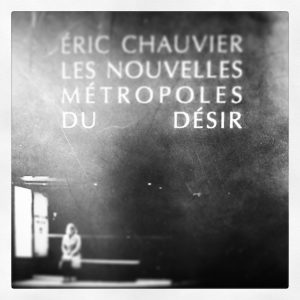 Vous qui entrez dans ce livre, laissez toute espérance ! Grande amatrice des errances psycho-socio-géographico-lexicalo-péri-urbaines d’Eric Chauvier, me voilà toute bousculée par ce texte sans pour autant pouvoir mettre immédiatement le doigt sur ce qui m’effraie à ce point là-dedans. Oui, ce qui m’effraie et d’ailleurs, il est beaucoup question de peur dans Les nouvelles métropoles du désir. Où plutôt de terreur. Une terreur à la spatialisation calculée, mais ça, on ne le comprendra qu’à la fin, n’allons pas trop vite.
Vous qui entrez dans ce livre, laissez toute espérance ! Grande amatrice des errances psycho-socio-géographico-lexicalo-péri-urbaines d’Eric Chauvier, me voilà toute bousculée par ce texte sans pour autant pouvoir mettre immédiatement le doigt sur ce qui m’effraie à ce point là-dedans. Oui, ce qui m’effraie et d’ailleurs, il est beaucoup question de peur dans Les nouvelles métropoles du désir. Où plutôt de terreur. Une terreur à la spatialisation calculée, mais ça, on ne le comprendra qu’à la fin, n’allons pas trop vite. Il a fallu attendre quatre années pour entendre à nouveau l’écriture de Philippe Malone. Après la déflagration Septembres, Krach vient confirmer son immense talent. Un homme tombe d’une tour, réelle, métaphorique. Sa chute est disséquée – effets, causes, lutte perdue d’avance, solitude face au grand tout.
Il a fallu attendre quatre années pour entendre à nouveau l’écriture de Philippe Malone. Après la déflagration Septembres, Krach vient confirmer son immense talent. Un homme tombe d’une tour, réelle, métaphorique. Sa chute est disséquée – effets, causes, lutte perdue d’avance, solitude face au grand tout.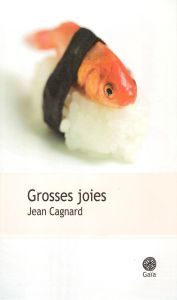 Un chien traverse la page, il n’a rien à faire là, mais il est là quand même. Le lecteur s’en étonne et le narrateur lui-même
Un chien traverse la page, il n’a rien à faire là, mais il est là quand même. Le lecteur s’en étonne et le narrateur lui-même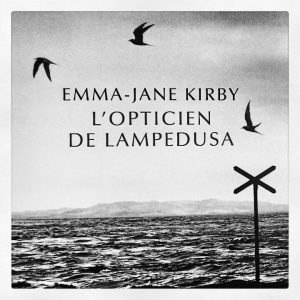 Impeccable, irréprochable, c’est ce qu’on se dit en posant avec émotion ce livre. C’est une histoire vraie, des paroles collectées par Emma-Jane Kirby, journaliste à la BBC. Mais ce témoignage, elle en a fait un livre, un roman. Le procédé pourrait être discutable, le résultat ne l’est pas. L’opticien de Lampedusa frappe juste.
Impeccable, irréprochable, c’est ce qu’on se dit en posant avec émotion ce livre. C’est une histoire vraie, des paroles collectées par Emma-Jane Kirby, journaliste à la BBC. Mais ce témoignage, elle en a fait un livre, un roman. Le procédé pourrait être discutable, le résultat ne l’est pas. L’opticien de Lampedusa frappe juste.