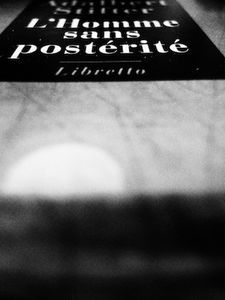de Tibor Déry.
 Extraordinaire petit livre que Niki L’histoire d’un chien. Seul roman traduit en français de Tibor Déry, auteur hongrois visiblement célèbre dans son pays, Niki est une véritable petit perle, et, en seulement 150 pages réussit à nous faire rire, pleurer et réfléchir.
Extraordinaire petit livre que Niki L’histoire d’un chien. Seul roman traduit en français de Tibor Déry, auteur hongrois visiblement célèbre dans son pays, Niki est une véritable petit perle, et, en seulement 150 pages réussit à nous faire rire, pleurer et réfléchir.
En 1948, début de la période communiste de la Hongrie, dans la campagne autour de Budapest, Niki une jeune femelle fox-terrier se donne à un couple de quarantenaires, les Ancsa, dont le fils unique est décédé. Résistant d’abord à cette intrusion affective dans leur vie, le couple finit cependant par s’attacher à cette chienne joueuse, et visiblement avide d’affection. Ils la rachètent à son maître officiel, trop content de se débarrasser de l’animal. Mais M. Ancsa, ingénieur des mines, est affecté à un poste à Budapest. Il passe quelque temps à faire les aller-retours entre leur domicile et la ville, avant que le couple ne puisse enfin déménager dans la capitale. A peine arrivés, et pour des raisons assez inexplicables, M. Ancsa est affecté ailleurs, dans un poste plus subalterne, puis à nouveau rétrogradé, avant de finir en prison, sans que personne ne puisse fournir aucune explication.
Tibor Déry ne raconte pas directement cette histoire, mais préfère se focaliser sur la chienne, ses comportements, ses sentiments supputés, mais jamais affirmés, et son évolution. Le livre est tout d’abord un formidable portrait de chien, tout comme l’était le délicieux Flush de Virginia Woolf. Pour qui a déjà cotoyé un cabot, les descriptions de la petite Niki sont criantes de vérité. Tibor Déry est un excellent observateur, et son personnage de chienne sent le vécu. Niki est délicieusement rigolote et attachante, et Tibor Déry, dans un style faussement emprunté mais véritablement amusé, prend un plaisir visible à faire évoluer sa petite créature.
L’histoire de la chienne n’est bien sûr qu’un prétexte à peine dissimulé à l’évocation du système stalinien dans lequel vivaient les hongrois jusqu’à la révolution de 1956. En 1953, Tibor Déry a été exclu du parti communiste, trois ans plus tard il écrit Niki et il est jeté en prison pour avoir été l’un des chefs du mouvement des écrivains qui a contribué à l’insurrection. Sous ses aspects légers, Niki est effectivement une critique virulente d’un système manifestement perverti. La chienne subit docilement les changements dans sa vie (de la campagne à la ville, la privation de liberté, la disparition de son maître, la poursuite par la fourrière) sans évidemment pouvoir comprendre leur origine. Elle finira par mourir prématurément, usée, résignée, sous une armoire. Victoire d’un système sur les individus qui le subissent. Tout comme la chienne, les Ancsa sont soumis à l’arbitraire, à l’humiliation, incapables d’avoir aucune prise sur les événements. Ils subissent, et font tout pour rester discrets. Leur seul acte de résistante est cette chienne, et l’affection qu’ils lui portent. Car avoir un chien dans ces temps de disette est bien un acte de résistance, qui leur sera d’ailleurs reproché.
Le ton faussement enjoué de Tibor Déry se mue peu à peu en récit poignant et bouleversant et fait de Niki une véritable petite perle de résistance et de révolte, un petit canidé de révolution. Un merveilleux classique.
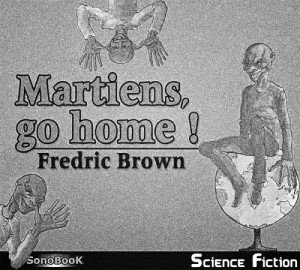
 Sous ce titre en forme de gag, se cache un excellent livre de Marco Mancassola. Imaginez que les super-héros existent vraiment, et ont vraiment, pendant des décennies, sauvé le monde. Aujourd’hui, ils sont vieillissants, dignes ou ridicules, reconvertis ou à la retraite. Mais une menace pèse sur eux, et un à un, ils se font tuer par un mystérieux groupuscule terroriste.
Sous ce titre en forme de gag, se cache un excellent livre de Marco Mancassola. Imaginez que les super-héros existent vraiment, et ont vraiment, pendant des décennies, sauvé le monde. Aujourd’hui, ils sont vieillissants, dignes ou ridicules, reconvertis ou à la retraite. Mais une menace pèse sur eux, et un à un, ils se font tuer par un mystérieux groupuscule terroriste.