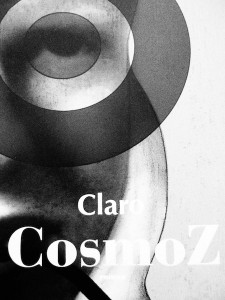de Denis Decourchelle.
 Un jour, vous recevez un livre dans votre boîte aux lettres. Un livre inconnu envoyé par quelqu’un que vous ne connaissez pas non plus. Et ce livre-là, qu’on a laissé reposer un peu sur la table de nuit, est ouvert un jour. On sait alors qu’on vient de faire une rencontre, que le livre inconnu et l’inconnu du livre ont touché du doigt quelque chose de profond contre lequel on n’a jamais cessé de lutter.
Un jour, vous recevez un livre dans votre boîte aux lettres. Un livre inconnu envoyé par quelqu’un que vous ne connaissez pas non plus. Et ce livre-là, qu’on a laissé reposer un peu sur la table de nuit, est ouvert un jour. On sait alors qu’on vient de faire une rencontre, que le livre inconnu et l’inconnu du livre ont touché du doigt quelque chose de profond contre lequel on n’a jamais cessé de lutter.
Après quelques pages d’introduction qui donnent un aperçu de son style magnifique, Denis Decourchelle dresse une liste d’une trentaine de personnages, dont les noms sont accompagnés de quelques repères biographiques. Dans les 120 pages qui suivent, nous croiserons tous ces personnages, qui se croiseront aussi, ou pas.
Tout est ligne et trajectoire dans La Persistance du froid, et les itinéraires de ces personnages sont l’occasion pour l’auteur de déployer son style, sa phrase. Car la phrase est longue, presque toujours, sinueuse, aux multiples bifurcations. On s’y perd parfois, on découvre toujours, on retombe sur ses pieds souvent, ou parfois il faut reprendre, reprendre cette vague, ce flux incessant, presque circulaire, qui donne et qui reprend. Et puis de temps en temps après s’être déployée, la phrase éclate, et nous crucifie. On sent que tout ce cheminement n’est pas vain, qu’il a été mis au point scrupuleusement pour nous amener juste au bord, au bord de l’émotion, de la compréhension, du vide.
Il y a quelque chose d’assez américain dans cette façon, très large, très englobante de retranscrire le monde, de le voir comme un tout, dans lequel tout est lié à tout, où les êtres, même sans se connaître, sont reliés par leur condition même d’humains, et leurs luttes quotidiennes. Et surtout il y a ce regard magnifiquement humaniste que Denis Decourchelle porte sur ses personnages, des personnages qui naviguent toujours dans les marges, ‘on the verge of’, qui marchent sur la frontière qui sépare les choses, et qui essaient de ne pas sombrer, de ne pas tomber, qui essaient d’échapper au froid. Ils y arrivent parfois, et parfois non.
Et on pense beaucoup à Richard Yates pour cette façon de ne pas juger, et d’amener le lecteur, par la force de la phrase, à comprendre, à ressentir et à aimer. Le style de Denis Decourchelle est bien sûr beaucoup moins dépouillé, son chemin est plus complexe, demande un certain engagement de la part du lecteur, du lâcher-prise aussi, de la disponibilité. Mais la récompense est à la hauteur de l’engagement.
La persistance du froid, oh titre sublime, m’a absolument ravagée, a appuyé juste là où ça fait mal, et c’est très beau, et ça fait du bien.
Ed. Quidam Editeur
 Pas lu de Boyd depuis quelques siècles, et ce n’est pas pour rien. Orages ordinaires n’a rien de honteux, mais ne rentre pas vraiment dans les catégories de livres vers lesquels mes goûts me portent de plus en plus.
Pas lu de Boyd depuis quelques siècles, et ce n’est pas pour rien. Orages ordinaires n’a rien de honteux, mais ne rentre pas vraiment dans les catégories de livres vers lesquels mes goûts me portent de plus en plus.