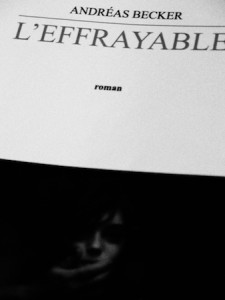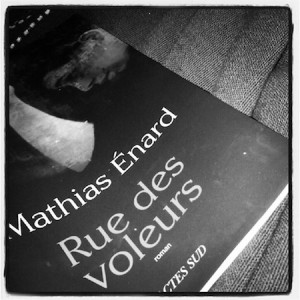d’Eric Chauvier.
 Nouvelle incursion dans l’univers d’Eric Chauvier après le fabuleux Somaland. Contre Télérama est un très court livre, écrit, du moins mis en forme et publié en réaction à un article paru dans Télérama et parlant de « La France moche », pour qualifier les zones périurbaines. Mais ce moteur, on ne le découvre qu’au milieu du livre. Contre Télérama est constitué de mots-clés, dont chacun donne lieu à une réflexion tenant sur une ou deux pages.
Nouvelle incursion dans l’univers d’Eric Chauvier après le fabuleux Somaland. Contre Télérama est un très court livre, écrit, du moins mis en forme et publié en réaction à un article paru dans Télérama et parlant de « La France moche », pour qualifier les zones périurbaines. Mais ce moteur, on ne le découvre qu’au milieu du livre. Contre Télérama est constitué de mots-clés, dont chacun donne lieu à une réflexion tenant sur une ou deux pages.
Chacune de ces “franchises individuelles”, qui – avec leur décoration neutre et standardisée – semblerait, pour ce journal de la capitale, tout aussi “moche” que les franchises commerciales, hébergent des fictions insondables et jamais sondées.
L’argument principal d’Eric Chauvier pour la “défense” de cette vie périurbaine consiste en la neutralité de ces zones. Leur “invisibilité” rend ces zones intéressantes car encore jamais explorées. Dans ces quartiers, la moindre discontinuité peut alors faire émerger l’interrogation, et donc titiller l’imagination et engendrer la fiction.
En se rendant réceptif à ces hurlements sauvages, l’adulte évite ici de flirter avec une tristesse sans nom. Il éperonne sa mémoire et produit des images, des odeurs et des sons qui délient son potentiel de fiction, autrement dit son aptitude à transgresser les standards de la vie mutilée.
La vie en zone périurbaine serait alors un moteur puissant grâce auquel les hommes, par le biais de la fiction pourraient apprendre à transgresser, à dépasser le cadre qui les entoure et qui les habite. L’uniformisation et la neutralité des lieux seraient le terreau fertile dans lequel la moindre anfractuosité permettraient aux habitants de déployer leurs capacités de fiction et donc sans doute d’atteindre un état d’éveil supérieur, impossible dans un contexte moins neutre.
Nos voix ne porteraient pas, et cette impossible conversion de l’intime en politique nous préoccupait au plus haut point.
Nous en avons parlé rapidement certes, mais il ne fait pas de doute que cette appétence pour la dissolution des causes pourrait constituer un principe majeur de la vie péri-urbaine.
Malgré tout, Eric Chauvier constate un phénomène préoccupant. Si la vie dans les quartiers périurbains permet à l’homme de développer sa capacité à voir et à imaginer, elle anésthésie pourtant sa capacité à agir et à prendre position. L’habitant, alors, est condamné à subir. Et quand il réagit, c’est forcément vis-à-vis d’une discontinuité, d’un élément non concordant avec son cadre. C’est ainsi que l’âne, habitant originel du quartier, est caillassé en pleine nuit car ses braiments dérangent le voisinage.
Tout autre choix de vie nous semblait faux et impraticable – définitivement impraticable.
Eric Chauvier ne délaisserait son mode de vie pour rien au monde, mais cette dernière phrase est aussi un couperet. Comment qualifier une vie, un mode de vie, qui empêche l’individu de se projeter dans autre chose ? L’aliénation est totale, et la zone périurbaine devient alors un lieu sacré, dans lequel il n’y pas besoin de prêcheur. Les habitants s’auto-convertissent, et la liberté gagnée d’imagination et de fiction, se paie par une diminution de la capacité de mouvement et d’intégration au réel.
Bien que formellement moins original et travaillé que le fabuleux Somaland, Contre Télérama montre à quel point la langue est une préoccupation majeure d’Eric Chauvier. Le texte est littérairement très travaillé, et c’est par le biais de cette langue que le lecteur, lui aussi est amené à bâtir sa fiction autour du texte. Jamais sèche, l’écriture d’Eric Chauvier laisse deviner tendresse et humanité à travers les apparitions fugaces de la vie des autres. Une voix passionnante et stimulante, dont j’ai bien l’intention de poursuivre la découverte.
Ed. Allia