de John D’Agata et Jim Fingal.
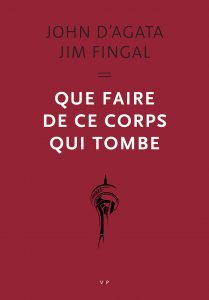 Il y a d’abord un adolescent, Levi, qui saute du haut d’une tour de Las Vegas. Il y a ensuite un auteur, John D’Agata, qui souhaite parler des vagues de suicides dans la ville du plaisir et prend pour point de départ la chute de Levi. Il y a enfin un stagiaire zélé, Jim Fingal, à qui l’éditeur confie la mission de vérifier les faits sur lesquels reposent les propos de D’Agata. Entre l’essayiste, le fact-checker et même parfois l’éditeur, commence alors un bras de fer musclé. Jusqu’où peut-on tordre les faits lorsqu’on s’empare d’une histoire vraie ? Est-il éthique de prendre des libertés dès lors qu’on parle d’un sujet aussi terrible que le suicide d’un enfant ? Suffit-il de ne pas avoir de mauvaises intentions ? Qui pour en décider ? Le fact-checker doit-il être un moraliste ?
Il y a d’abord un adolescent, Levi, qui saute du haut d’une tour de Las Vegas. Il y a ensuite un auteur, John D’Agata, qui souhaite parler des vagues de suicides dans la ville du plaisir et prend pour point de départ la chute de Levi. Il y a enfin un stagiaire zélé, Jim Fingal, à qui l’éditeur confie la mission de vérifier les faits sur lesquels reposent les propos de D’Agata. Entre l’essayiste, le fact-checker et même parfois l’éditeur, commence alors un bras de fer musclé. Jusqu’où peut-on tordre les faits lorsqu’on s’empare d’une histoire vraie ? Est-il éthique de prendre des libertés dès lors qu’on parle d’un sujet aussi terrible que le suicide d’un enfant ? Suffit-il de ne pas avoir de mauvaises intentions ? Qui pour en décider ? Le fact-checker doit-il être un moraliste ?
Jim : Parfait, encore un auteur qui méprise ses lecteurs.
John : Je ne méprise pas les lecteurs, Jim, mais quel est l’intérêt de se tourner vers l’art si c’est pour exiger de savoir à l’avance « dans quoi on est en train de mettre les pieds » ?
Le dispositif mis en place par l’éditeur et ses deux complices est vertigineux et redoutablement efficace. Au centre de la page un rectangle de taille variable dans lequel se trouve l’essai (court) écrit par D’Agata. Tout autour, les questions et vérifications de Jim Fingal : en noir, il valide, en rouge, il warning. Parfois, l’essai disparaît complètement sous les commentaires, majoritairement rouges, de Fingal. Car le stagiaire est zélé, même très zélé, se mettant à vérifier tout et n’importe quoi (y avait-il vraiment 34 clubs de strip-tease à Las Vegas en 2002 ? les briques étaient-elles vraiment disposées en épi ?), allant jusqu’à vérifier les références des références de l’essai de D’Agata et non seulement l’essai en lui-même, dans une espèce de jeu des matriochkas inépuisable. Au départ, les relations entre les deux hommes sont cordiales, mais évoluent rapidement en guerre des tranchées : les libertés prises par D’Agata sont insupportables aux yeux de Fingal, les remarques du stagiaire sont balayées d’un revers de main par l’auteur franchement rétif à toute remise en cause de son travail, ce qui, évidemment exacerbe la volonté de Fingal d’aller au bout de l’exercice.
Jim : […] Mais enfin, qu’est-ce qui vous autorise à faire passer pour un fait une légende à moitié recuite […] ?
John : Ça s’appelle de l’art, tête de nœud.
Jim : Toujours la même excuse.
Les échanges entre les deux hommes sont hilarants. Brillants tous les deux, hyper cultivés et soucieux de ne pas déroger à leur ligne de conduite, John et Jim déploient des argumentaires musclés, vifs et construits pour défendre leurs positions. Au-delà de l’aspect ludique du dispositif, le livre est palpitant de bout en bout. Étant dans ma vie n°1 obligée d’être Fingal-style, mais dans ma vie n°2 plutôt portée sur la licence poétique à la D’Agata, les joutes habiles des deux hommes ont fortement résonné en moi et ont déclenché questionnements et conflits intérieurs.
Jamais rébarbatif, toujours passionnant, Que faire de ce corps qui tombe est un livre immense. À lire et partager avec les gens qu’on aime.
Ed. Vies parallèles
Trad. Henry Colomer
PS : je ne sais si c’est le traducteur ou l’éditeur, mais bravo pour le titre en français.
PS bis : Charybde 27 en parle très très bien là.
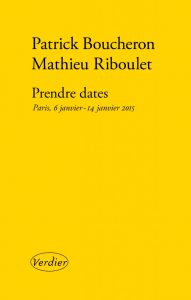 Il faut peu de choses parfois (ici les premiers mots d’un texte) pour réaliser que les plaies ne sont et ne seront jamais refermées, pour dégeler les douleurs enfouies et leur redonner vie. A quatre mains, un historien et un écrivain relatent les attentats de janvier 2015, un peu avant, un peu après, pour rendre compte, poser sur papier les faits externes et les processus internes, ce qu’ils ont pensé, ressenti, à juste place entre le déroulement des événements et le début de la mise à distance. Et c’est bouleversant. Bouleversant de justesse des sentiments, et d’intelligence.
Il faut peu de choses parfois (ici les premiers mots d’un texte) pour réaliser que les plaies ne sont et ne seront jamais refermées, pour dégeler les douleurs enfouies et leur redonner vie. A quatre mains, un historien et un écrivain relatent les attentats de janvier 2015, un peu avant, un peu après, pour rendre compte, poser sur papier les faits externes et les processus internes, ce qu’ils ont pensé, ressenti, à juste place entre le déroulement des événements et le début de la mise à distance. Et c’est bouleversant. Bouleversant de justesse des sentiments, et d’intelligence.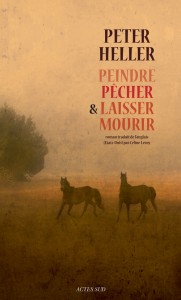 Non mais comment ils sont forts ces ricains quand ils s’y mettent. Dans son deuxième roman, le très prometteur Peter Heller, découvert en France grâce à la magnifique
Non mais comment ils sont forts ces ricains quand ils s’y mettent. Dans son deuxième roman, le très prometteur Peter Heller, découvert en France grâce à la magnifique  d’acceptation de soi et de sa douleur par le sauvetage d’un être plus faible et fragile. C’est sans compter sur le tempérament légèrement sanguin de notre héros et l’immense talent de Peter Heller qui nous entraîne dans une course-poursuite échevelée et déchirante, ponctuée par des pauses « pêche, peinture et flash-back » sidérantes d’audace et de beauté. Oui, il y a de l’audace à « casser » sa ligne narrative de cette manière-là, quand le mec à envie de pêcher, il largue tout pour pêcher, quand Peter Heller a envie de raconter le frétillement de la truite et le comportement de la mouche, il largue tout pour raconter le frétillement de la truite et le comportement de la mouche. L’auteur réussit à faire coïncider la forme de son roman avec la complexité de son personnage, sans chercher le confort pour le lecteur et les chemins balisés.
d’acceptation de soi et de sa douleur par le sauvetage d’un être plus faible et fragile. C’est sans compter sur le tempérament légèrement sanguin de notre héros et l’immense talent de Peter Heller qui nous entraîne dans une course-poursuite échevelée et déchirante, ponctuée par des pauses « pêche, peinture et flash-back » sidérantes d’audace et de beauté. Oui, il y a de l’audace à « casser » sa ligne narrative de cette manière-là, quand le mec à envie de pêcher, il largue tout pour pêcher, quand Peter Heller a envie de raconter le frétillement de la truite et le comportement de la mouche, il largue tout pour raconter le frétillement de la truite et le comportement de la mouche. L’auteur réussit à faire coïncider la forme de son roman avec la complexité de son personnage, sans chercher le confort pour le lecteur et les chemins balisés. Certains éditeurs sont là pour nous rappeler que la littérature, ce n’est pas seulement un grog au coin du feu, mais ça peut-être également un caillou pointu dans la chaussure. Quidam éditeur fait partie de ces rares précieux.
Certains éditeurs sont là pour nous rappeler que la littérature, ce n’est pas seulement un grog au coin du feu, mais ça peut-être également un caillou pointu dans la chaussure. Quidam éditeur fait partie de ces rares précieux. Entrelacés dans ce monologue déroutant, quelques parcours de vie d’habitants de Victoria sont racontés, des destins brisés, violents, misérables.
Entrelacés dans ce monologue déroutant, quelques parcours de vie d’habitants de Victoria sont racontés, des destins brisés, violents, misérables. J’adoooooore les contes, j’adore qu’on me raconte des histoires. J’ai toujours été fascinée par les contes, ce matériau meuble, mouvant, qui ne demande qu’à être récupéré, trituré, malaxé, au gré de la volonté de celui qui le dit ou l’écrit. Les contes, et notamment ceux de Perrault, c’est le fondement de l’enfance, une part de l’inconscient collectif, les briques sur lesquelles on construit les murs.
J’adoooooore les contes, j’adore qu’on me raconte des histoires. J’ai toujours été fascinée par les contes, ce matériau meuble, mouvant, qui ne demande qu’à être récupéré, trituré, malaxé, au gré de la volonté de celui qui le dit ou l’écrit. Les contes, et notamment ceux de Perrault, c’est le fondement de l’enfance, une part de l’inconscient collectif, les briques sur lesquelles on construit les murs.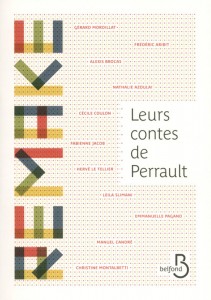 Les deux papous Hervé Le Tellier et Gérard Mordillat survolent l’exercice et on en attendait pas moins d’eux. Drôle (sacré Riquet) ou bigrement mystérieux (on cherchera activement Andres Delajauria sur internet) leurs textes, sont judicieusement placés dans l’ouvrage, en introduction et au milieu du volume, lui servant de piliers.
Les deux papous Hervé Le Tellier et Gérard Mordillat survolent l’exercice et on en attendait pas moins d’eux. Drôle (sacré Riquet) ou bigrement mystérieux (on cherchera activement Andres Delajauria sur internet) leurs textes, sont judicieusement placés dans l’ouvrage, en introduction et au milieu du volume, lui servant de piliers.