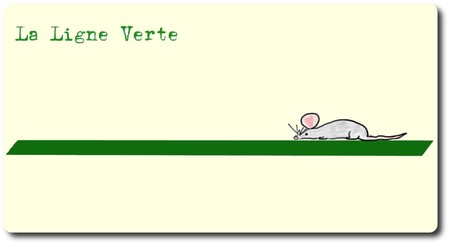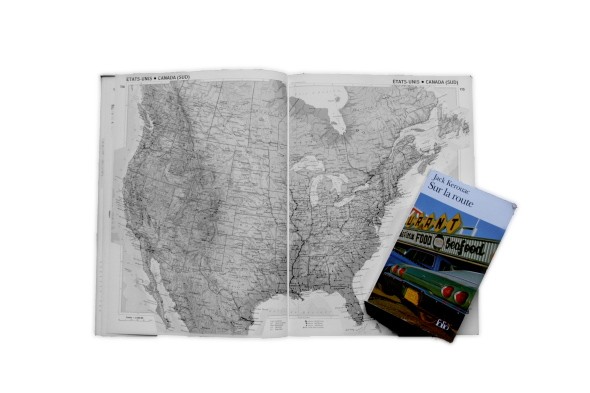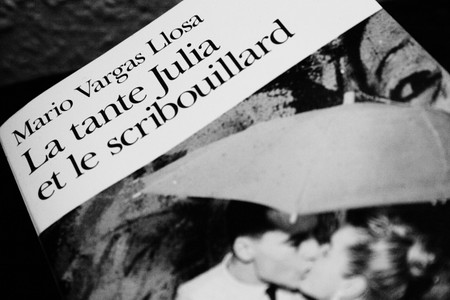de Philip Roth.
Quel immense soulagement de tomber sur un aussi beau bouquin, après ma lecture très poussive de Lord Jim. Voilà un roman pile poil comme je les aime, qui conjugue regard mordant et aiguisé sur l’humanité et une compréhension totale de ses personnages.
Zuckerman, écrivain, retrouve après plus de 30 ans son idole de collège, l’ex-sportif Seymour Levov. Derrière la façade apparemment sans tâche et ultra-bright de Levov (de l’argent, une famille heureuse, un physique flambant, bref la réussite dans tous les domaines, le rêve américain), se cache en fait un cratère béant d’incompréhension et de désespoir : sa fille d’un premier mariage, Merry, a fait exploser lorsqu’elle avait 16 ans une bombe, tuant une personne. En apprenant ce geste, Zuckerman raconte l’histoire telle qu’il se l’imagine de Seymour Levov, avant, et après cet acte insensé.
Le regard de Roth sur ses personnages est étonnant. Jamais il ne les juge, essayant juste d’imaginer les différentes pistes du pourquoi et du comment. L’écriture, parfois répétitive, reflète les ruminations de Levov, qui, en tordant les faits de différentes manières, essaie d’approcher la vérité, une vérité qui lui permettrait de continuer à vivre. L’amour absolu pour sa fille meurtrière, son sens moral, son amour pour son pays, son éducation, tout s’entrechoque, tout est prétexte à remise en question, à regrets. Roth évite cependant de faire de Levov une caricature du rêve américain : Levov comprend bien que le geste de sa fille est un rejet de ce rêve trop parfait de réussite, mais il ne peut s’empêcher d’aimer son pays et ses possibilités tout en conservant son esprit critique vis à vis des actions du gouvernement. Honnêtement, Levov a tout du bon gars, pile au milieu, ouvert et tolérant.
La charge virulente ne porte pas sur les êtres humains pris individuellement, mais sur la société américaine dans son ensemble, qui, elle, rejette violemment toutes les différences et promeut un idéal universel et normatif, jusqu’à envoyer ses gamins se faire tuer à l’autre bout du monde. La société accouche de ses extrêmes : d’individus formatés à leur insu, bien dans le moule, ou de fanatiques désaxés. Intéressantes également les transformations physiques et psychologiques de Merry. Enfant frêle, elle devient une ado massive en rébellion. Son corps s’affirme, se développe, différent, pour essayer de trouver une place dans la société, de s’imposer d’abord par la chair. Quand Levov la retrouve après des années, elle est devenue Jaïn et n’est plus qu’un fantôme de peau de d’os. Elle refuse alors de faire le moindre mal à n’importe quel être vivant, elle essaie d’interagir le moins possible avec l’extérieur. Après l’attaque contre la société, la passivité, elle s’efface du monde. Et c’est par le corps également que Levov disparaît, d’un cancer, après avoir été le symbole physique d’une certaine idée de l’Amérique. Le message est clair, l’Amérique génère elle-même les ferments de sa ruine.
Charge violente contre la société américaine, vulnérabilité physique et psychologique de l’Homme face à l’Histoire, Pastorale américaine est un roman magnifique, intimiste et ample.
God bless G. pour ce beau cadeau.