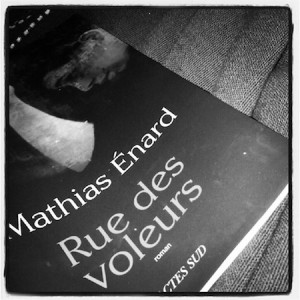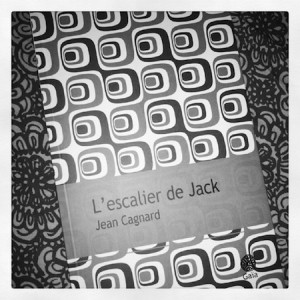d’Andréas Becker.
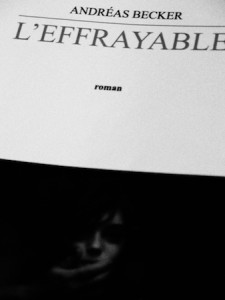 Paradoxal livre que L’effrayable. Lancé à grands renforts de pub dans certaines salles obscures, son plan com’ a pris le pas sur la critique dans le monde de la toile et dans la presse. Ce roman, on en parle surtout pour ces quelques images sur grand écran. Paradoxaux également les sentiments qui nous habitent quand on en termine la lecture. Entre intérêt et exaspération, entre admiration et ennui.
Paradoxal livre que L’effrayable. Lancé à grands renforts de pub dans certaines salles obscures, son plan com’ a pris le pas sur la critique dans le monde de la toile et dans la presse. Ce roman, on en parle surtout pour ces quelques images sur grand écran. Paradoxaux également les sentiments qui nous habitent quand on en termine la lecture. Entre intérêt et exaspération, entre admiration et ennui.
Un homme dans une cellule capitonnée écrit. Il écrit pour lui et pour la petite fille qui l’habite. Il écrit parce qu’il ne peut pas faire autrement, parce que c’est de cette manière qu’on pense qu’il va guérir. Mais cette histoire qu’il nous livre est complexe, l’histoire familiale depuis les années trente dans l’Allemagne nazie, jusqu’à nos jours, tout ça en ordre dispersé, entrecoupé de phases d’introspection. Mais dans le discours s’invitent des mots étranges, distorsions du français, amalgames de plusieurs mots, des conjugaisons insolites, des constructions éclatées. Karminol, car c’est son nom parle une langue qui n’est qu’à lui, pleine de trop de lettres et d’auxiliaires surnuméraires. Ce trop-plein, c’est l’héritier de tous les on-dit du passé, de toutes les fautes, les horreurs accumulées et dissimulées. Sous la plume de Karminol, viennent se bousculer les fantômes du passé, qui s’imposent à la normalité, au bon sens, à tout ce qui est droit.
On peut donc admirer l’audace d’Andréas Becker d’avoir tenu son pari jusqu’au bout, d’avoir malmené la langue sur 250 pages, sans faiblir, variant avec à-propos le “taux de déformation” à l’aune de la lucidité flageolante de son héros. Ça fonctionne parfois très bien, on sent bien le texte en bouche, grondant, ronflant, au rythme impeccable. Et puis parfois, le processus de déformation, de même que les propos, deviennent lourdement symboliques. Il y a de la psychanalyse pour les nuls là, derrière, Nous sommes le réceptacle des péchés de nos parents et des parents de nos parents, en nous s’accumule le poids de l’Histoire, et des choses tues. Certes, mais, le livre en devient par moments dangereusement figuratif.
La fin est d’ailleurs très illustrative de ce phénomène, on a envie de dire à Andréas Becker que bon, là, ça va, on a compris, c’était très bien, mais faudrait pas non plus nous prendre pour des truffes, ça devient quand même répétitif, et il n’est pas Beckett. Le texte aurait mérité d’être beaucoup plus ramassé, moins explicatif. Il aurait dû faire confiance dans la langue qu’il a réinventée pour parler d’elle-même, d’autant plus qu’on devine, derrière tout ça, qu’au niveau stylistique l’auteur ne semble pas totalement manchot. Le pari est donc beau, la réalisation en demi-teinte.
Un livre intéressant tout de même et qui pose des questions sur la langue, sa signification. A t’on besoin de changer les mots pour exprimer l’indicible ? ou le style et la forme suffisent-ils ?
En attendant, on peut relire le Jabberwocky de Lewis Carroll, histoire de tout imaginer derrière des mots qui n’existent pas.
Twas brillig, and the slithy toves
Did gyre and gimble in the wabe;
All mimsy were the borogoves,
And the mome raths outgrabe.
Ed. La Différence