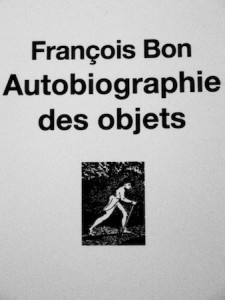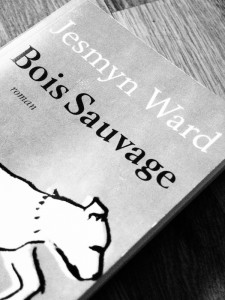de Patrick Deville.
Il finira sa vie heureuse de solitaire dans la simplicité des jours et l’insatiable curiosité.
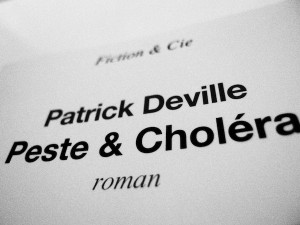 Que dire de Peste & Choléra voué d’avance à devenir un best-seller ? Plutôt du bien. Même si. Patrick Deville nous emmène dans son sillage à la découverte d’Alexandre Yersin, scientifique touche à tout et découvreur du bacille de la peste (Yersinia pestis). Quasiment oublié en France, Alexandre Yersin est pourtant un scientifique génial (et chanceux) ainsi qu’un personnage romanesque hors du commun : médecin, aventurier, découvreur, agriculteur, bricoleur, il a tout fait dans sa vie, tout testé, mué par une énergie inaltérable. Il meurt pourtant fort vieux et fort tranquillement, en observant les marées, dans le coin de paradis vietnamien qu’il s’était choisi.
Que dire de Peste & Choléra voué d’avance à devenir un best-seller ? Plutôt du bien. Même si. Patrick Deville nous emmène dans son sillage à la découverte d’Alexandre Yersin, scientifique touche à tout et découvreur du bacille de la peste (Yersinia pestis). Quasiment oublié en France, Alexandre Yersin est pourtant un scientifique génial (et chanceux) ainsi qu’un personnage romanesque hors du commun : médecin, aventurier, découvreur, agriculteur, bricoleur, il a tout fait dans sa vie, tout testé, mué par une énergie inaltérable. Il meurt pourtant fort vieux et fort tranquillement, en observant les marées, dans le coin de paradis vietnamien qu’il s’était choisi.
L’auteur, se matérialisant de temps en temps dans le roman sous la forme d’un “fantôme du futur”, dresse le portrait de Yersin de manière vivante, ironique, avec fougue et enthousiasme. On ne peut qu’admirer la culture (immense) de Patrick Deville. Il recréé avec beaucoup de justesse l’ambiance et l’environnement politique de l’époque, ainsi que les décors dans lesquels évolue Yersin. Tout ça est bien, brillant, ruisselant de références et d’enthousiasme. Peste & Choléra est sans aucun doute un livre fort recommandable qui enchantera n’importe quel lecteur à qui vous l’offrirez.
Malheureusement, j’ai fort peu de goût pour les hagiographies, et le livre de Patrick Deville flirte en permanence avec la tentation de l’admiration extatique. On passe sous silence les échecs un peu embarrassants de Yersin (son sérum anti-pesteux, mis au point à la va-vite et mal ficelé, fera mourir très bien quelques cobayes humains), pour mettre en lumière les petites faiblesses du génie (car il l’était), et surtout ses réussites. On n’a beau chercher la faille de ce personnage inébranlable, on ne la trouve pas, on ne trouve pas ce petit truc qui pourrait entrer en résonance avec notre propre vécu.
Deville échoue, là où Echenoz réussissait merveilleusement dans Des éclairs, à transformer un personnage historique en personnage intime de chair, d’os et de sentiments. Et puis, que voulez-vous, ce genre de biographie tagada boum-boum, pour moi, ça sent déjà la naphtaline.
Peste & Choléra demeure un roman impeccable, si soigneusement empaqueté que rien ne peut s’en échapper. Tout ça est parfaitement parfait. Mais ça ne suffit pas.
Ed. Les éditions du Seuil.