de Garth Risk Hallberg.
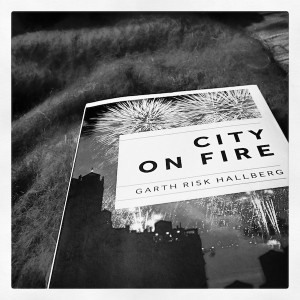
Il paraît donc que c’est le roman le plus cher de l’histoire. Mais ça je ne le savais pas en l’achetant. Tout simplement séduite par le titre, la couverture, le papier bible et ces inserts bizarroïdes dans le cours du roman. Acheté donc en se disant que je n’aurais de toutes façons jamais le temps de lire une telle pavasse. Presque mille pages et des pages assez denses.
Aussi denses que cette histoire, ses dizaines de personnages, ses intrigues emmêlées, imbriquées, ses ramifications multiples. Et c’est tout le talent de la littérature américaine qui se dresse au travers de ces personnages tous plus ou moins déglingués. G. R. Hallberg a sans aucun doute lu tous les bons livres et réussit à faire exister ses personnages, du principal au figurant d’arrière-plan, de manière convaincante. On s’attache à toute (ou presque, le frère démon brrrrr) cette galerie de portraits, du journaliste alcoolique, au flic cabossé (au sens propre, polio), en passant par l’ado perdu et la mère hantée par son passée.
Et puis il y a aussi ces scènes, quelques-unes, qui émergent du magma, dans un état de grâce absolu. Durant ces scènes, pas besoin de paroles inutiles. L’auteur se contente de décrire ce que font ses personnages, juste leurs gestes et leurs hésitations. Par exemple cette scène magnifique dans laquelle la mère de famille, hantée par l’avortement qu’elle a subi lorsqu’elle avait 20 ans est tentée de projeter sur un adolescent perdu les fantômes de son passé et finit pourtant par s’en détourner, choisissant la vie, le futur, plutôt que le repli sur soi. C’est beau, pudique, tout en retenu. Allez, il y a même quelques éclats de Richard Yates là-dedans. Mais un Richard Yates sous amphéts et cocaïne qui aurait eu bien du mal à contenir son récit dans une volumétrie modérée.
Alors City on fire, un chef d’oeuvre ? Certainement pas. Le roman est bourré de défauts, trop long, digressif à mort, bordélique. Et pourtant. Par sa construction complètement éclatée (il faudrait s’y pencher scrupuleusement, mais tout de même difficile de remettre tout en ordre et de comprendre exactement le schéma suivi par l’auteur), City on fire semble ressusciter quelque chose de l’atmosphère de l’époque, ce New York de la fin des années 70, libre, rebelle, artiste et pourtant manipulé (déjà) par la grande finance qui dessine son futur à coup de déclarations d’insalubrité et d’incendies criminels.
Malgré son épaisseur et ses côtés foutraques, City on fire est pourtant difficile à lâcher. Rien à dire, ils sont forts ces ricains pour faire naître des personnages et des scènes absolument inoubliables.
Ed. Plon (Feux croisés)
Trad. Elisabeth Peellaert.
Une réflexion sur « Chronique livre : City on fire »