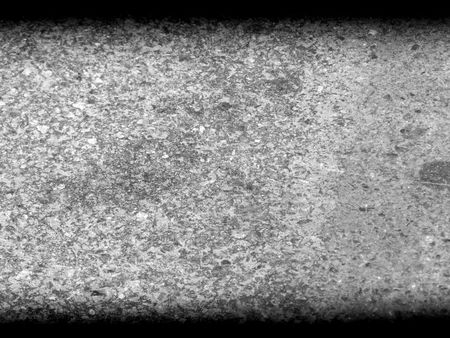de Matteo Garrone.
Âmes sensibles s’abstenir. Curieuse coïncidence que d’aller voir Sodome chez Pasolini et Gomorrhe chez Garrone, à croire que l’Italie serait un pays un chouille perturbé. Gomorra croisent les trajectoires de 5-6 personnages napolitains, du p’tit morveux à la gueule d’ange au vieux caïd, tous liés à la Camorra. Il ne s’agit pas ici de dénoncer les pratiques de la Camorra (visiblement le livre de Roberto Saviano dont est tiré le film s’en charge copieusement), mais de s’immerger dans ces vies, de les ressentir physiquement. Autant vous dire que le film est inconfortable au possible, et on passe son temps la nausée au bord des lèvres. Ben oui, dans les quartiers insalubres, paupérisés, rongés par le trafic de drogue on peut pas dire que ce soit la fête pouet pouet.
Garrone a situé son film dans « les voiles », projet urbanistique complétement dingue qui n’a jamais réussi à être complétement opérationnel à cause du vandalisme. Des lames triangulaires de béton, séparées entre elle de quelques mètres de couloir qui ne voient jamais le jour et sont le repère de tous les petits et gros trafics de la zone. Le seul reproche qu’on peut faire à Garrone est de ne pas avoir suffisamment utilisé son décor. Mais c’est vraiment pour chipoter (en même temps, étant donné les conditions de tournage c’était sans doute un peu chaud). Il préfère s’attacher à ses acteurs (tous extraordinaires, mention spéciale au tailleur, Salvatore Cantalupo je crois), et épier chacun de leurs gestes. Au fond Gomorra est un film anthropologique, ou plutôt zoologique. On est ici dans une lutte pour la survie dans la jungle, dans laquelle la bouffe est remplacée par le fric. Pris dans un système qui semble immuable, les hommes s’adaptent, et tout est dicté chez eux par l’instinct de survie.
La caméra de Garrone est nerveuse, puissante, révélatrice de la moindre émotion. C’est un film physique, brutal, qui n’épargne rien, ne juge rien, et s’attache à faire ressentir. Jusque dans ces raps assourdisants qui ponctuent périodiquement le film et qui font vibrer jusqu’au fin fond des tripes (d’ailleurs la musique du générique de fin est assez hallucinante, Massive Attack j’crois). Gomorra mérite amplement son Grand prix au dernier festival de Cannes. En espérant que la Palme d’Or soit aussi couillue… mais j’avoue avoir franchement quelques doutes a priori.