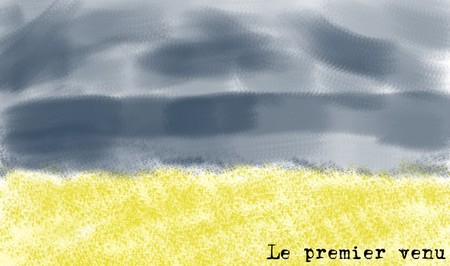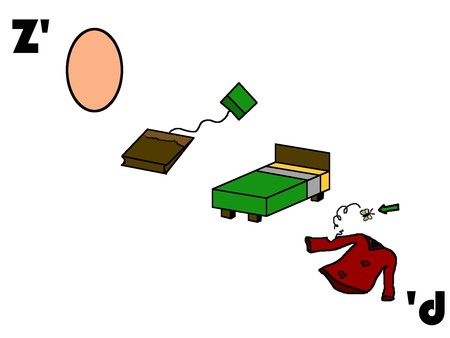de Jacques Doillon.
En préambule, un petit coup de gueule (mince, on va encore me taxer de violente dans mes propos), il faut vraiment que Doillon change de preneur de son. Le film, très dialogué, est doté d’un son catastrophique, qui m’a fait manquer un bon quart des dialogues. Ma critique sera donc encore plus subjective que d’habitude, puisque j’ai loupé probablement des éléments clés de l’histoire.
Bref. Camille (bourgeoise disent les critiques, moi, j’en sais rien), poursuit Costa, genre petite frappe zonard. Elle dit qu’il l’a violée, il dit qu’elle l’a chauffé. Il a une ex-femme forte-tête, une gamine qu’il n’a pas vu depuis 3 ans, et un pote devenu flic, et amant de son ex. D’elle, on ne sait rien, à part qu’elle le suit, entre reproches et cajoleries.
Le premier venu fait partie de ces films exigeants, austères, profonds qu’on aimerait défendre bec et ongles. Il m’a malheureusement laissé sur le carreau. Je me suis sentie étrangère à cette histoire. Il y a pourtant de bonnes choses dans ce film. Les acteurs d’abord, tous très bien : Clémentine Beaugrand porte bien son énigme, et Gérald Thomassin est impressionnant en bombinette prête à exploser. Doillon les filme avec beaucoup d’amour dans l’oeil de sa caméra. Une jolie trouvaille aussi que cette sonate de Debussy qui ponctue de manière taquine les séquences du film. Il y a du plaisir là-dedans , c’est certain.
Et pourtant, ça ne fonctionne pas, ou rarement. La faute à cette héroïne insaisissable et incompréhensible qui n’est jamais crédible. On ne croit pas un instant à son attirance pour Costa, frivolité de petite bourgeoise ? syndrome de Stockholm ? gentillesse ? perversité ? aucune hypothèse ne tient bien longtemps. Ses réactions n’ont ni queue ni tête, que cherche t’elle cette fille ? Vous allez me dire que c’est ça qui est intéressant, ce mystère, cette ambiguïté. Mais à trop en rajouter dans la virevolte, dans la subtilité et la complexité psychologique, on reste au bord de la route. En ce sens, le final « tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes », après une prise d’otage relativement violente, me laisse totalement perplexe. Impossible de s’identifier à ce personnage féminin opaque, à ce monde psychologiquement instable, à cette errance sans suite de sentiments disjoints.
Reste un Gérald Thomassin, bloc de souffrances au bord du gouffre, qui donne le vertige.