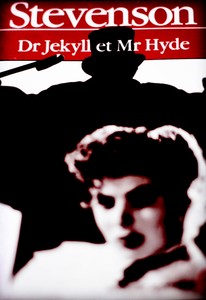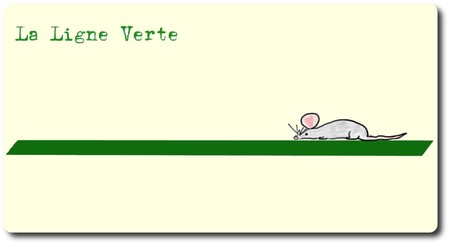de Martin Suter.
Ah, quel filou ce Martin Suter. Business Class est composé de quelques chroniques sur le monde de l’entreprise publiées dans la presse. La plume se veut mordante, le regard acéré. On devine l’écriture un peu trop facile derrière tout ça. Succession de saynètes mettant en scène, la plupart du temps, les patrons et hauts gradés, Business Class pointe du doigt l’impudence, l’inconséquence, l’hypocrisie, la veulerie, la misogynie des dirigeants, autant dans leur vie professionnelle que personnelle. Un chef ne peut cesser d’être un chef quand il rentre à la maison. Tout ici est histoire d’image. Si vous arrivez à faire croire aux autres que vous êtes un bourreau de travail efficace, alors ils le goberont. Comme quelqu’un de précieux me l’a rappelé : « L’important n’est pas de travailler, mais de montrer que vous le faites ». Business Class en est l’exemple éclatant.
Le problème majeur de ce « livre », c’est que la démarche est aussi roublarde que les patrons qu’elle cloue au pilori. Ces chroniques, qui devaient être de très jouissifs petits exutoires matinaux pour employés ballottés dans les transports en commun surpeuplés, n’ont pas leur place dans un bouquin relié. 7 euros, pour moins de 60 pages, police 18, on hurle à l’arnaque, et on imagine l’éditeur, les francs suisses plein les mirettes proposer à Suter : « mais dites-moi , vos chroniques là, ça vous dirait de les publier pour de vrai ? » Pas d’efforts particuliers à fournir, la juxtaposition des nouvelles ne leur apporte pas l’éclairage spécifique qui justifierait la compilation. Bref, je me suis faite avoir. Il y a plus de paraître que de travail là-dedans. Beaucoup trop naïve la fille. Décidément, je ne serai jamais chef.

Entre les deux mon coeur balance.
Un peu plus grand en cliquant dessus.