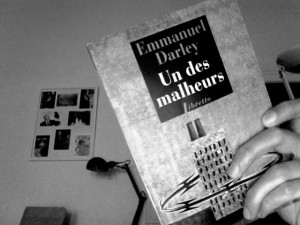de Christophe Esnault
Que vais-je maudire désormais maintenant que je t’ai trouvée ?
 Décidément, cette fin d’année est remplie de petites pépites poétiques. Après la lexicopathie somnambule selon Radu Bata, voici la dislocation amoureuse selon Christophe Esnault, ou quatre-vingt treize très courtes pages pour trois jours de passion dévorante dans les bras de la belle Isabelle. Le livre est ainsi composé d’une cinquantaine de textes, reflets de moments, de sensations vécues durant ces jours d’amour. Incrédulité, doutes, incertitudes, mais aussi passion ravageuse et ravagée, euphorie et coups de queue mémorables peuplent ces pages.
Décidément, cette fin d’année est remplie de petites pépites poétiques. Après la lexicopathie somnambule selon Radu Bata, voici la dislocation amoureuse selon Christophe Esnault, ou quatre-vingt treize très courtes pages pour trois jours de passion dévorante dans les bras de la belle Isabelle. Le livre est ainsi composé d’une cinquantaine de textes, reflets de moments, de sensations vécues durant ces jours d’amour. Incrédulité, doutes, incertitudes, mais aussi passion ravageuse et ravagée, euphorie et coups de queue mémorables peuplent ces pages.
En hommage au 4.48 Psychose de Sarah Kane, Christophe Esnault construit son récit en 4 chapitres et 48 poèmes, entrecoupés de 4 “apparitions” d’Isabelle. Mais cette forme prédéfinie ne cadenasse pas le récit, qui s’échappe de tous côtés dans un véritable festival d’inventivité. L’auteur joue avec la typographie, le sens de lecture, la composition. On est surpris chaque fois qu’on tourne la page, et même s’il n’y a rien de spectaculaire, il y a toujours un petit “truc” de mise en page qui fait sourire ou qui émeut.
Mais sa peau et ses fesses si douces
famille de cèpes au pied d’un chêne
panier plein courir montrer sa chance
surdose câlinerie chênaie de tes huit ans
quand lové contre elle la joie s’installe
Difficile de décrire plus loin l’objet-livre sans en déflorer les mystères. Ce qui est sûr, c’est qu’on prend beaucoup de plaisir à le découvrir. L’écriture de Christophe Esnault, fougueuse et fissurée y est pour beaucoup. C’est touchant, sincère, parfois drôle, parfois douloureux, profondément humain. Je ne saurais trop vous conseiller de découvrir ce texte romantique à mort et au bon sens du terme, très joliment édité qui plus est, ce qui ne gâte rien.
Ed. Les doigts dans la prose