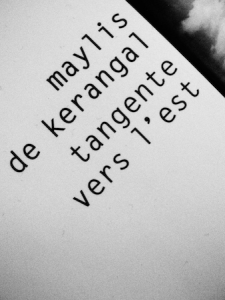de Haruki Murakami.
 1Q84 est sans doute le livre le plus paradoxal de Murakami que j’ai lu.
1Q84 est sans doute le livre le plus paradoxal de Murakami que j’ai lu.
Dès les premières pages, on comprend à quel point l’auteur est intelligent. Alternant les chapitres sur deux personnages, il réussit à créer un phénomène d’addiction chez le lecteur que je n’avais pas ressenti depuis la lecture des Chroniques de San Francisco il n’y a pas loin de quinze ans (oui bon chacun ses casseroles hein). Ce phénomène addictif, proche de celui qu’on peut ressentir pour sa série préférée, ne tient malheureusement pas sur les quelques 1500 pages du roman. En abordant le Livre 3, on commence à comprendre le truc, à bien voir les ficelles (genre intégré un chapitre dans lequel il ne se passe rien, pour chronologiquement rattraper l’histoire de l’autre personnage), et l’arrivée d’un troisième luron dans l’affaire n’a pas titillé plus que ça mon intérêt, il m’a plutôt agacé. L’intelligence de Murakami glisse alors doucement vers la roublardise.
Par ailleurs, je dois vous avouer, que j’avais assez précisément deviné où Murakami voulait se rendre (convoquer l’ensemble des forces de l’univers pour finalement ne parler que d’une histoire d’amour), du coup, au bout de 1000 pages, j’avais envie qu’il s’y rende… vite. Ce qui n’est pas le cas.
Alors pourquoi ce phénomène d’addiction dans les deux premiers tomes ? Le savoir faire du mec, évidemment, énorme, mais aussi un personnage, Fukaéri, qui renferme à lui seul l’intérêt du livre. Quand elle disparaît de l’histoire, rien, ne va plus, on s’ennuie ferme. Tengo est bien gentil, mais ce type de personnage commence vraiment à devenir un stéréotype murakamien, Aomamé est assez agréablement mystérieuse, mais le coup du traumatisme psychologique et de l’immaculé conception, au secours. Reste Fukaéri, dont la maladresse avec les mots donne à la fois envie de lui donner des baffes, et de l’encourager avec chaleur, dont les réponses laconiques agacent et fascinent. Quand elle disparaît, le livre se met à suivre un petit chemin mou et balisé.
Pas un moment désagréable, mais j’en attends un peu plus du maître.
Ed. Belfond
Trad. Hélène Morita