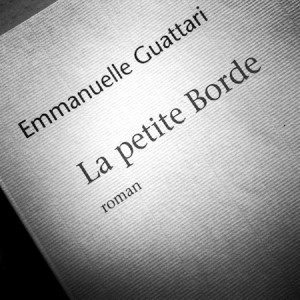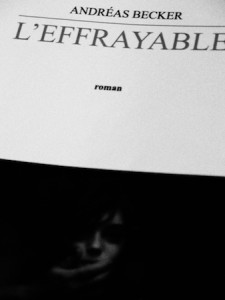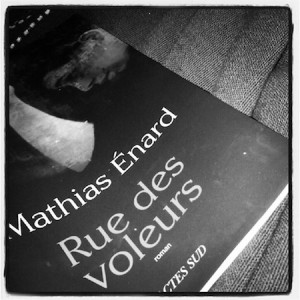de Russell Hoban.
 Gloire à l’éditeur, réussissant pour la modique somme de vingt euros, à offrir au lecteur ce magnifique objet-livre qu’est Enig marcheur. C’est une habitude chez Monsieur Toussaint Louverture, le travail est toujours fignolé au petit poil, il y a de l’amour et de l’attention dans chaque livre édité. Mais là, on atteint quand même quelque chose de grandiose, c’est beau et émouvant.
Gloire à l’éditeur, réussissant pour la modique somme de vingt euros, à offrir au lecteur ce magnifique objet-livre qu’est Enig marcheur. C’est une habitude chez Monsieur Toussaint Louverture, le travail est toujours fignolé au petit poil, il y a de l’amour et de l’attention dans chaque livre édité. Mais là, on atteint quand même quelque chose de grandiose, c’est beau et émouvant.
Gloire également à l’éditeur qui ose se lancer dans le « chantier » Enig, un livre écrit dans un anglais malmené («le riddleyspeak »), et donc impossible à traduire, et pourtant traduit de main de maître par Nicolas Richard, un livre qu’il est donc très difficile de lire (si si, avouons-le), même en prenant son temps, et donc nécessitant de la part du lecteur un engagement beaucoup plus grand que beaucoup de livres, même très exigeants. Monsieur Toussaint Louverture l’a fait, et c’est ce qui rend cette maison d’édition si indispensable et unique dans le paysage éditorial francophone. Mais passée l’émerveillement initial, et l’indubitable réussite éditoriale, que dire d’Enig marcheur ?
L’histoire se déroule dans un futur extrêmement lointain, en Angleterre, des siècles après un « grand boum » (une explosion nucléaire donc) qui a tout ravagé. Enig a atteint ses 12 ans, son âge d’homme, et en quelques jours sa vie bascule. Dans ce monde post-apocalyptique, la société est régie par Le grand Ram, qui professe sa bonne parole et asservit la population grâce à des spectacles de marionnettes mettant en scène Eusa (mi-dieu, mi-scientifique à l’origine du grand boum), et Adom le Ptitome Bryllant, coupé en deux (mi-atome d’uranium, mi-jesus). Il n’y a que quelques castes bien cloisonnées dans la société, définies par leur profession (charbonnier, trinturier…). On ne peut se déplacer qu’en groupe, au gré du travail à accomplir, entourés de garde du corps, le pays étant infesté de chiens sauvages très dangereux. C’est un société presque complètement orale (sauf Enig qui a appris à écrire ? pourquoi, comment ?), qui fonctionne sur un système de légendes, de prémonitions, et de croyances, un vrai retour à l’âge de fer.
Enig est un peu différent du reste du troupeau, il se pose des questions, il sait écrire, et son instinct le fait sortir de la route toute tracée qu’il s’apprêtait à suivre, il sauve un garçon, descendant d’Eusa, qui semble posséder un grand savoir mais ne sait pas vraiment comment l’utiliser, il devient l’ami des chiens sans trop savoir comment, et de rencontre en rencontre il trace sa route à lui, et finit par écrire son histoire, et devenir marionnettiste à son tour, mais pour un spectacle non-officiel, quelque chose de nouveau et différent. Entre temps, il croise moult personnages dont, pour certains, la seule volonté est de recréer le Grand boum (espérant que ce qui a été perdu dans l’explosion pourra être retrouvé) et pour d’autres, la vérité se situe dans le cœur des arbres et ils se contentent de réinventer la poudre dans un « petit boum » qui fait déjà pas mal de dégâts.
On pourrait qualifier Enig marcheur de livre « slow life ». L’écriture très particulière d’Enig, nécessitant d’oraliser les mots pour comprendre le sens, oblige à la lenteur. Lentes sont également les évolutions de la société post-grand boum, voire inexistantes. A part quelques élites lettrées qui possèdent un savoir, très relatif, la population est laissée dans l’ignorance, enfermée par des règles strictes, et un environnement hostile qui leur interdit toute forme d’émancipation. Des réminiscences des connaissances scientifiques pré-apocalypses polluent les discours, et sont réinterprétées de manière complètement farfelue par toutes les personnes rencontrées par Enig. Les légendes s’appuient sur des fragments écrits avant le grand boum (la légende d’Eusa est ainsi une interprétation délirante de la description d’un tableau retraçant la vie de St Eustache , situé dans la Cathédrale de Canterbury !). Le livre est un véritable jeu de piste, de décryptage du langage et des éléments pré-apocalypse à la sauce post-apocalypse. Aussi, après un tel effort (laborieux) dans cette chasse aux trésors, s’attend-on à une juste récompense, au minima à être terrassé par une révélation finale définitive.
Alors, outre toute cette invention fantastique dans le langage et dans ces “trouvailles scénaristiques” souvent drôles et dérangeantes, que retenir d’Enig marcheur ? En tant que livre d’anticipation, quel éclairage nous propose Enig sur la société dans laquelle on vit et ses évolutions ? On peut lire le roman comme une illustration parfaite de la maxime rabelaisienne “Science sans conscience n’est que ruine de l’âme”, mâtinée d’un peu de « L’homme est un loup pour l’homme. » L’Homme a détruit la Terre une première fois, et son instinct (sa bêtise ?) le pousse à reproduire ce qui a tout détruit. Voilà qui est tout de même très classique dans ce genre littéraire, et n’apporte pas grand chose. En posant le livre, on ne peut s’empêcher de se dire, eh bien tout ça pour ça ?
Le monde créé par Russell Hoban est également par trop bancal, et manque de cohérence. Pour ce que j’ai pu en comprendre (la modestie reste de mise devant cet objet littéraire), il ne forme pas un système sociétal complet et viable, ce qui fait la force des grands romans d’anticipation, c’est à dire nous proposer des sociétés complètement différentes de la nôtre, mais au fonctionnement cohérent, et surtout nous apportant un éclairage et une réflexion sur ce que nous vivons aujourd’hui, et nos évolutions potentielles.
On retiendra alors surtout ce qui me semble la grand message d’Enig marcheur, l’émancipation de l’individu et donc son évolution passent par l’écriture et l’art, qui sont la base de tout. Là, je m’incline. Pour le reste, ce livre atypique et exigeant sur la forme, laisse tout de même trop un goût d’inachevé sur le fond pour pouvoir prétendre au statut de chef d’oeuvre absolu.
Ed. Monsieur Toussaint Louverture
Trad. Nicolas Richard