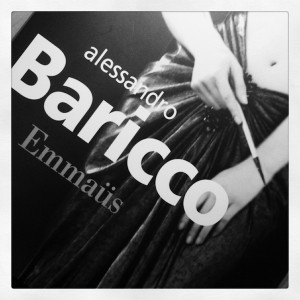de Mathieu Larnaudie.
 Un homme, Müller, vit dans une maison isolée que surplombe un viaduc. Dans sa grande propriété Müller est seul, hormis la présence fantomatique de son jardinier Marceau, fumeur et mutique (pas poss). Autrefois Müller prêtait sa plume à des politiciens, aujourd’hui, dans sa retraite, il travaille un discours chimérique, parfait, absolu. Mais cette recherche obsessionnelle de la phrase juste qui fait mouche, accompagnée d’une addiction rituelle aux séries policières US et à la Chartreuse, est perturbée par une vague de suicides. Le viaduc était trop tentant. Comment réagir alors face à l’irruption de cet imprévisible qui finit par ne plus l’être vraiment ? Comment se protéger ? Müller fait ce qu’il fait toujours, il écrit, accumule les phrases, et dans les phrases les mots, les propositions, les comparaisons. Bref, il se bâtit un mur de langage tout autour de lui. Mais si ce mur le protège un peu, il l’empêche aussi de voir.
Un homme, Müller, vit dans une maison isolée que surplombe un viaduc. Dans sa grande propriété Müller est seul, hormis la présence fantomatique de son jardinier Marceau, fumeur et mutique (pas poss). Autrefois Müller prêtait sa plume à des politiciens, aujourd’hui, dans sa retraite, il travaille un discours chimérique, parfait, absolu. Mais cette recherche obsessionnelle de la phrase juste qui fait mouche, accompagnée d’une addiction rituelle aux séries policières US et à la Chartreuse, est perturbée par une vague de suicides. Le viaduc était trop tentant. Comment réagir alors face à l’irruption de cet imprévisible qui finit par ne plus l’être vraiment ? Comment se protéger ? Müller fait ce qu’il fait toujours, il écrit, accumule les phrases, et dans les phrases les mots, les propositions, les comparaisons. Bref, il se bâtit un mur de langage tout autour de lui. Mais si ce mur le protège un peu, il l’empêche aussi de voir.
Voilà ce que j’ai pu comprendre de ce livre, qui, hélas, m’est un peu tombé des mains. Le projet est certes intelligent, et pose des questions sur l’écriture, son utilisation dans le discours politique. Une écriture cadenassée, articulée de manière ultra-précise pour faire passer un message, une idée, pour persuader les auditeurs, pour transmettre sans rien absorber de l’extérieur, est-elle encore écriture, littérature, art ?
Pour poser ces questions, Mathieu Larnaudie a choisi un dispositif que je n’ai pas entièrement compris. D’une part il alterne les chapitres à la première personne et à la troisième personne, mais sans changer de style : Müller nous raconte, puis un narrateur extérieur. La grande interrogation qui m’assaille c’est, mais pour quoi faire donc ? Par ailleurs, et même si on comprend bien le projet global, Acharnement est stylistiquement tout de même très difficile à tortiller. Mathieu Larnaudie essaie de rentrer dans la peau de son perfectionniste personnage, et pond des phrases interminables, accumulations de propositions subordonnées, de comparaisons, métaphores. Ça n’en finit pas, et même si ça retombe presque toujours sur ses pieds, le lecteur s’est déjà arraché les cheveux, a pleuré sa mère et hurlé au loup. On se croirait parfois dans le jeu des périphrases aux Papous dans la tête. Le problème, c’est que cette écriture, pour virtuose qu’elle soit j’en conviens, manque beaucoup d’oralité : elle est, justement, très littéraire, et me semble par trop éloignée de tout discours politique, même virtuose. Alors évidemment, la narration de Müller n’est pas le discours parfait qu’il entend composer, mais on ne peut s’empêcher de penser qu’avec un tel barbon derrière le Mont-Blanc, pas étonnant que son ministre ait perdu ses élections.
Et puis, j’ai été assez frustrée car j’attendais que le livre aborde un point qui, moi, m’aurait plus intéressé, les conflits intimes et éthiques de ces plumes politiques. Comment un auteur peut-il accepter d’utiliser son aisance avec le langage pour servir des intérêts politiques, et porter des messages qui ne sont probablement pas les siens ? Pourquoi accepter de le faire ? Comment peut-on gérer ça ? Comment se dépatouiller avec sa propre “liberté de conscience” ?
Par conséquent, et pour résumer, ce livre, dont j’attendais beaucoup compte-tenu des critiques, à la fois presse et net, pour le moins positives, si ce n’est dithyrambiques, telles qu’on en consulte peu, m’a intéressée par l’intelligence indubitable qui en émane, mais, de par les choix formels choisis, que je n’ai pas entièrement compris mais qui se défendent cependant comme tout parti-pris couillu, m’a laissée sur la fragile rambarde d’un parapet de viaduc romain, les poches lestées de briques qui, malgré les alvéoles dont elles sont pourvues, n’en sont pas moins lourdes et pesantes, menaçant donc mon fragile équilibre de lectrice instable, sans pour autant me donner le vertige et le coup de pied au cul nécessaires pour que mon esprit et mes tripes en sortent, planant au dessus de l’abîme, rassasiés, repus et heureux. Dommage.
Ed. Actes Sud
 Que se passe-t’il dans l’esprit lorsqu’on navigue entre la vie et la mort ? Clément Rosset s’est noyé, mais sauvé de justesse, il a déliré dans un hôpital de Majorque pendant 17 jours. De ce voyage entre deux mondes, il est revenu riche d’hallucinations complètement rocambolesques qu’il nous livre ici.
Que se passe-t’il dans l’esprit lorsqu’on navigue entre la vie et la mort ? Clément Rosset s’est noyé, mais sauvé de justesse, il a déliré dans un hôpital de Majorque pendant 17 jours. De ce voyage entre deux mondes, il est revenu riche d’hallucinations complètement rocambolesques qu’il nous livre ici.