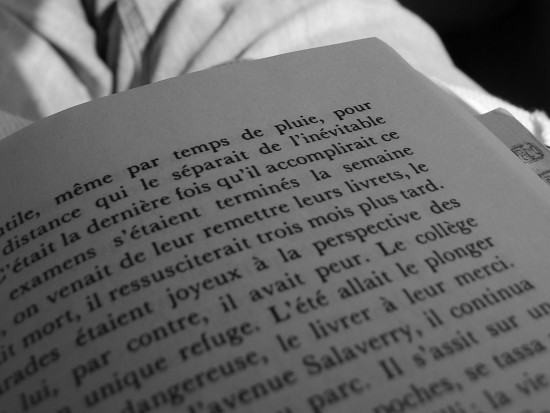de Luke Rhinehart

Alors là, alors là, mon grand manitou du conseil littéraire a encore tapé juste, béni soit-il, Oh Dé, Amen. L’Homme-dé est une pavasse, du style épais, 550 pages écrites pas très gros, et s’avale comme on joue aux dés, avec bonheur, exaltation, amusement, et énervement. Bref, avec beaucoup de plaisir.
Paru en 1971 en langue anglaise, vite devenu culte outre-Atlantique, puis interdit, pour enfin être traduit en français en 1995, l’Homme-dé est un roman hautement impoli, politiquement très incorrect, et largement subversif. Luke Rhinehart, le dé-ros, est un psychiatre bien assis sur sa réputation, sa charmante femme à l’allure de rongeur, ses deux gosses, ses patients, tous plus fadas le uns que les autres, et ses collègues, encore plus fadas que les patients sus-cités. Bref tout va bien pour lui, sauf qu’il s’ennuie ferme. Un soir de poker et de beuverie, resté seul en fin de partie, il dé-cide, sur un coup de dé, d’aller violer sa voisine, qui n’est autre que la femme de son associé et néanmoins ami. Trouvant le petit jeu excitant, il le pousse de plus en plus loin, pour finir par prendre toutes ses dé-cisions à coup de dés, jusqu’au choix de son comportement, réactions face à autrui etc… Interné, puis relâché, il commence à étendre sa théorie de la dé-vie à ses patients, puis ses amis, jusqu’à la création de micro-dé-sociétés, puis l’avénement du Dé comme religion à part entière, religion de Hasard, du bordel et de la dé-structuration de la personnalité pour atteindre une liberté ultime d’être et de réalisation de toutes les facettes du soi.
Ecrit de manière brillante, bourré de pépites d’intelligence, de dé-rision, d’amertume, l’Homme-dé est un brûlot anti-formatage, anti-société. Luke Rhinehart veut se dé-barrasser de sa personnalité, moulée dans la carcan des pressions sociales. L’Homme n’est pas libre car ses choix sont guidés par ce qui se fait, ce qui doit être, ce que la morale, et la société acceptent. Jouer sa vie aux dés, parmi un liste d’options fait acquérir à Luke la liberté suprême de se détacher du socialement acceptable, de pulvériser les règles du jeu, de réaliser tous ses fantasmes et d’explorer toutes ses ambiguïtés.
Brillant ou absurde, c’est en tous cas fascinant, et on pourrait blablater sur le fond et la forme jusqu’à demain matin. Il est facile de comprendre pourquoi ce livre culte à été interdit et jugé dangereux. C’est plus cette violente remise en question de l’assise sociale que pour les scènes de cul, dont quelques unes sont franchement assez glauques, de déchéance et de crasse, ce que savent faire pas mal de bons auteurs américains.
Malgré tout, la fin se mord un peu la queue. En créant des centres spécialisés dans la théorie du dé, Luke ne se rend pas compte qu’il construit des sociétés, aux règles différentes de la société réelle, mais existantes. L’absence de règles devient alors une règle en soi. Il y avait peut-être une manière un peu plus légère et rapide d’arriver à cette conclusion. Mais passons, ce bouquin est formidable et doit figurer dans toute bonne bibliothèque. Je ne regarderai plus jamais les dés de la même façon.
Allez, on va s’en jeter un petit (dé) ?
Je ne résiste pas à la tentation de vous citer trois petites phrases parmi tant d’autres :
« Freud était un bien grand homme, mais je n’arrive pas à me faire à l’idée que quelqu’un lui ait jamais efficacement flatté le pénis. »
« Américain de naissance et d’éducation, j’avais le meurtre dans la peau. »
« Jusqu’à présent, nous sommes la seule religion au monde à perdre de l’argent à une cadence accélérée… Je ne sais pas pourquoi, mais ça me rassure. »