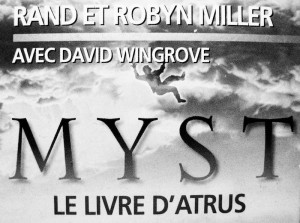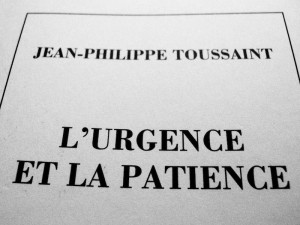d’Eric Chauvier
(En l’absence d’étude d’impact fiable, la seule dramaturgie de l’événement peut garantir sa légitimité.)
Tu commences Somaland, et tu t’étonnes. Tu ne savais pas qu’Eric Chauvier écrivait de la fiction. Et puis tu continues un peu, et le doute s’installe. Tout ça est trop énorme pour être totalement faux. Tu farfouilles un peu sur la toile. Et puis tu comprends que non, Somaland n’est pas une fiction. Et tout le long de la lecture, tu es obligé de te répéter comme un mantra Somaland n’est pas une fiction, pas une fiction, pas une fiction
 Somaland est donc un recueil d’entretiens menés par Eric Chauvier dans une commune lourdement industrialisée. Interrogeant élus, habitants, scientifiques, administratifs, l’anthropologue essaie de cerner la perception du risque et sa prise en compte, les liens existants (ou pas) entre population locale et industries. Le résultat est pour le moins instructif…
Somaland est donc un recueil d’entretiens menés par Eric Chauvier dans une commune lourdement industrialisée. Interrogeant élus, habitants, scientifiques, administratifs, l’anthropologue essaie de cerner la perception du risque et sa prise en compte, les liens existants (ou pas) entre population locale et industries. Le résultat est pour le moins instructif…
C’est devenu difficile de faire n’importe quoi. (Un élu)
Mais son enquête prend un virage inattendu. Eric Chauvier est interpellé par Yacine, un habitant d’un quartier déshérité en plein milieu de la zone industrielle. Yacine raconte la désagrégation physique et psychique de sa copine Loretta, désagrégation qu’il met sur le compte d’une substance chimique, le silène. Sans prendre au sérieux plus que ça Yacine, Eric Chauvier tente néanmoins d’interroger les responsables sur la substance. Et là, un mur.
Et puis bon, surtout, j’insiste là-dessus : comment vos riverains pourraient-ils parler de quelque chose qui n’a pas d’odeur? (Un élu)
Et ce n’est pas tant la théorie du silène qui intéresse Chauvier, mais plutôt la manière expéditive de ne pas répondre à la question de la part des élus, scientifiques, industriels, administratifs. La substance devient alors le révélateur du fonctionnement de la micro-société de Somaland, un univers où le discours et la fiction se substituent à la science, où la gestion des risques se résume à une gestion purement politique des risques.
(… Observons cependant qu’à Somaland, ce dont on ne parle pas n’existe pas ; la force d’un discours politique réside dans sa capacité à rendre acceptable le déni de ce qui nuit à l’édification de son autorité. (…) : n’existe que ce qui est prévu d’exister. (…))
Gare donc à celui qui cherche, qui essaie de comprendre quelque chose à Somaland. Il n’y a pas sa place. Toute tentative de faire entendre une voix, d’interroger, d’obtenir une réponse fiable est vaine.
(…) tout désir de savoir est voué à la solitude.
Mais au-delà de la réflexion sur le discours et la gestion des risques, ce qui est absolument passionnant dans Somaland c’est le dispositif mis en place par l’auteur. Reprenant mot pour mot (en changeant les noms) les entretiens enregistrés, Eric Chauvier y intègre des “commentaires” sous forme de didascalies. Le texte ressemble donc à du théâtre, et c’est dans cette forme que Somaland puise toute sa force. Véritable et vertigineuse mise en abyme, la forme théâtrale sert de révélateur à la fiction pure que constitue le discours sur la gestion des risques industriels en France.
Somaland se lit dans un souffle, avec passion, angoisse et effarement. Puissant et immense.
Et je crois que les gens finissent par savoir ça, par se rendre compte que leur vie quotidienne n’est pas compatible avec le fait de penser aux risques industriels. (Madame le maire de Somaland)
Ed. Allia