de Mariette Navarro.
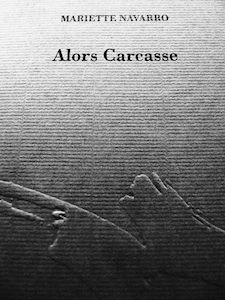 La surprise est à la hauteur de la qualité de l’objet, belle et émouvante. Le premier texte publié chez Cheyne éditeur de Mariette Navarro est une très jolie découverte. Le titre d’abord interpelle, énigmatique. Alors Carcasse. Un Alors comme une ouverture sur un monde pour l’instant inconnu, sur un mouvement de l’avant vers quelque chose qu’on ne devine pas encore, le bord d’un précipice. Et Carcasse, un personnage “armature”, au nom tellement symbolique. C’est donc l’histoire de cet étrange Carcasse qui nous est contée. Carcasse qui est un personnage dont on ne perçoit que le squelette. Il est encore vide et incertain, sans corps et sans idée, flou. Carcasse se tient sur le seuil, et il n’ose pas le franchir. Il voit le monde au-delà mais n’ose pas y aller. Pourtant petit à petit, Carcasse apprend à être, à exister. Seul, il se compose un corps, qu’il habite progressivement. Mais cette “naissance” de Carcasse est délicate, et son affirmation fait grincer des dents le monde qui l’entoure et qu’il a tendance à oublier. Perdu dans cette recherche de lui même, Carcasse croît démesurément et fait de l’ombre au-delà du seuil.
La surprise est à la hauteur de la qualité de l’objet, belle et émouvante. Le premier texte publié chez Cheyne éditeur de Mariette Navarro est une très jolie découverte. Le titre d’abord interpelle, énigmatique. Alors Carcasse. Un Alors comme une ouverture sur un monde pour l’instant inconnu, sur un mouvement de l’avant vers quelque chose qu’on ne devine pas encore, le bord d’un précipice. Et Carcasse, un personnage “armature”, au nom tellement symbolique. C’est donc l’histoire de cet étrange Carcasse qui nous est contée. Carcasse qui est un personnage dont on ne perçoit que le squelette. Il est encore vide et incertain, sans corps et sans idée, flou. Carcasse se tient sur le seuil, et il n’ose pas le franchir. Il voit le monde au-delà mais n’ose pas y aller. Pourtant petit à petit, Carcasse apprend à être, à exister. Seul, il se compose un corps, qu’il habite progressivement. Mais cette “naissance” de Carcasse est délicate, et son affirmation fait grincer des dents le monde qui l’entoure et qu’il a tendance à oublier. Perdu dans cette recherche de lui même, Carcasse croît démesurément et fait de l’ombre au-delà du seuil.
Le texte de Mariette Navarro est à la fois très audacieux dans sa conception (raconter l’histoire beckettienne d’un personnage proche du vide), simple dans son principe (un éveil initiatique), et riche dans sa forme. Car on est ici dans un univers poétique, unique, expérimental qu’on sent réfléchi, maîtrisé et parfaitement composé. La langue de Mariette Navarro est particulière, déroutante au début, puis on s’y installe et on se laisse porter par ces mots bousculés, ce souffle intérieur irrégulier, au gré des évolutions de Carcasse. Ce qui impressionne le plus dans l’écriture de Mariette Navarro, c’est que jamais cette recherche stylistique ne se fait au détriment de son histoire. Bien au contraire. Cette forme est un vecteur d’émotions, émotions qui naissent dès la première page. Grâce au personnage de Carcasse, l’auteur réussit à toucher quelque chose d’à la fois très personnel, sensible et de totalement universel. Personnel car on sent l’auteur derrière la plume, son vécu, son ressenti, ses questionnements. Cette personne nous touche infiniment, justement parce que ses questionnements sont aussi les nôtres, et elle atteint en ça un petit quelque chose d’universel.
Alors Carcasse est un premier texte poétique, personnel et touchant, qui donne envie de découvrir un peu plus de la très belle plume de son auteur. Pour un coup d’essai…
Point infos :
- Pour découvrir un peu plus l’auteur, je vous conseille vivement la visite de son blog
- Alors Carcasse sera lu le 18 Août à St Agrève (07) par Denis Lavant (rien que ça)
- Nous les vagues, deuxième publication de Mariette Navarro, sortira prochainement aux Editions Quartett
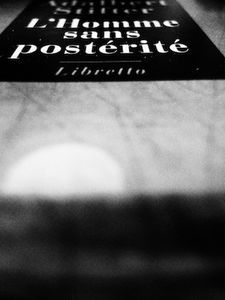
 Perplexité, agacement, ce sont les mots qui me sont venus à l’esprit en cours de lecture. Ce que j’appelle oubli, très court roman (à peine 60 pages écrites en police 18, à peine une nouvelle en fait), publié bien entendu, par les Editions de Minuit, laisse un goût amer dans la bouche. Pourtant, je me doute bien qu’il est sûrement de très mauvais goût d’oser émettre des doutes en ce qui concerne les intentions de l’auteur, tant le fait divers sur lequel il s’appuie est effectivement abominable, insupportable, inadmissible.
Perplexité, agacement, ce sont les mots qui me sont venus à l’esprit en cours de lecture. Ce que j’appelle oubli, très court roman (à peine 60 pages écrites en police 18, à peine une nouvelle en fait), publié bien entendu, par les Editions de Minuit, laisse un goût amer dans la bouche. Pourtant, je me doute bien qu’il est sûrement de très mauvais goût d’oser émettre des doutes en ce qui concerne les intentions de l’auteur, tant le fait divers sur lequel il s’appuie est effectivement abominable, insupportable, inadmissible.
