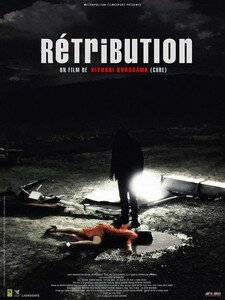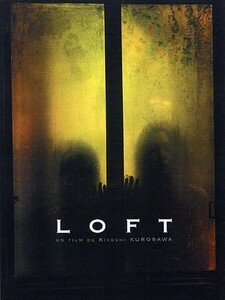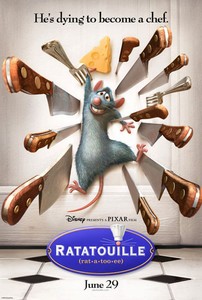( 2007 ) de Kiyoshi Kurosawa
Bien que film de commande, Retribution n’en est pas moins bien meilleur que Loft. Beaucoup plus cohérent (j’ai bien dit cohérent hein, pas réaliste), beaucoup plus resserré sur son thème, il mèle très efficacement intrigue policière et histoire de revenants vengeurs. Visuellement, c’est de toute beauté, on est happé dès la première scène (une femme à la robe rouge se fait noyer dans une flaque au milieu d’un désert bétonné et crépusculaire), pour ne plus être lâché. Décors sombres, ultra-urbains, en pleine décadence, dans une ville en éternelle (dé)construction. Un flic enquête sur une série de meurtres mystérieux, dont le modus operandi est identique : la noyade dans de l’eau salée. Hanté par le fantôme d’une femme à la robe rouge, qu’il prend d’abord pour la première victime, il tente de dénouer les fils complexes de cette histoire, dont il est le principal suspect.
Autant dans Loft, le fond du film se diluait jusqu’à disparaître sous des flots de « fais-moi peur », autant Retribution est tendu comme un arc autour de son sujet : l’indifférence, la désaffection, l’incapacité à réagir face aux choses. Dans cette fourmilière citadine, les personnages perdent leur essence primordiale d’humanité, pour devenir des robots, incapables d’agir spontanément, mais uniquement de réagir, une fois qu’il est trop tard, et quand la société le dicte. Ainsi, la série de meurtres entraîne l’enquête policière, qui n’aurait jamais eu lieu, si la société n’avait pas fermé les yeux sur un secret pourtant mal gardé. Pour toute rétribution, cette série de meurtres atroces, déclencheur de l’ouverture de la boîte de Pandore. Le message est clair, on est puni quand on a pêché. Lent, silencieux, tortueux, glacial et implacable,Retribution n’en est pas moins un vrai film d’horreur qui frigorifie l’échine de belle manière. Chapeau bas.